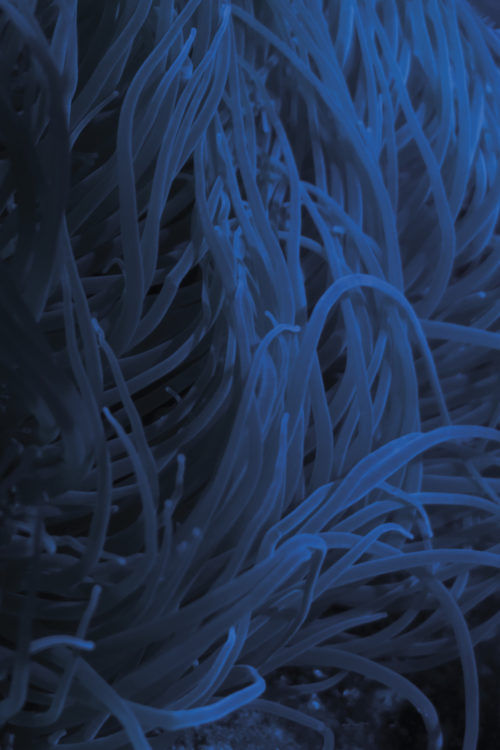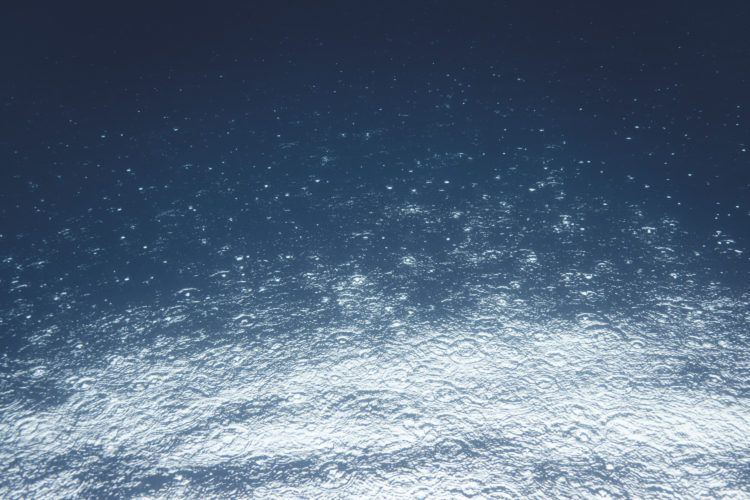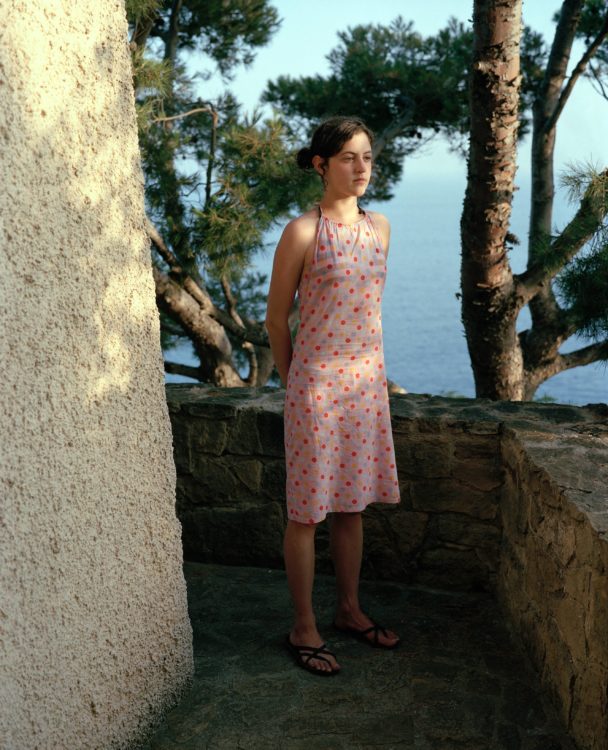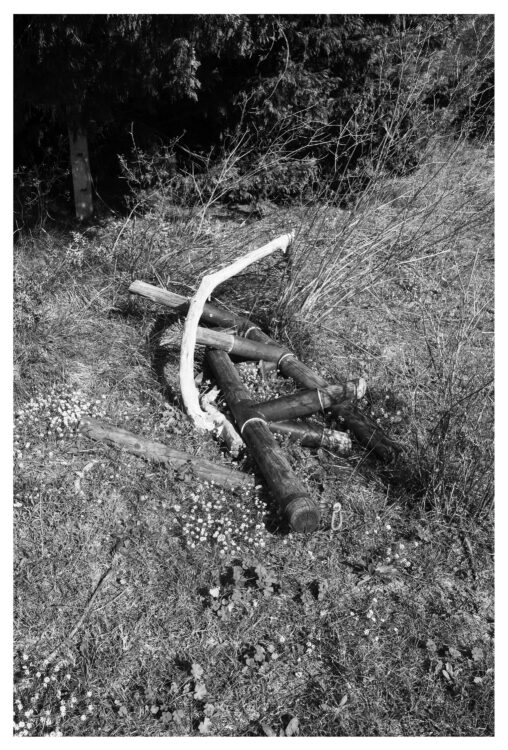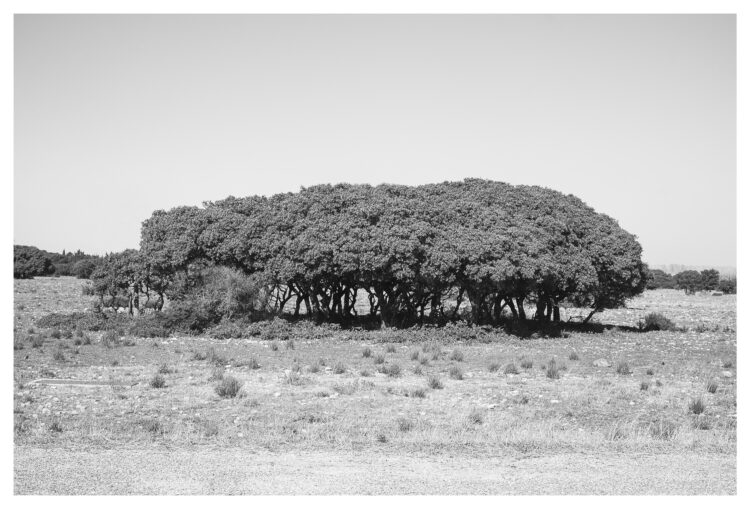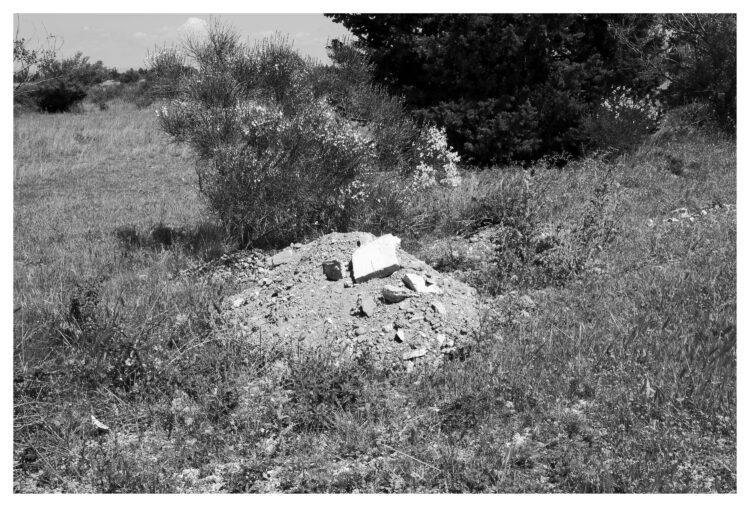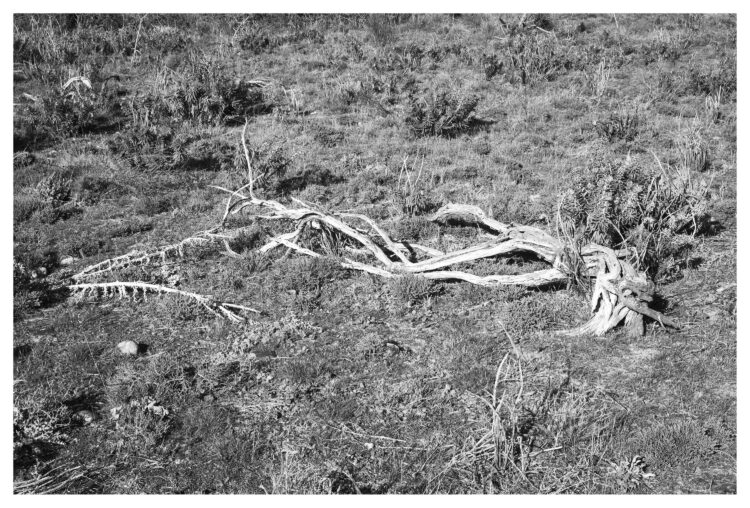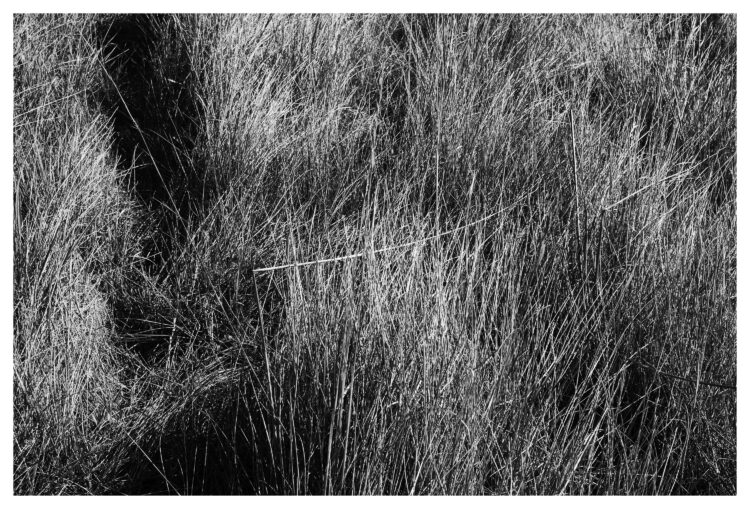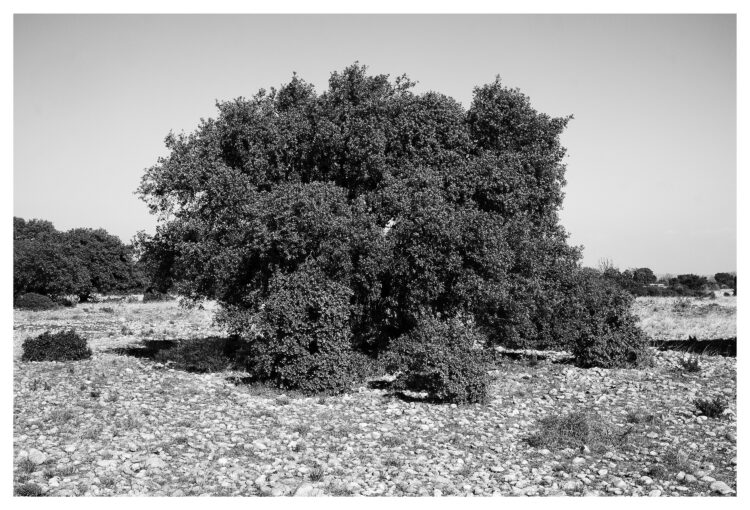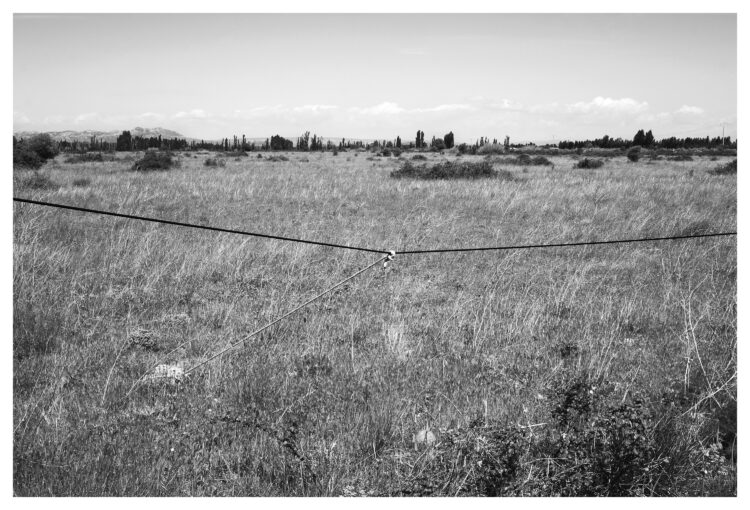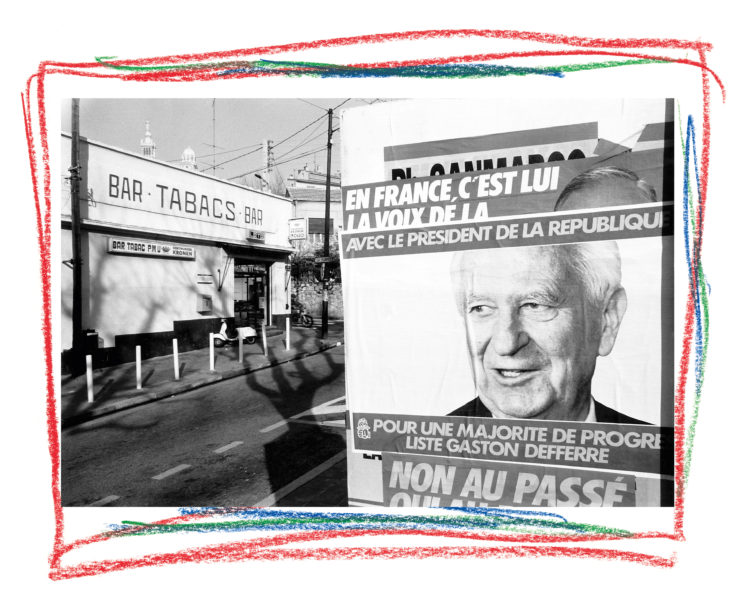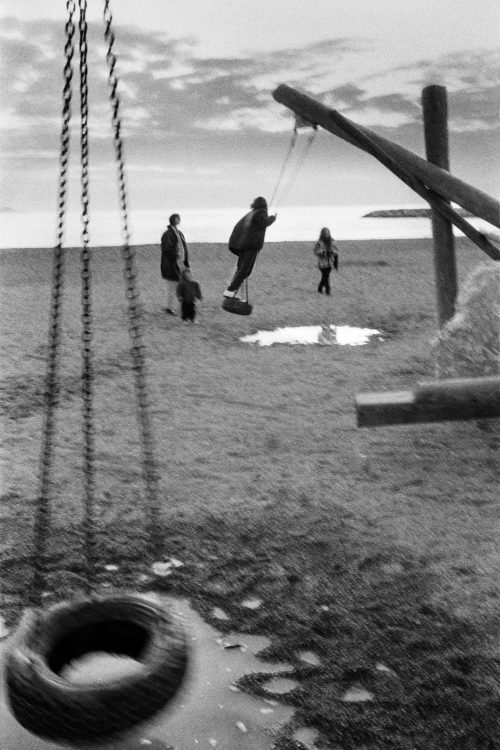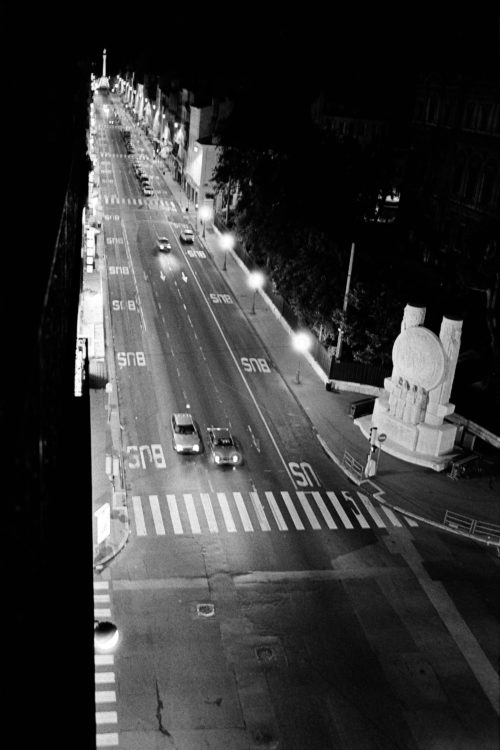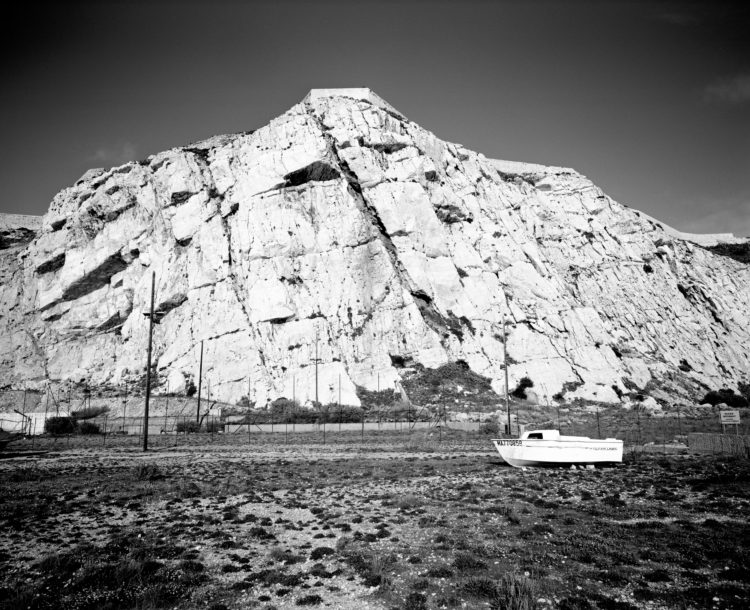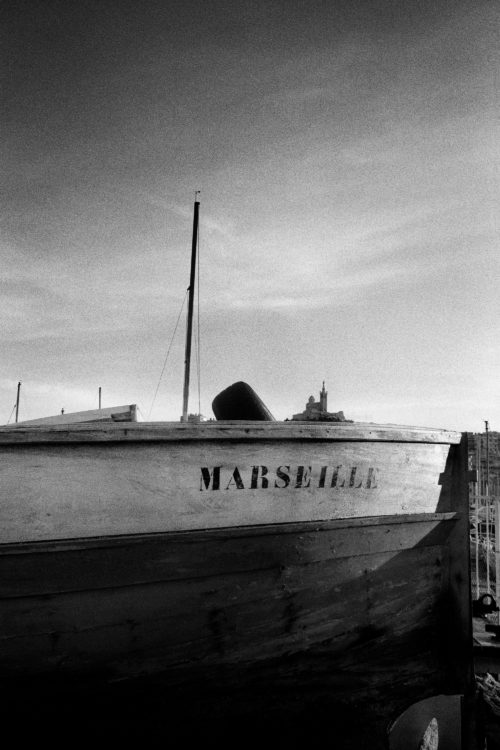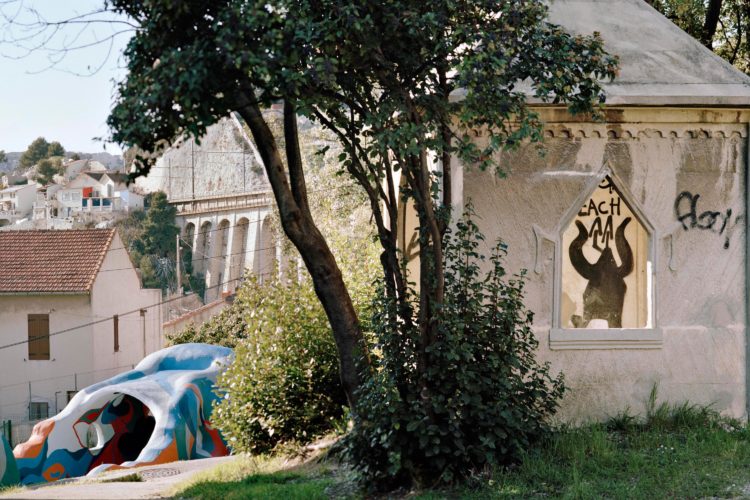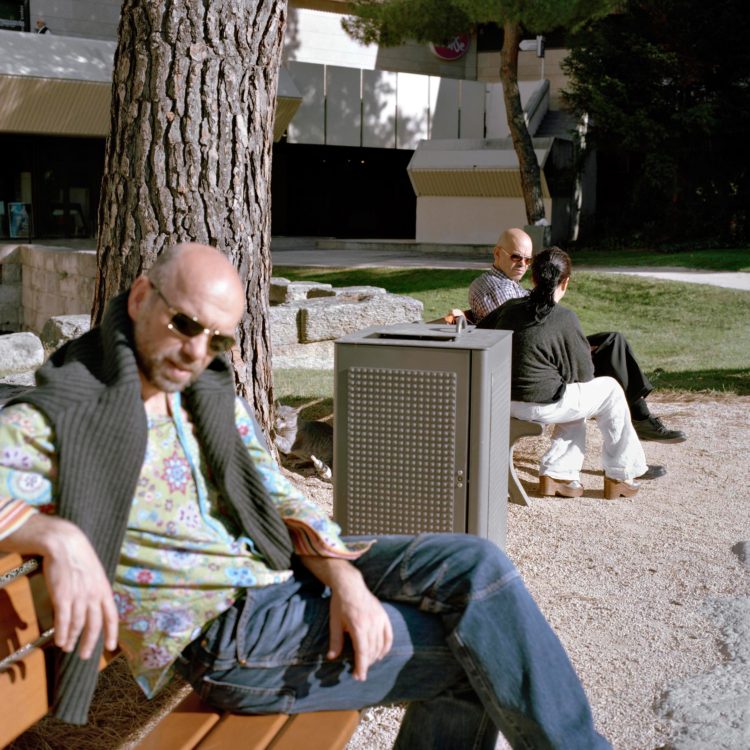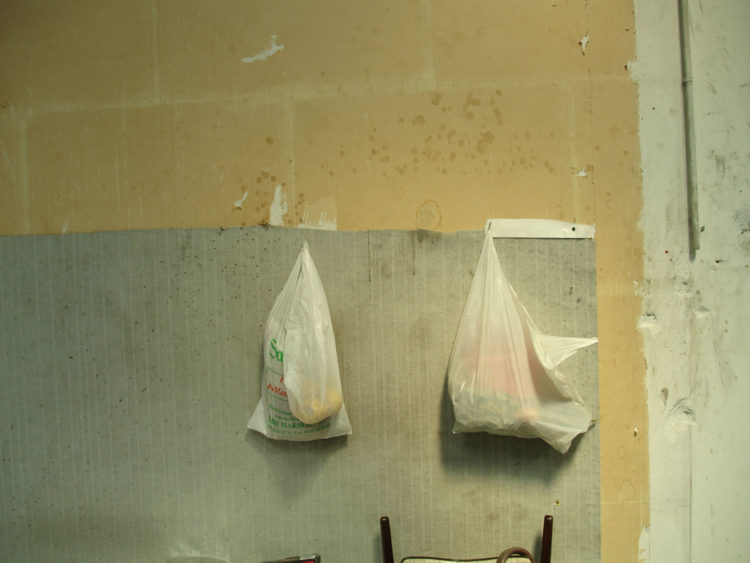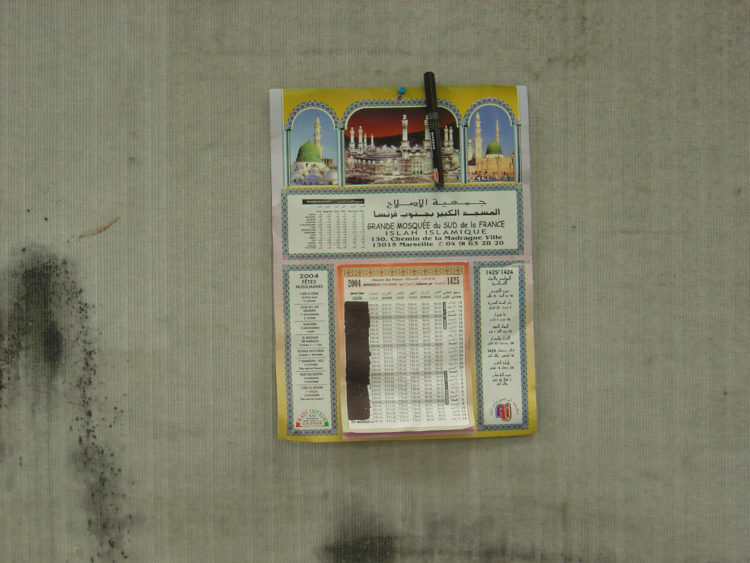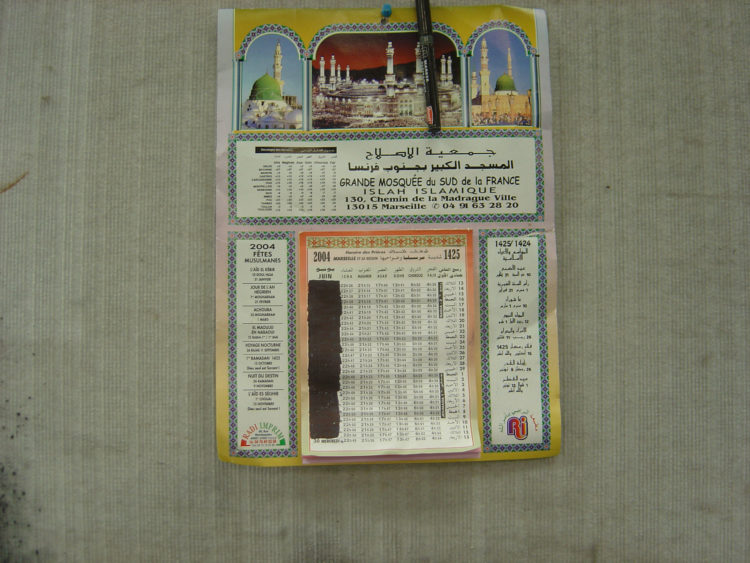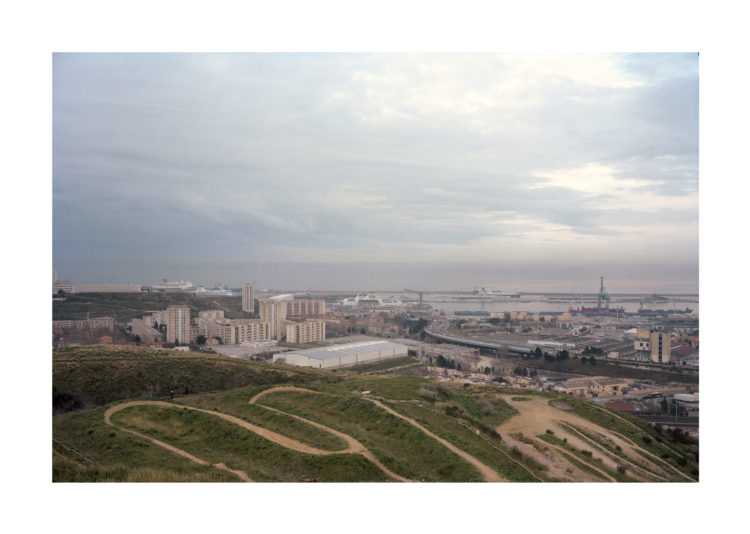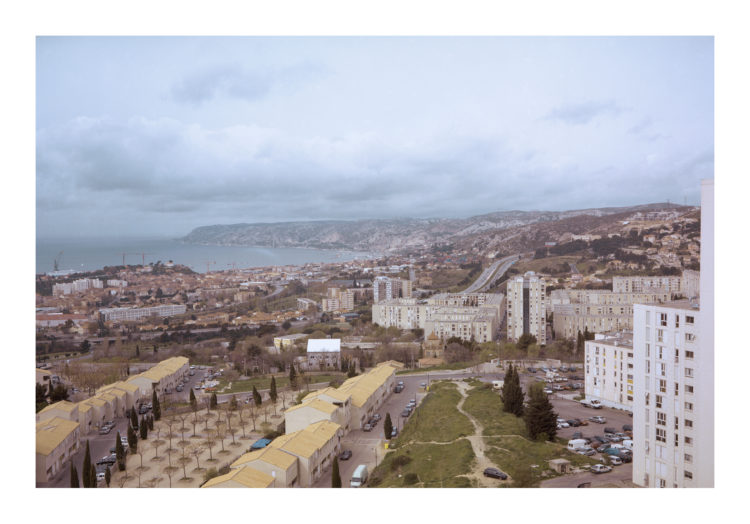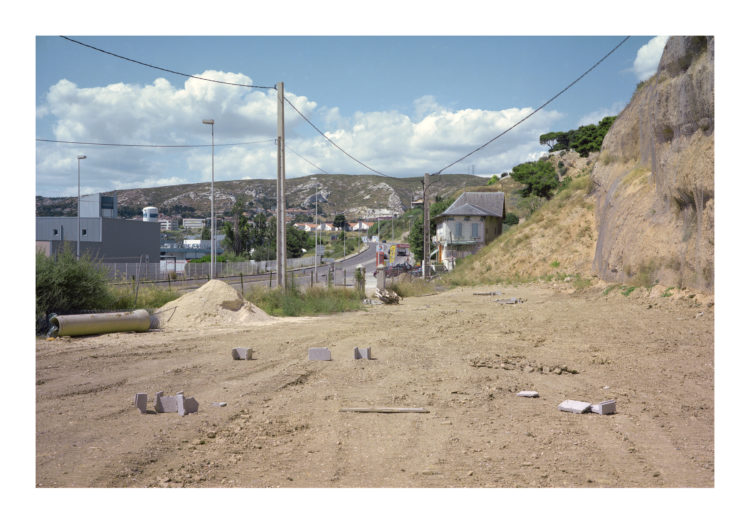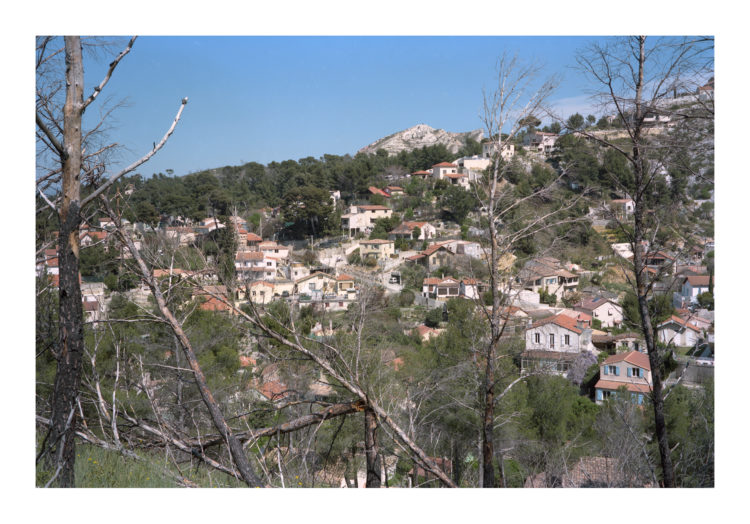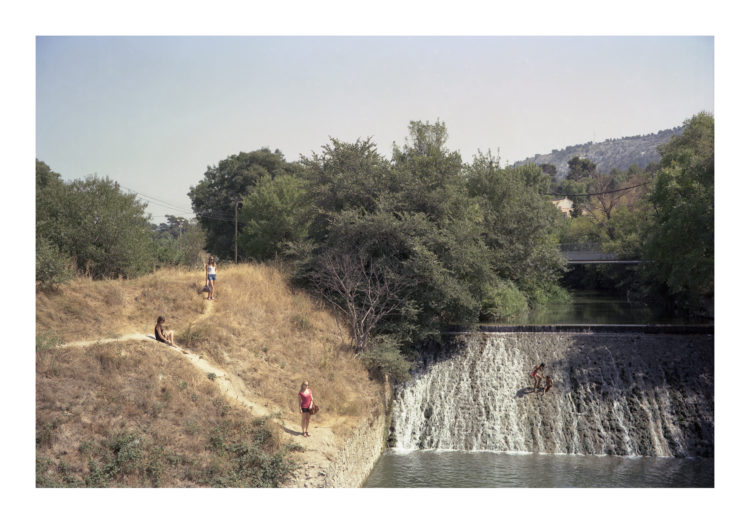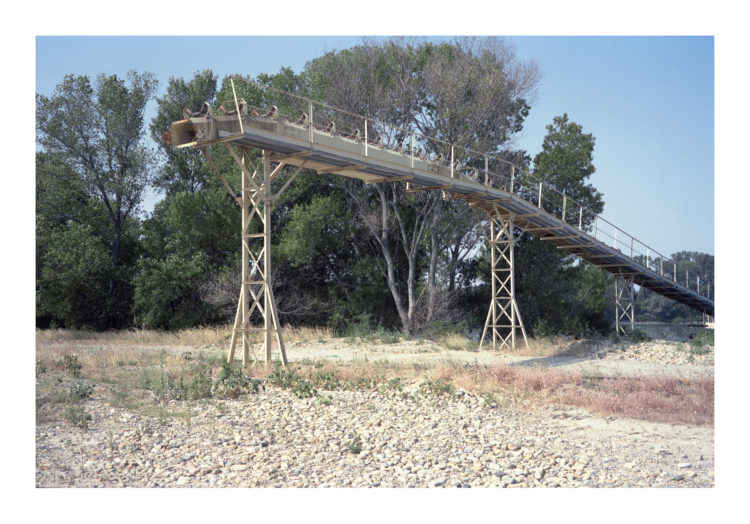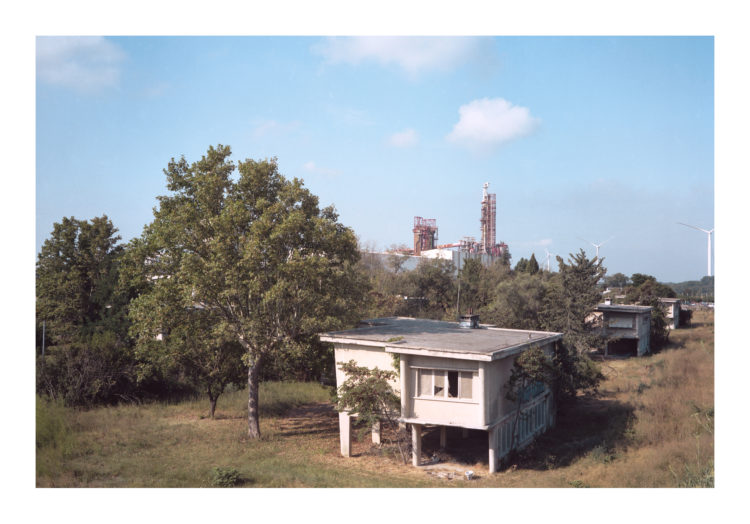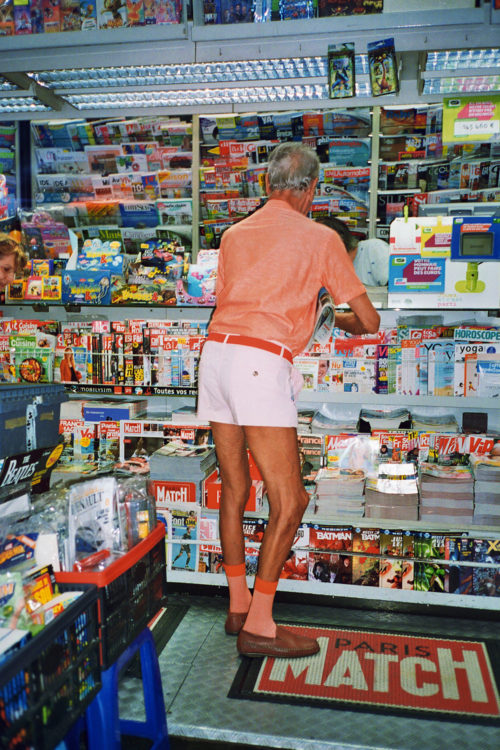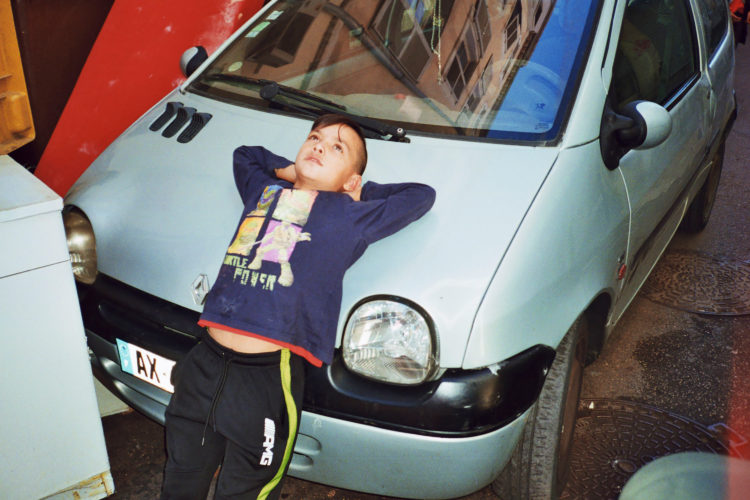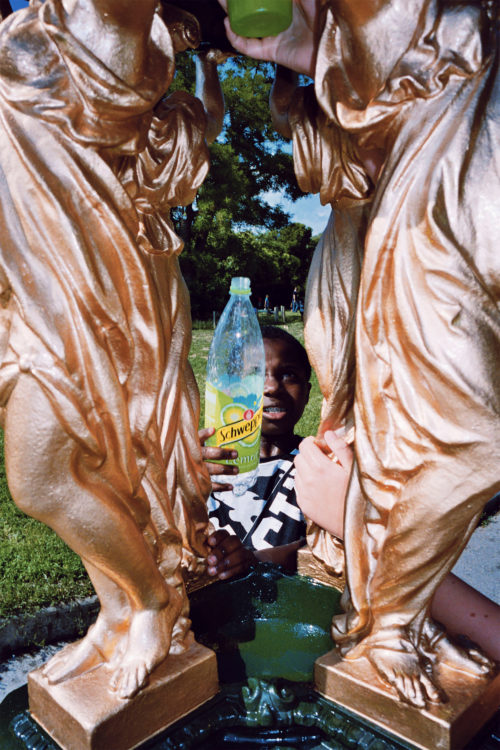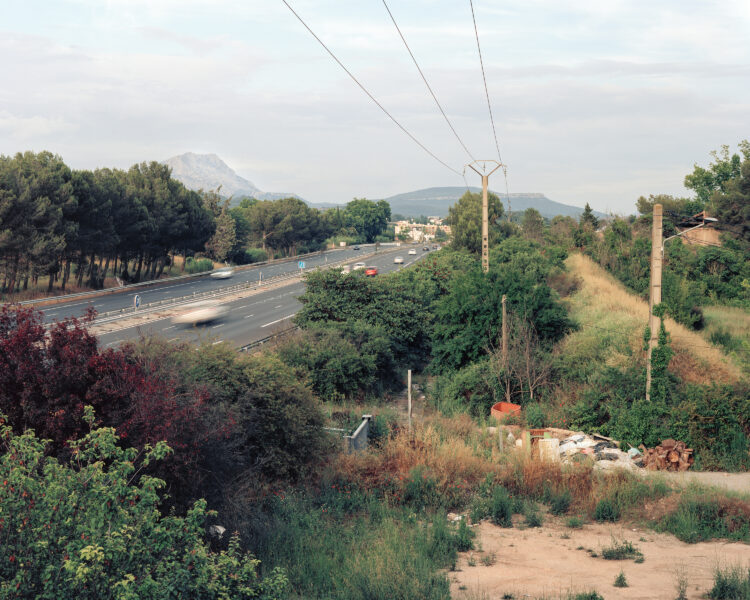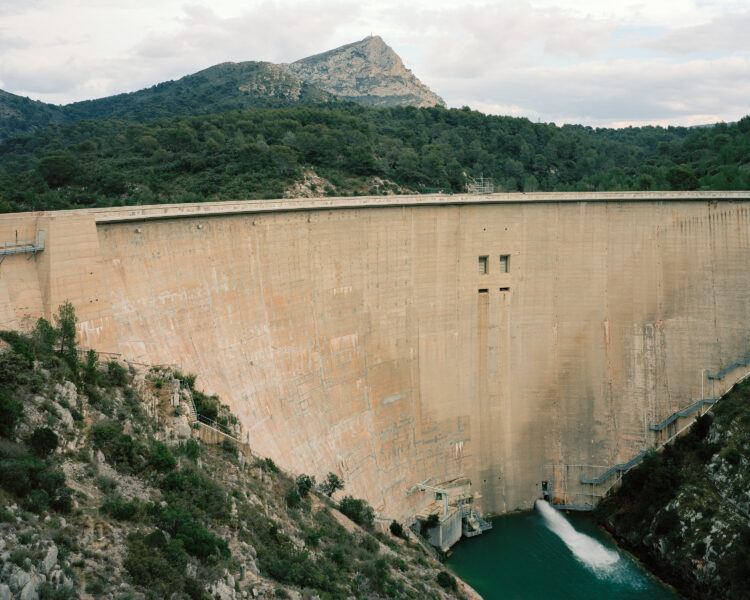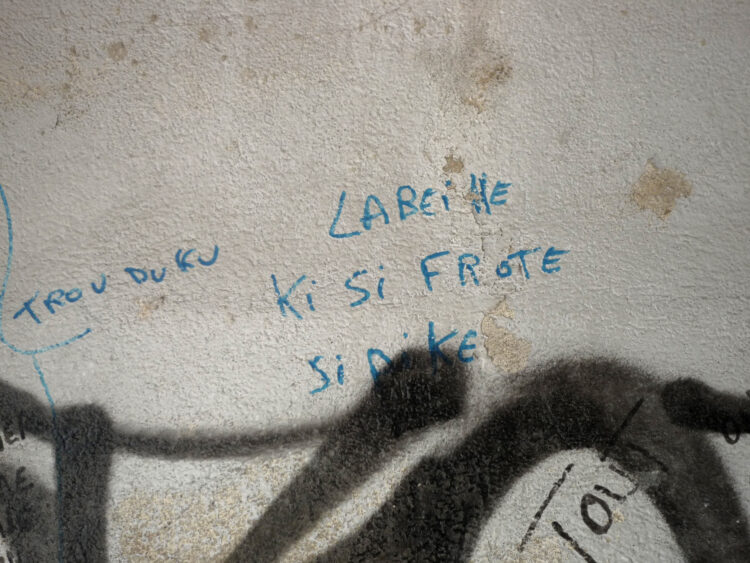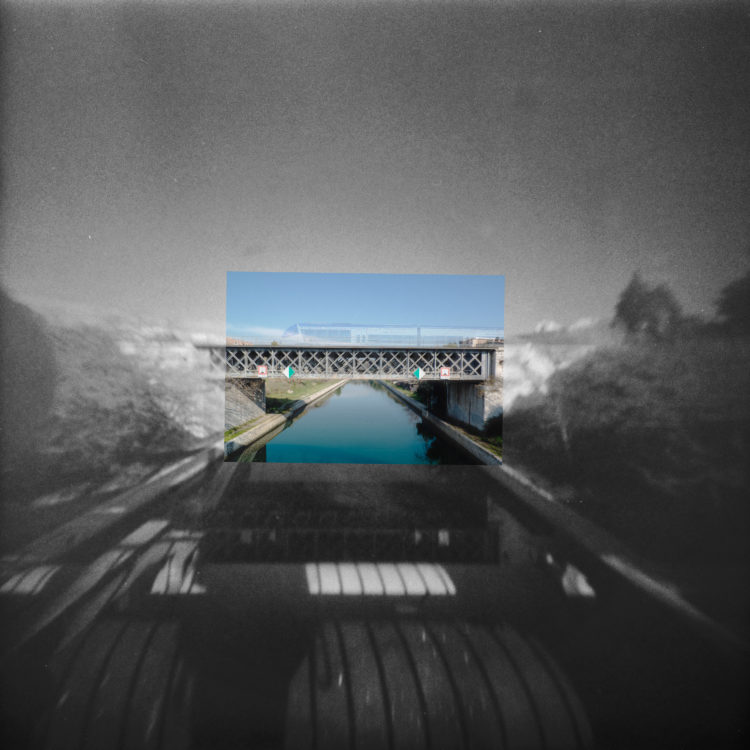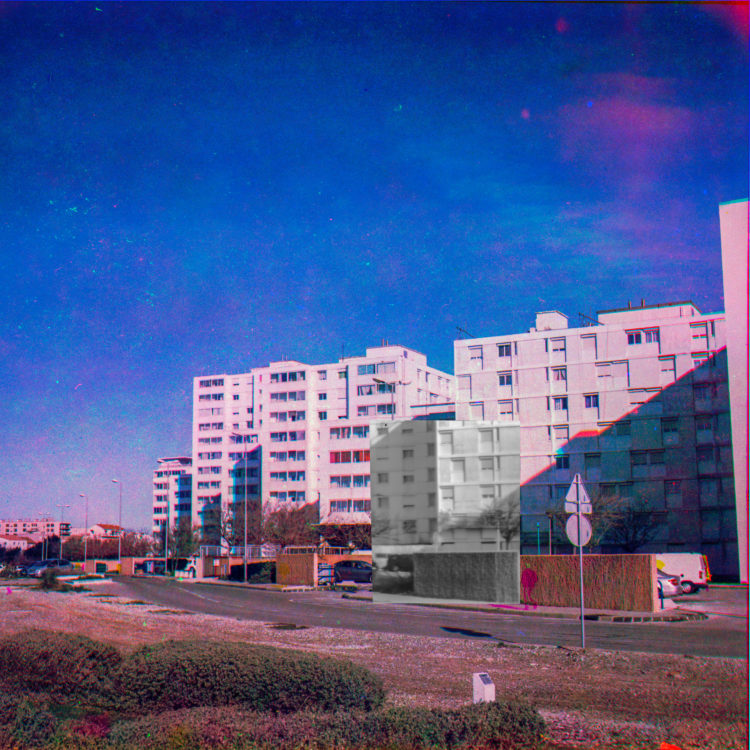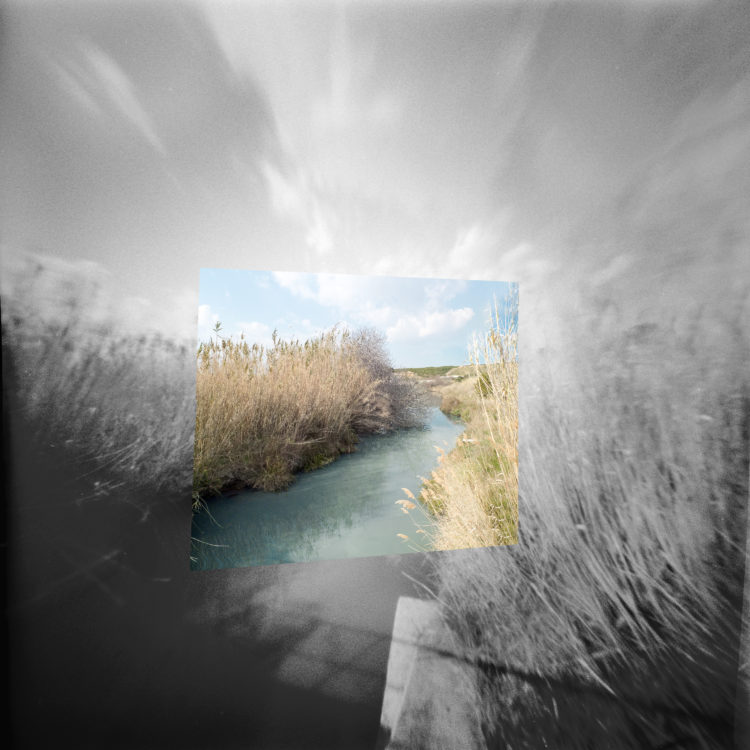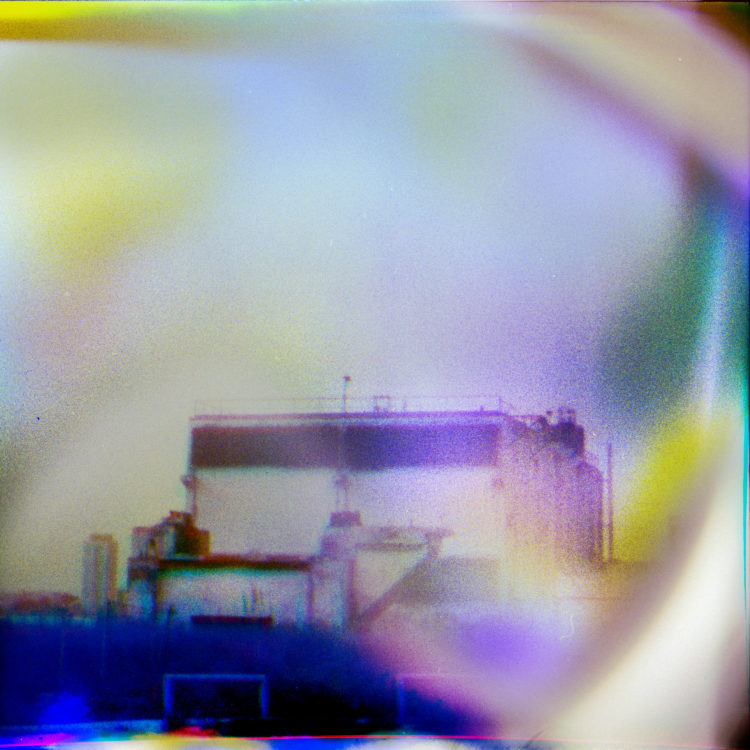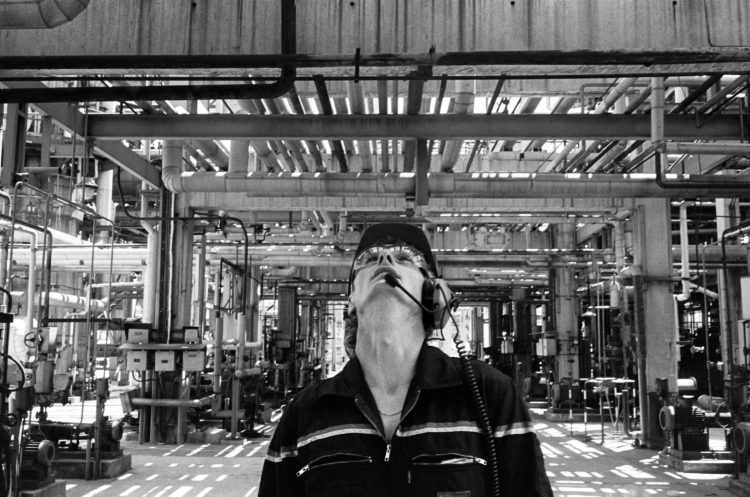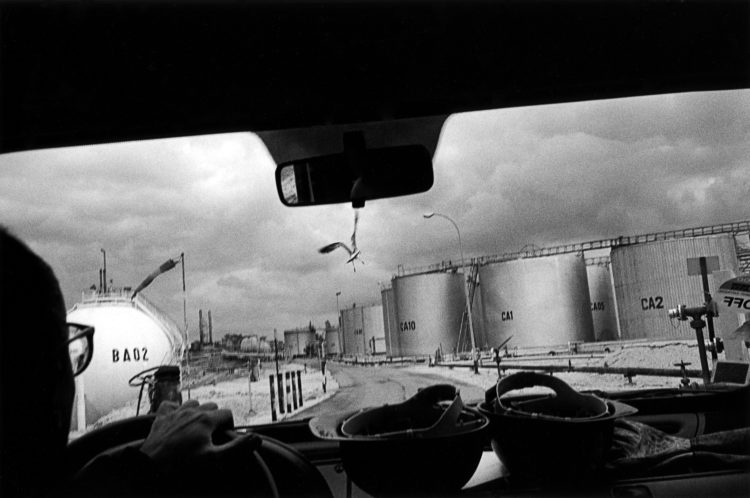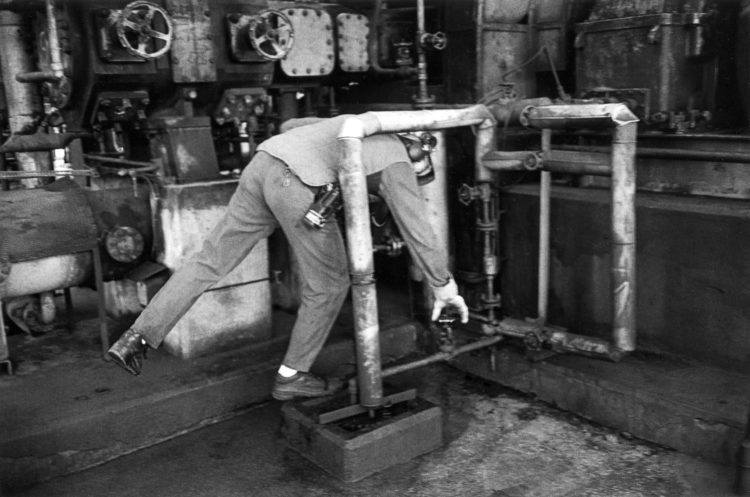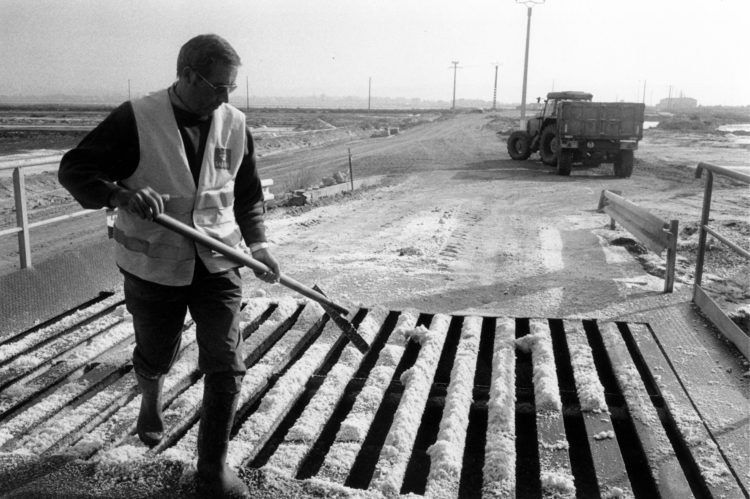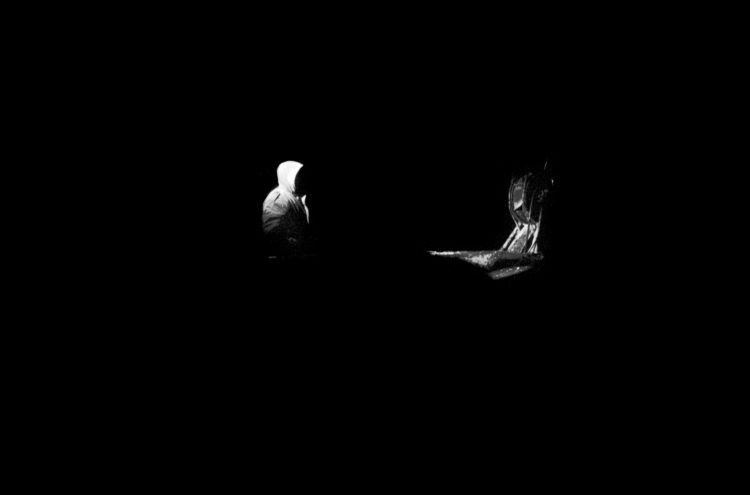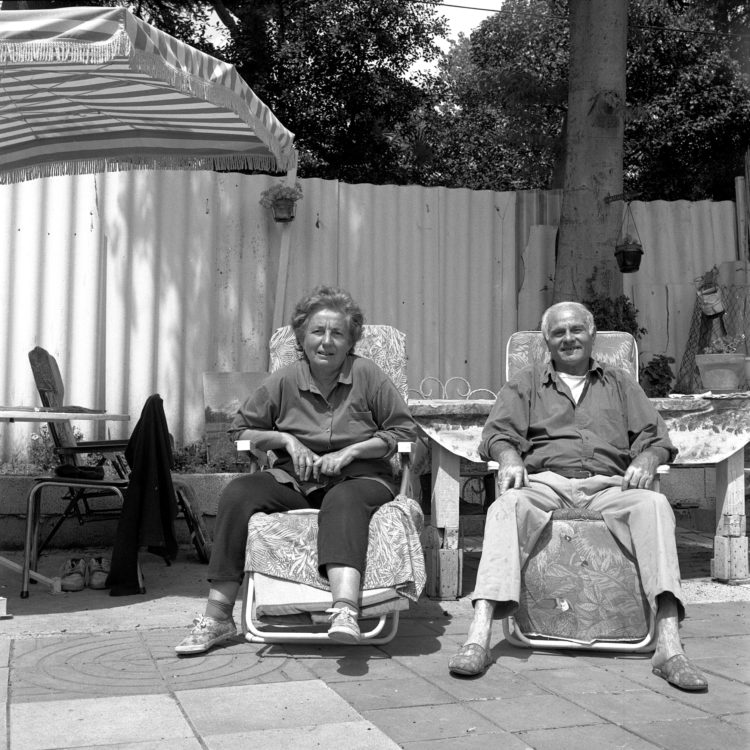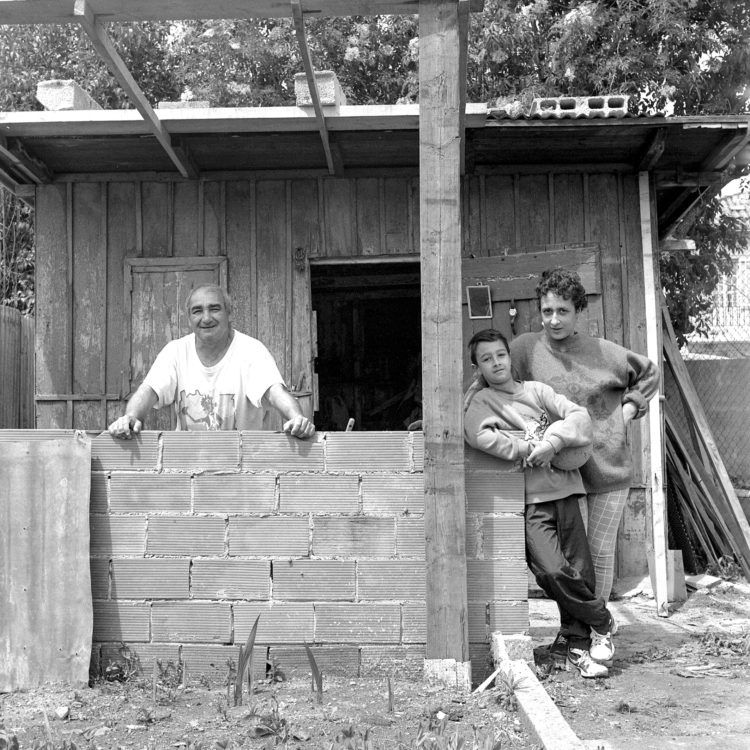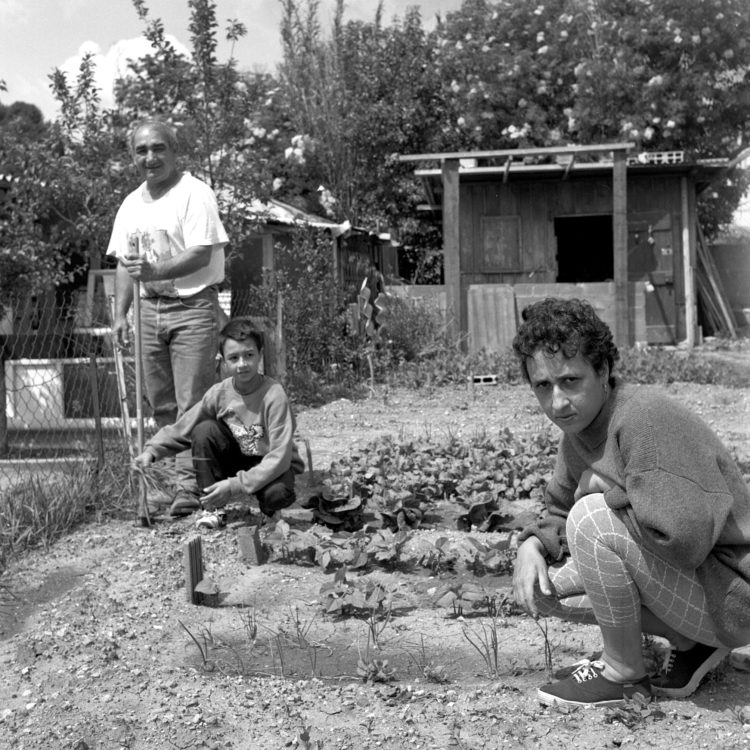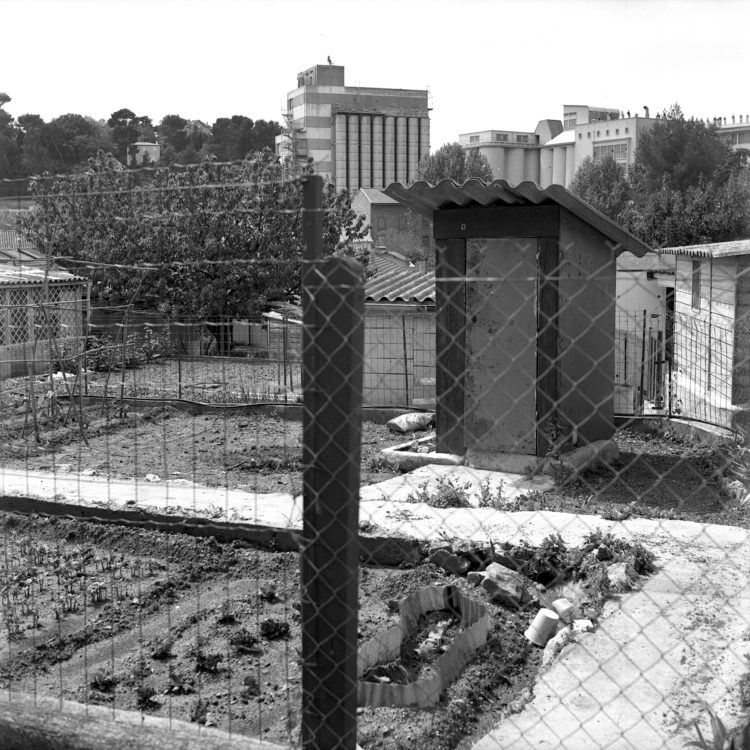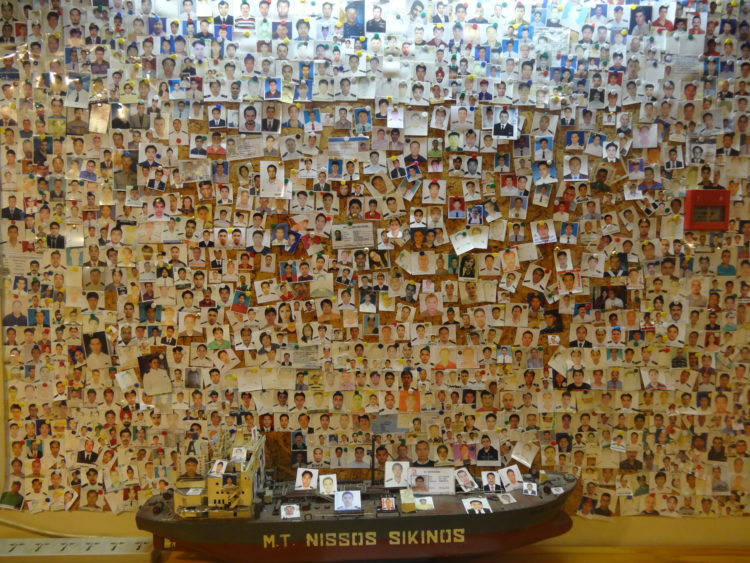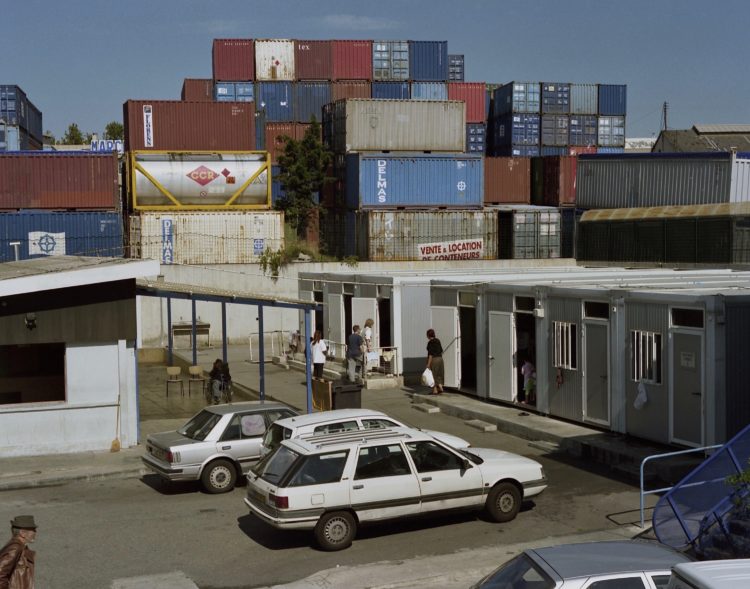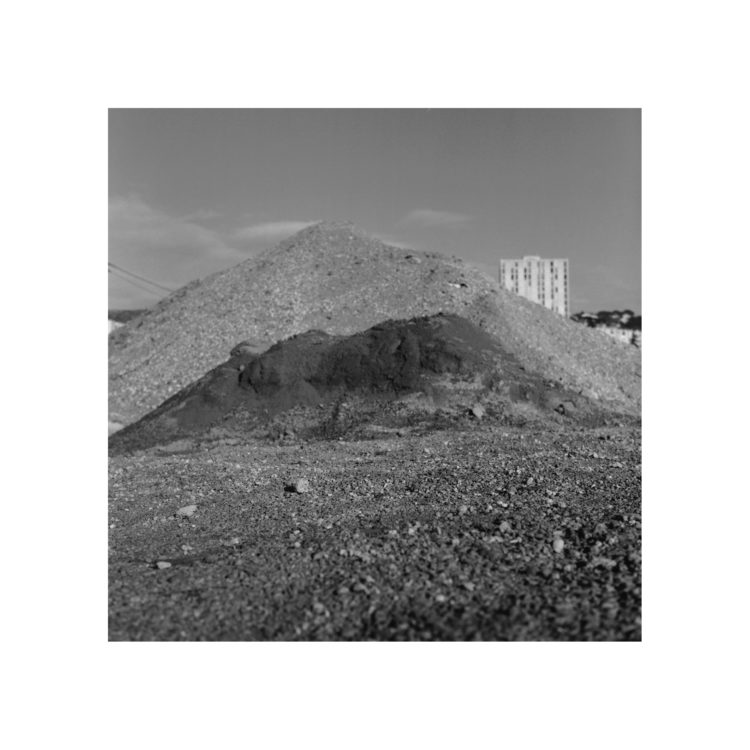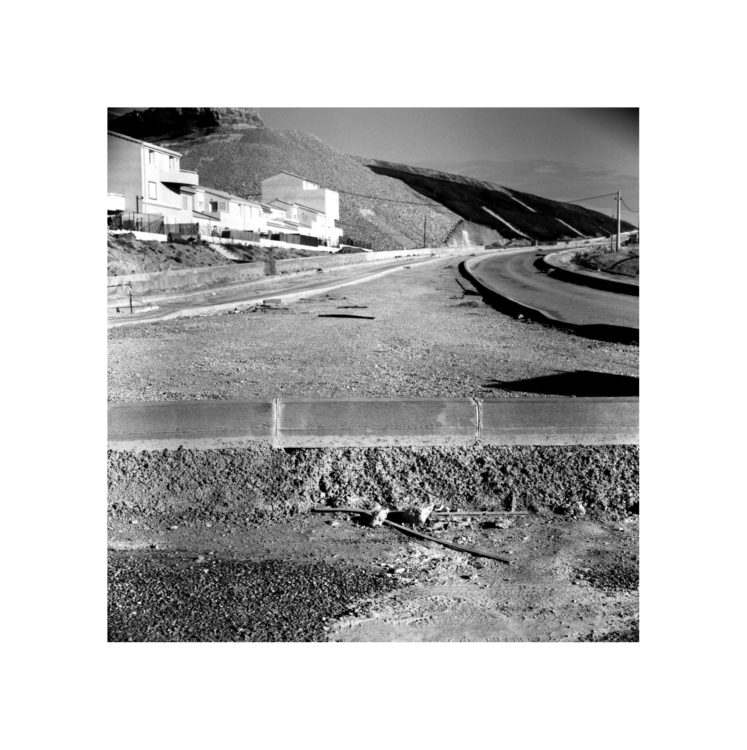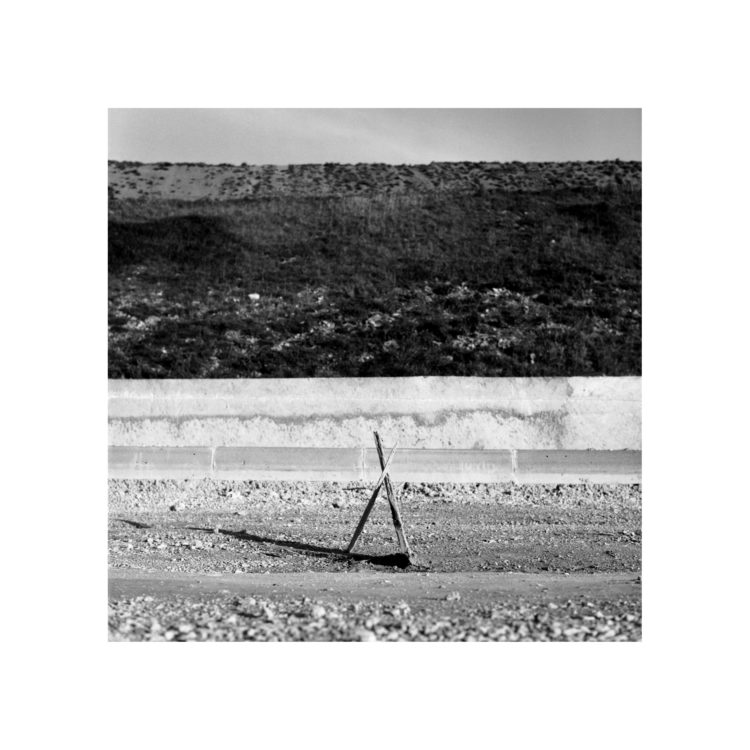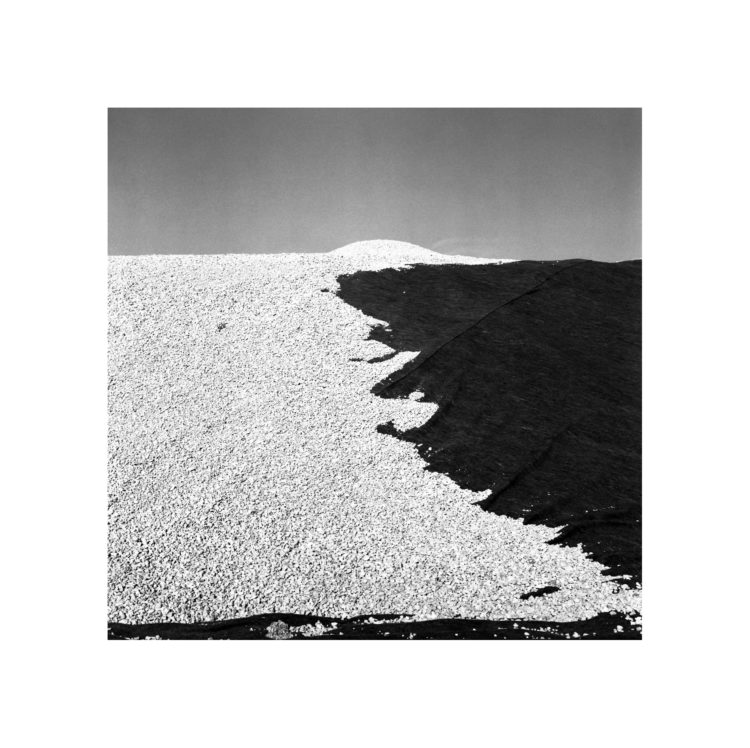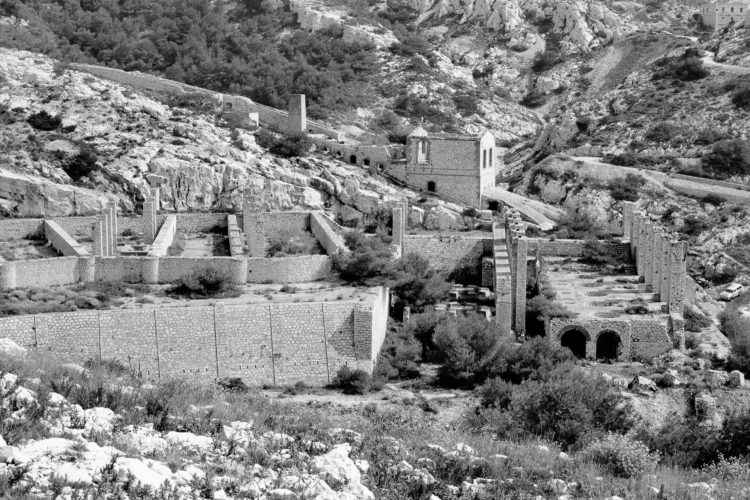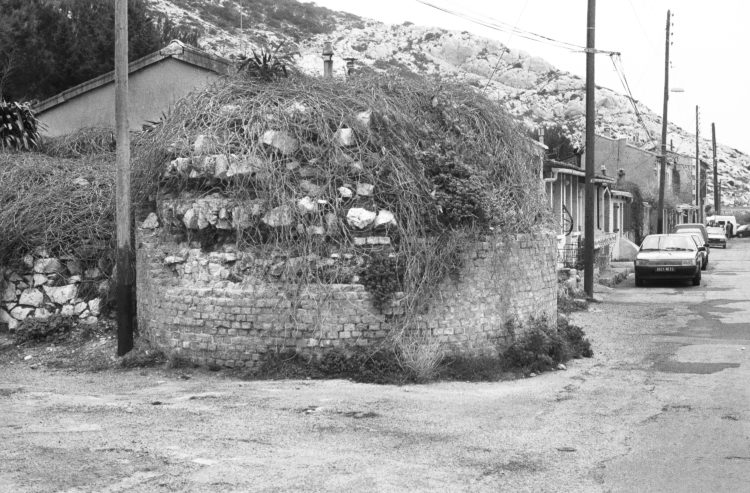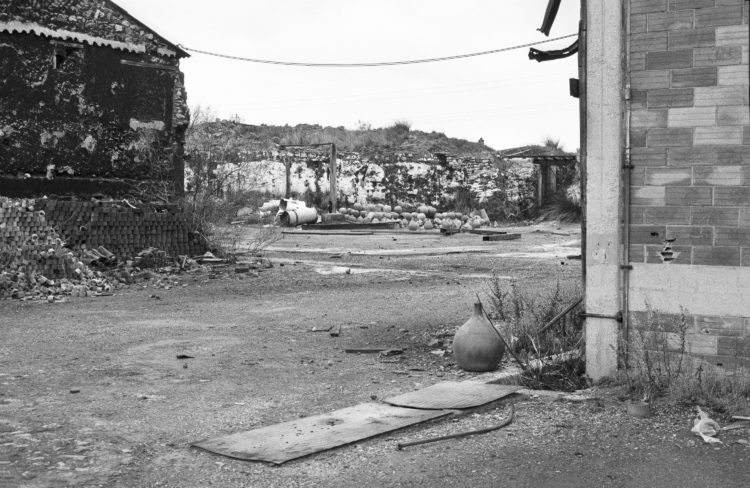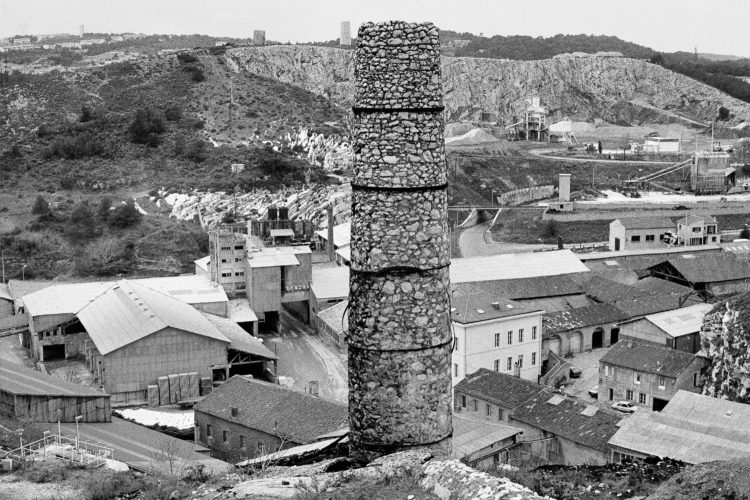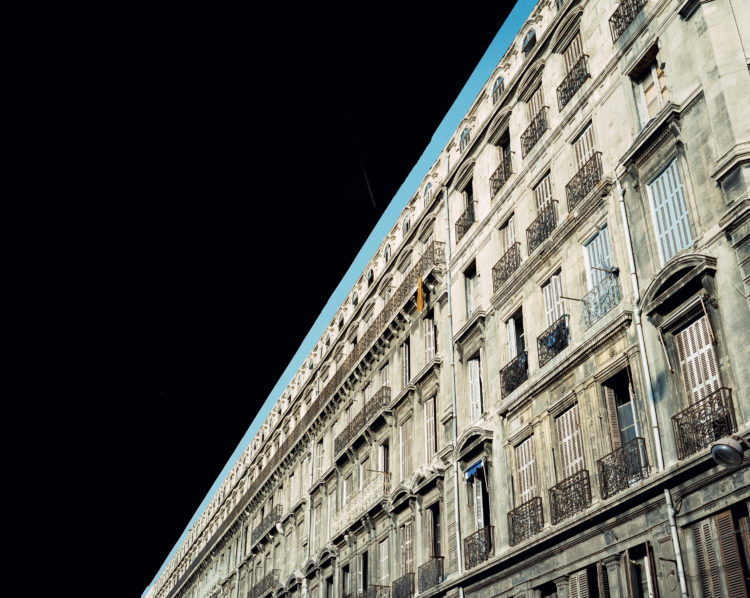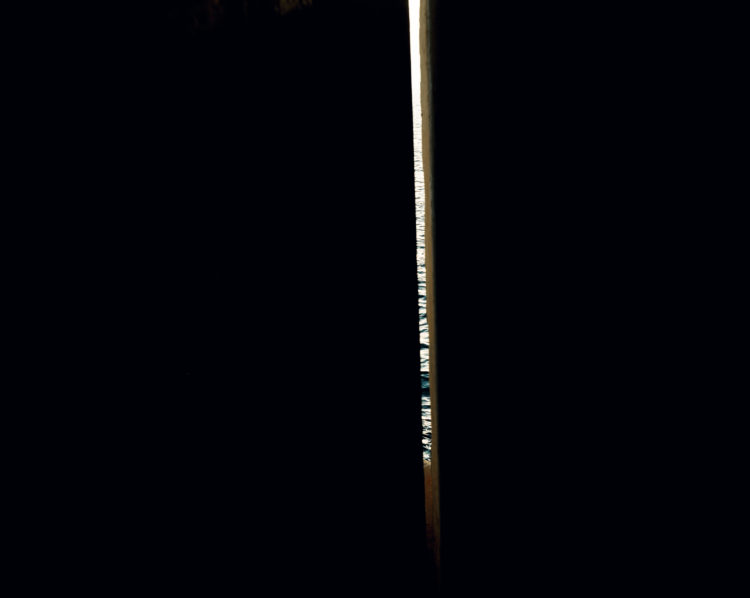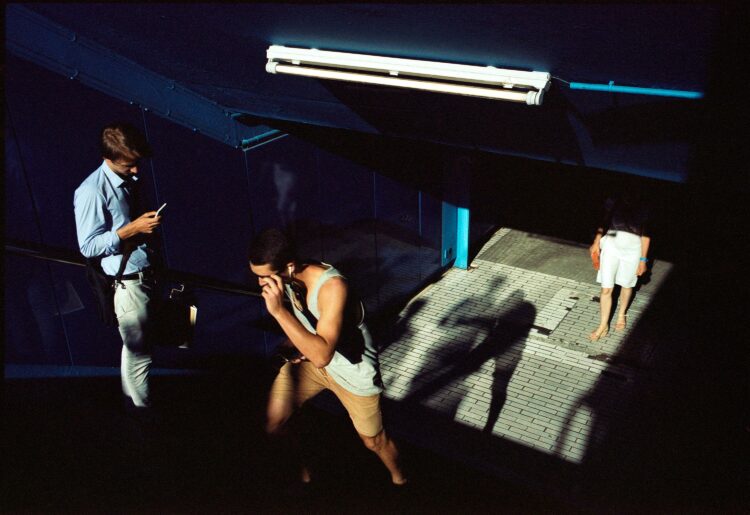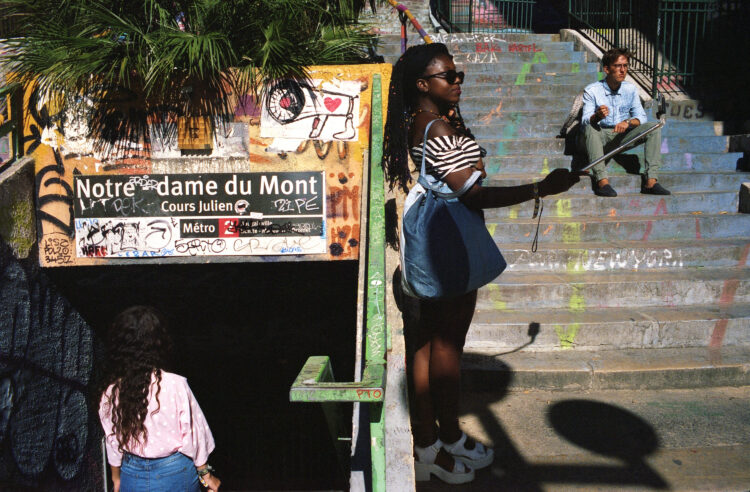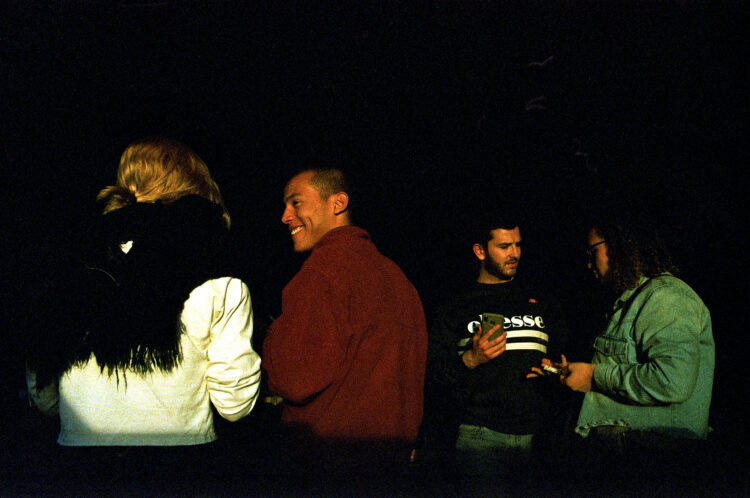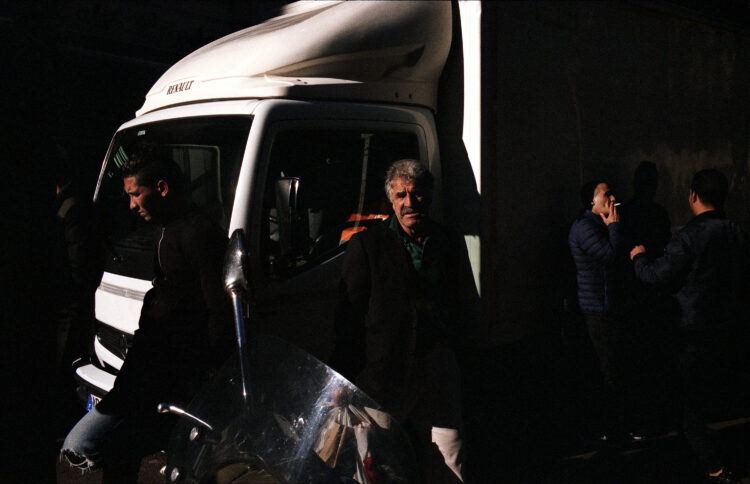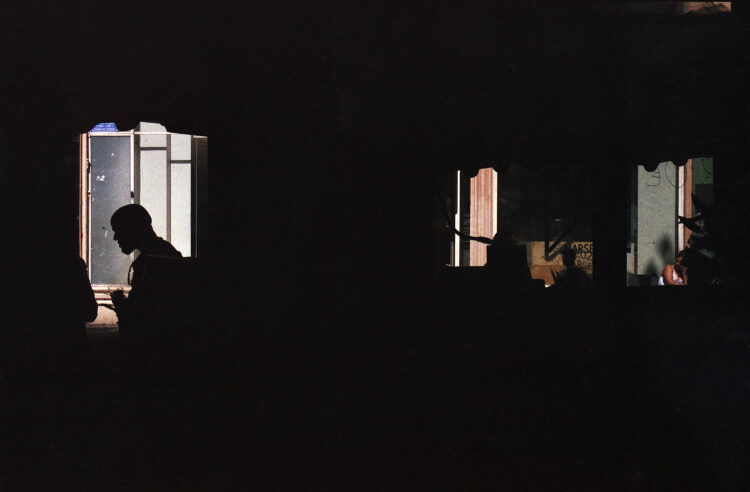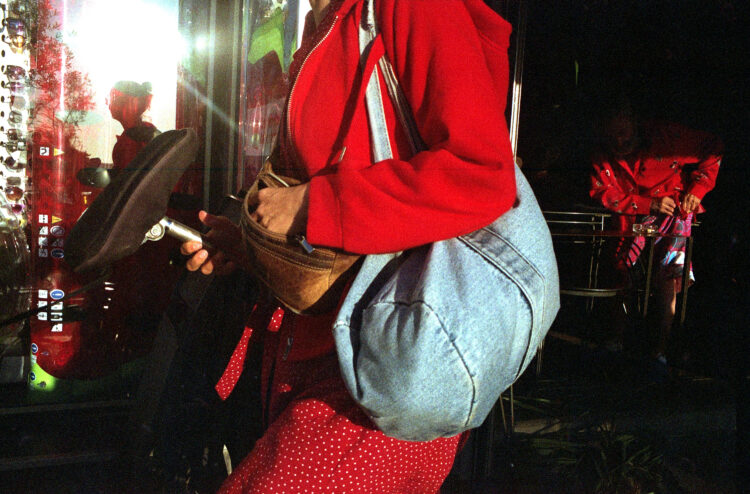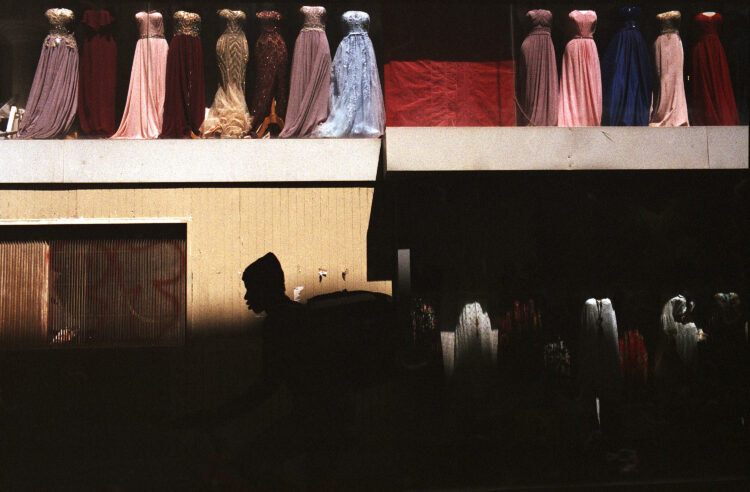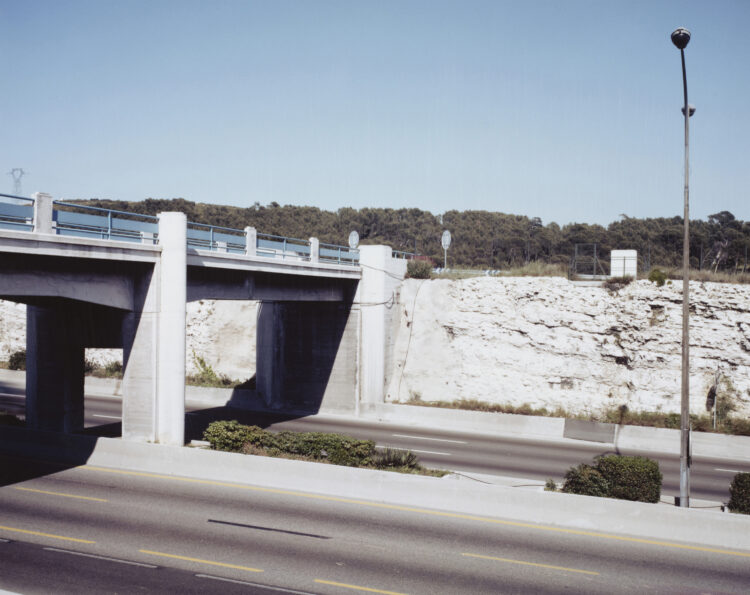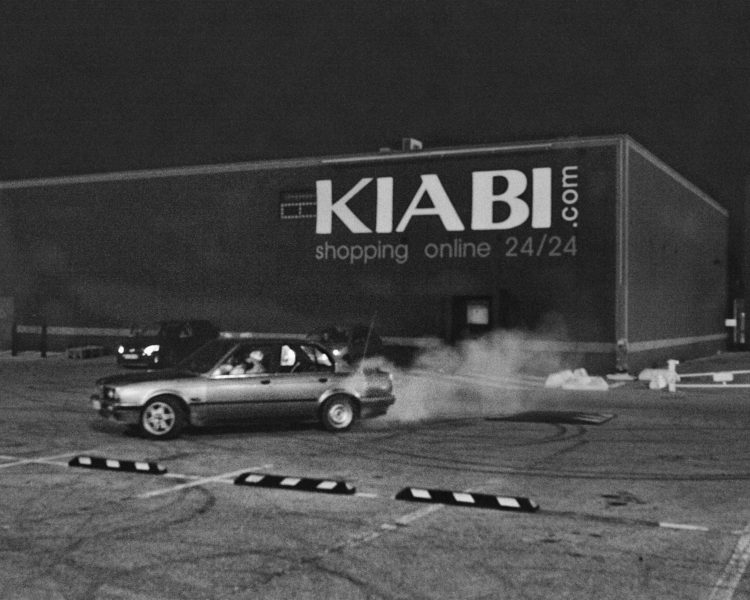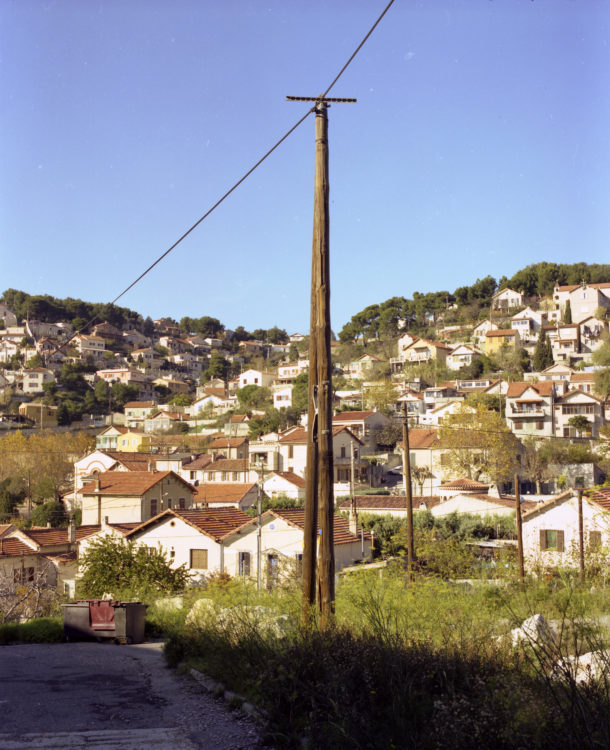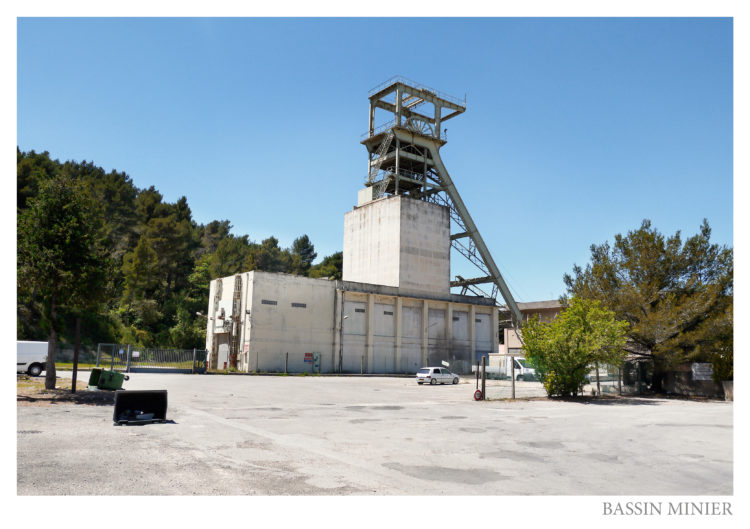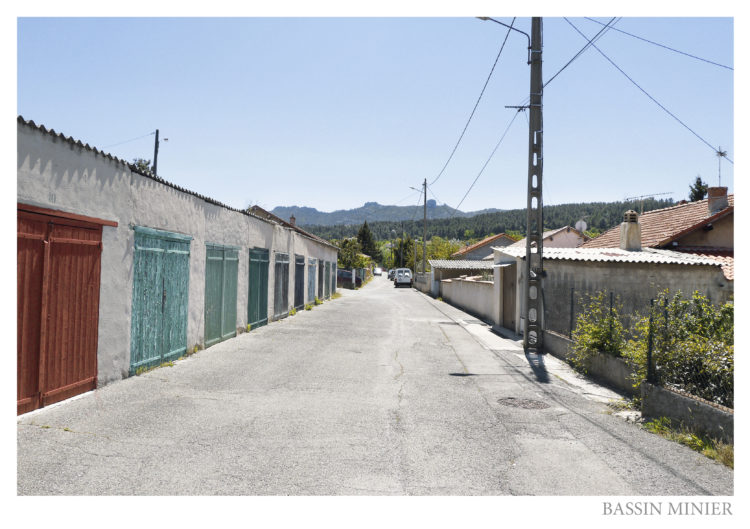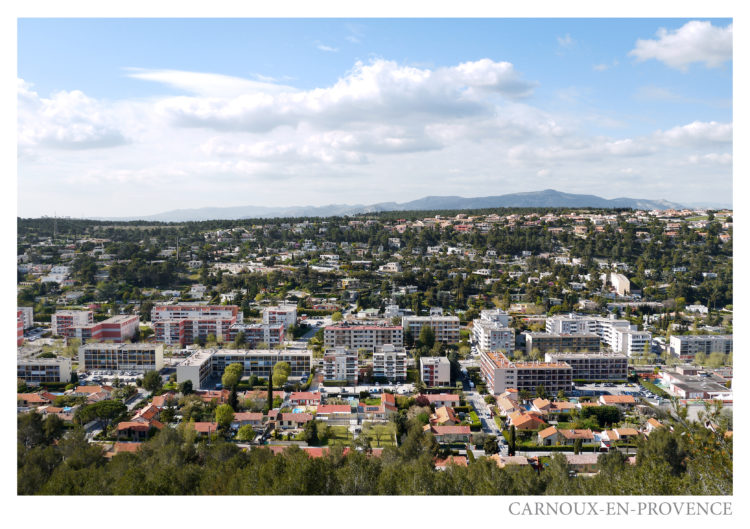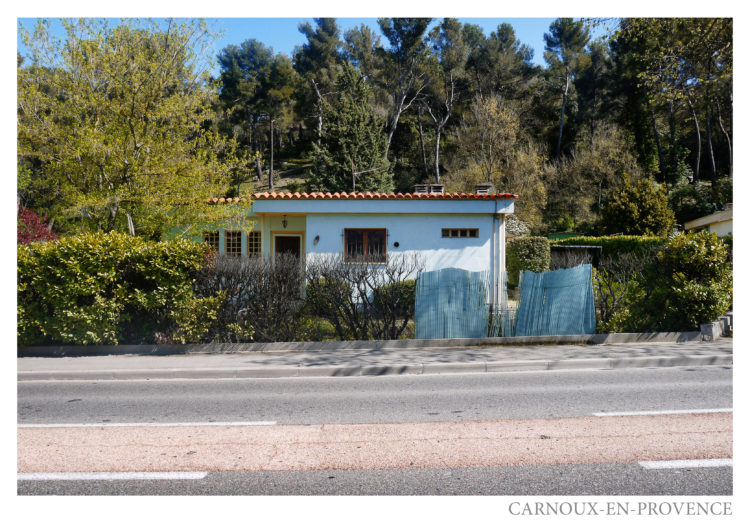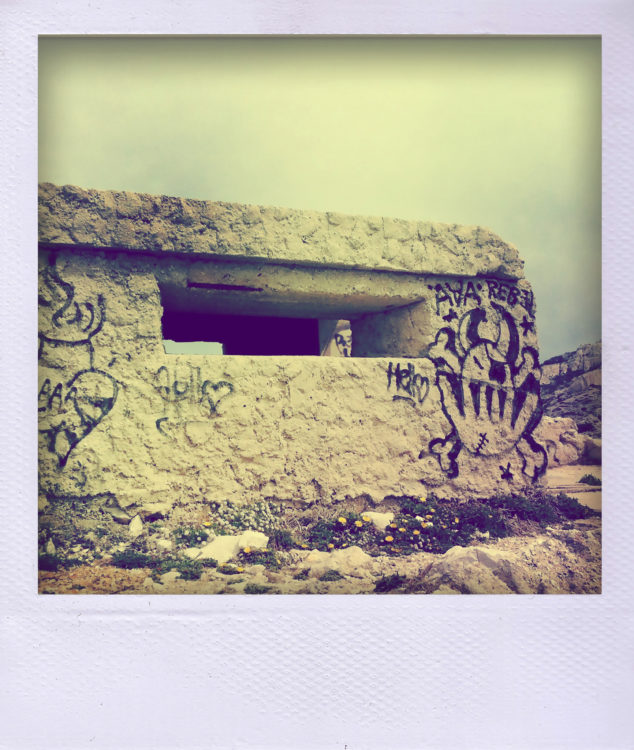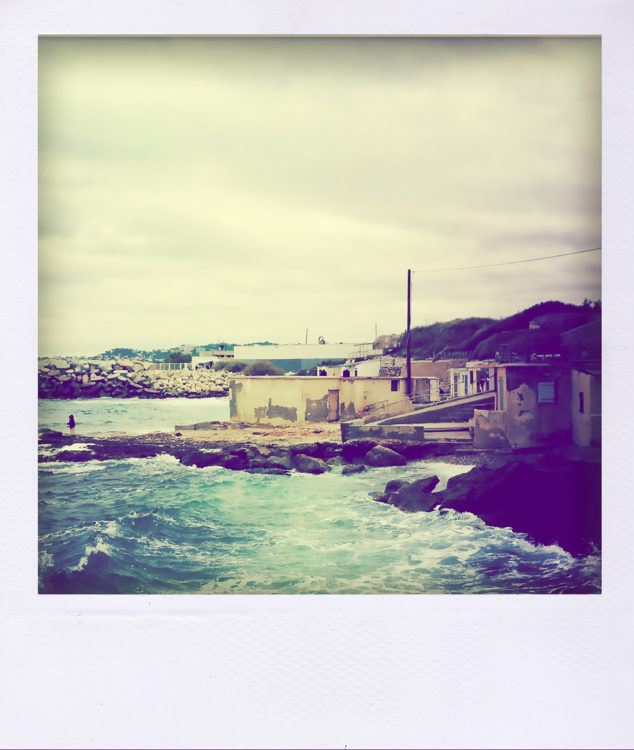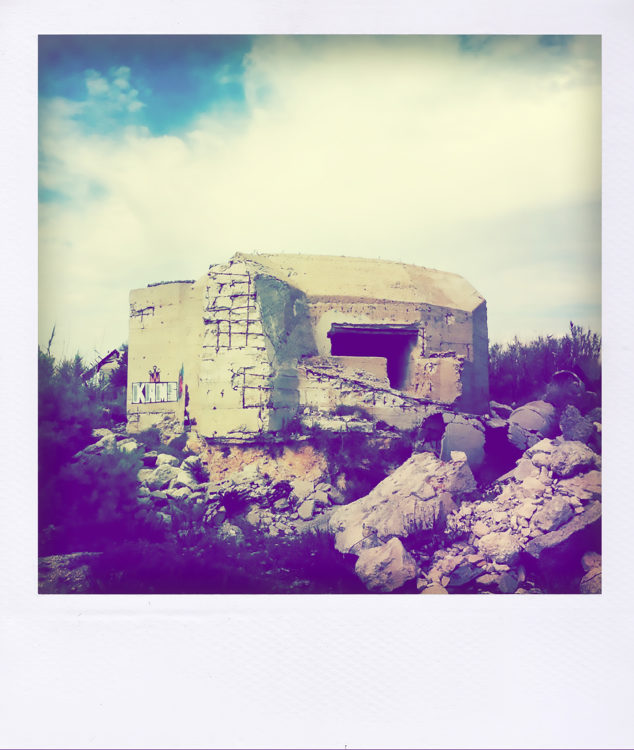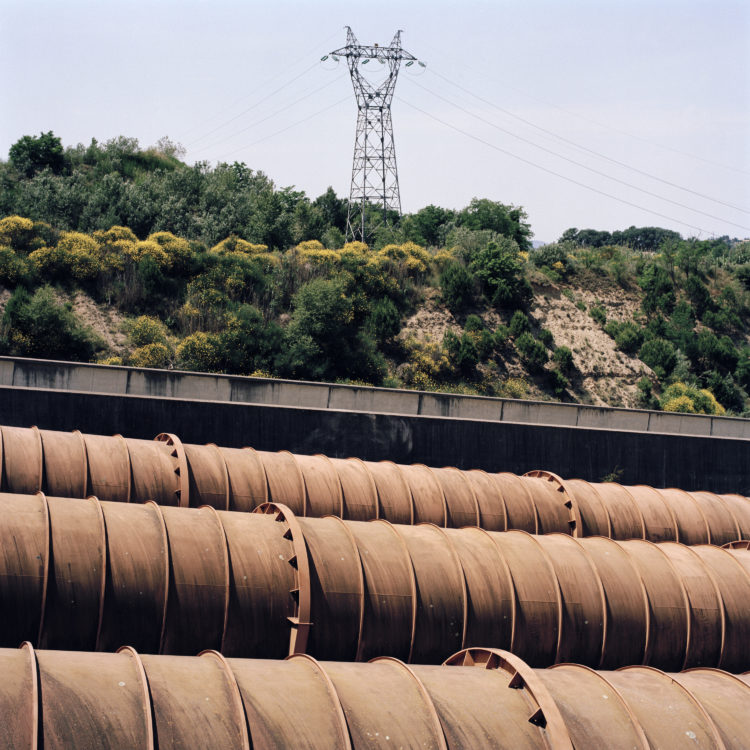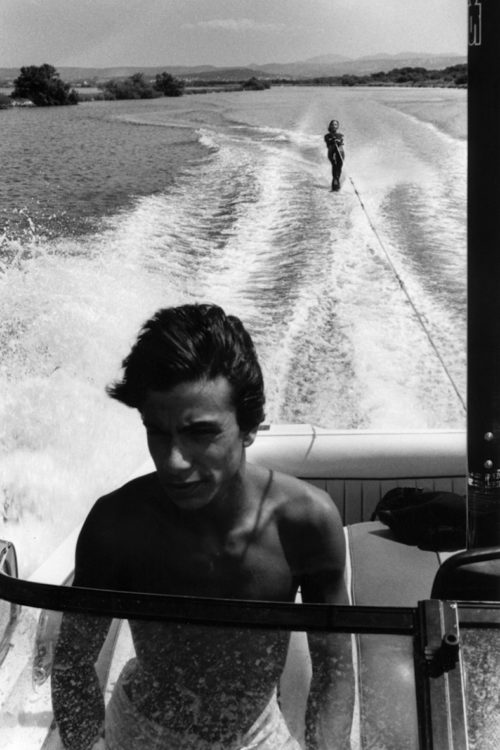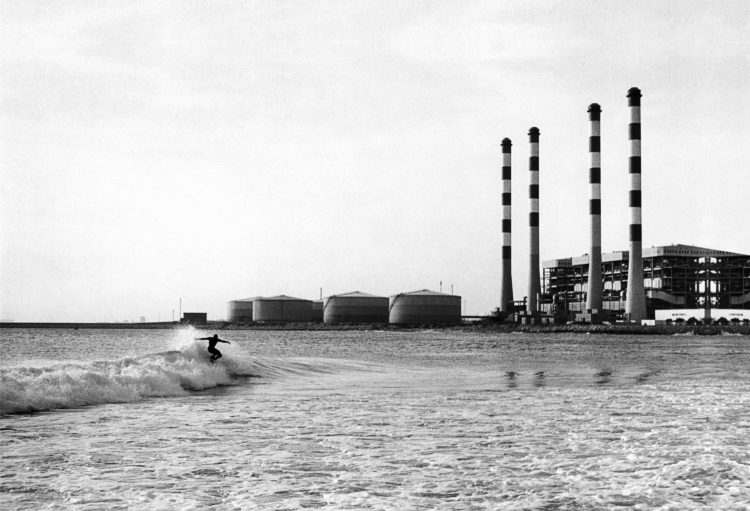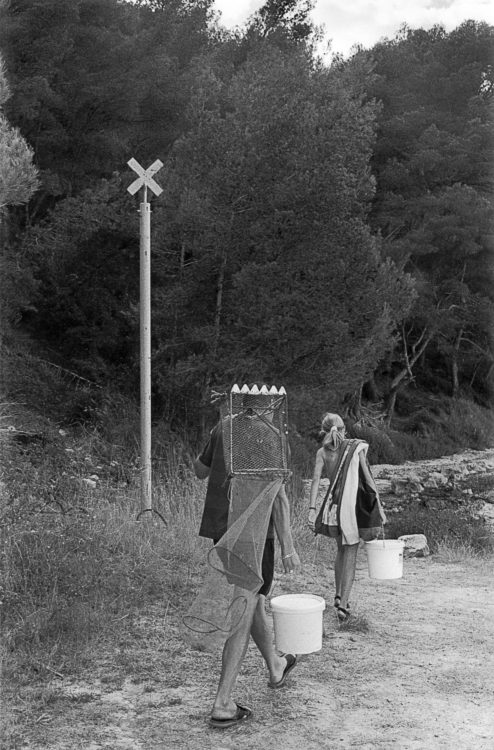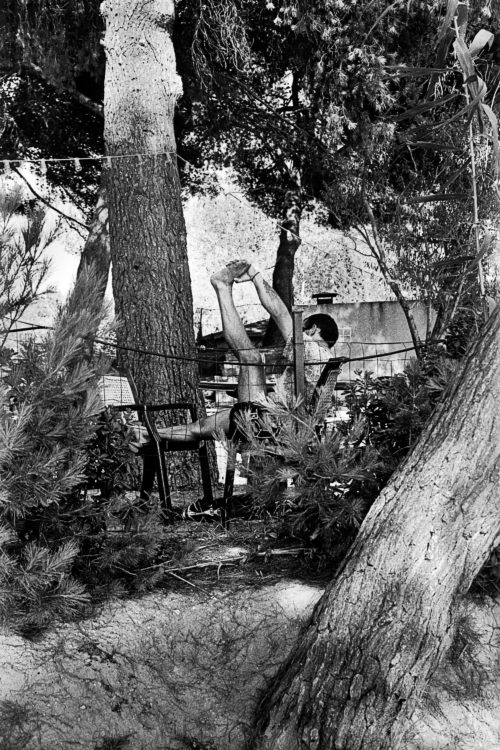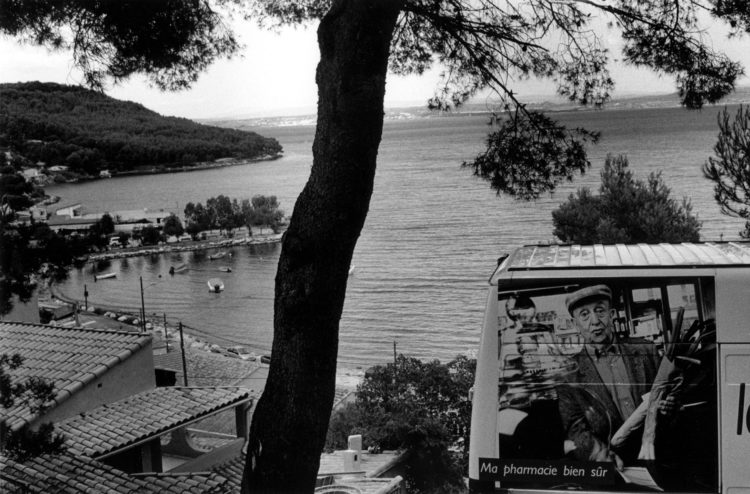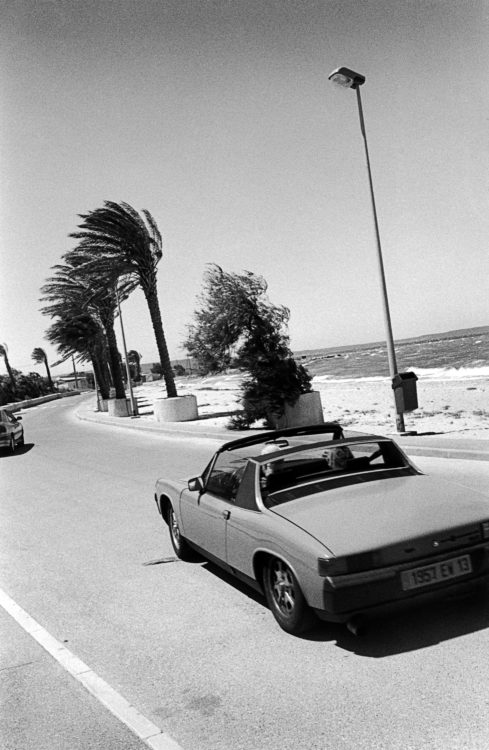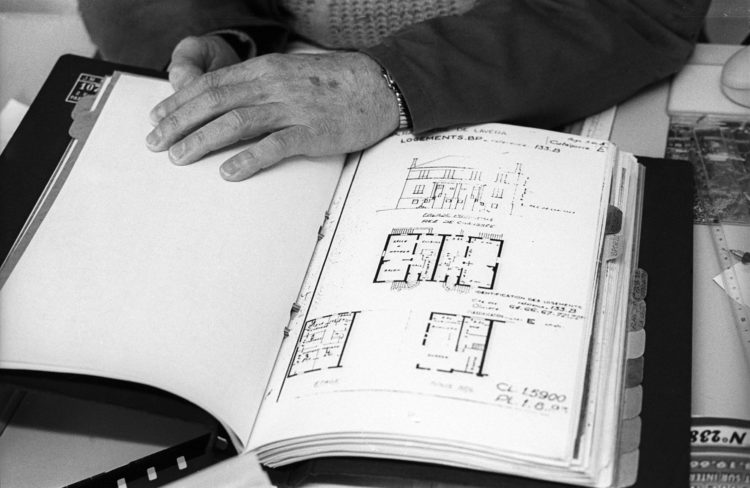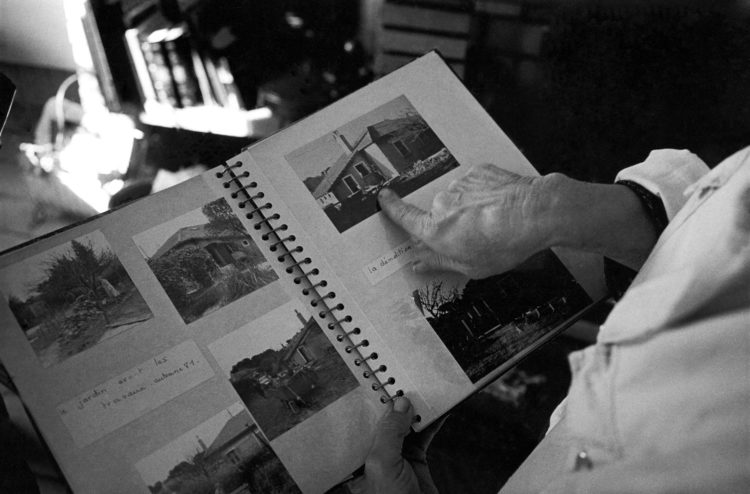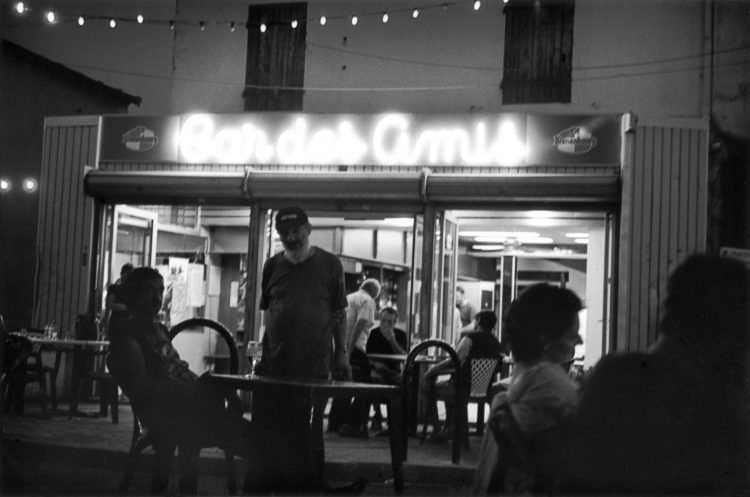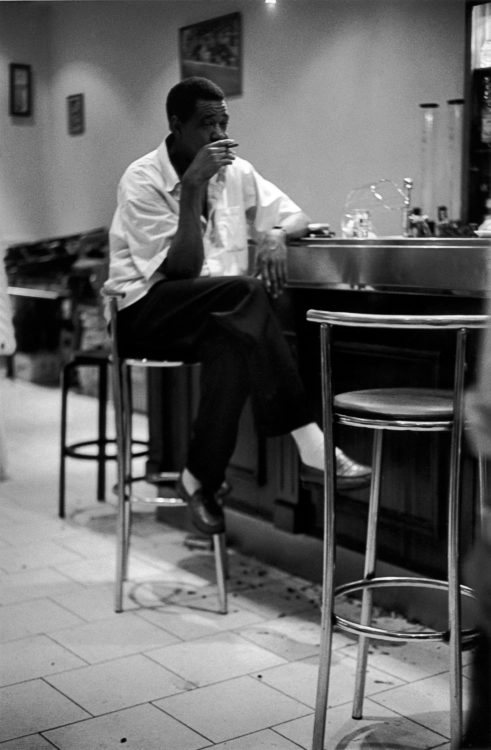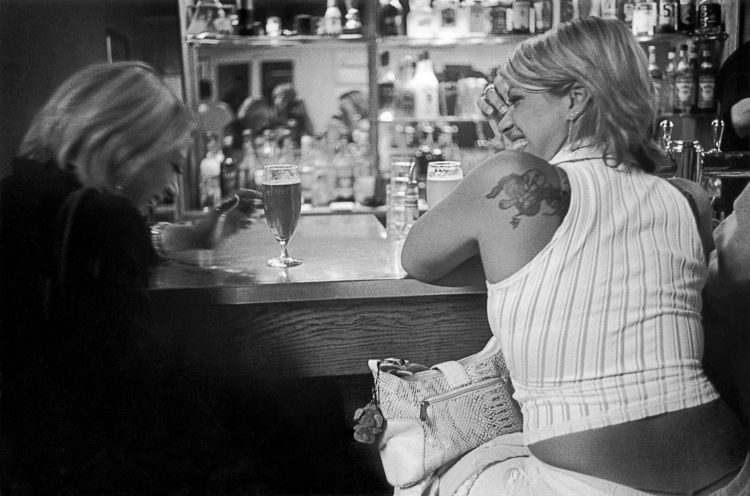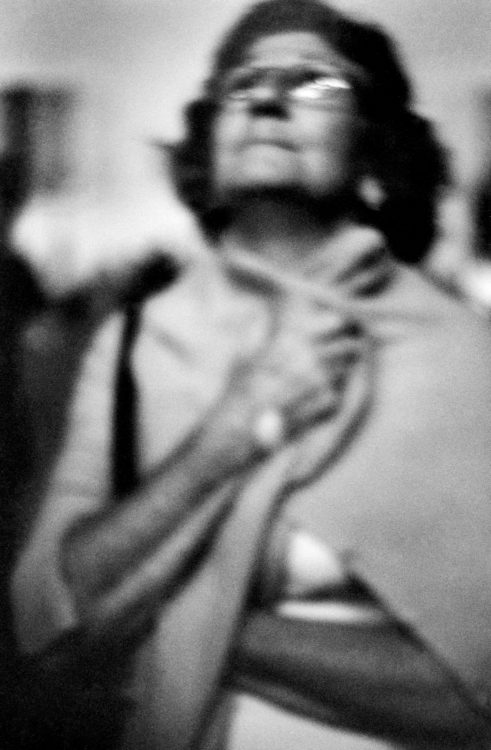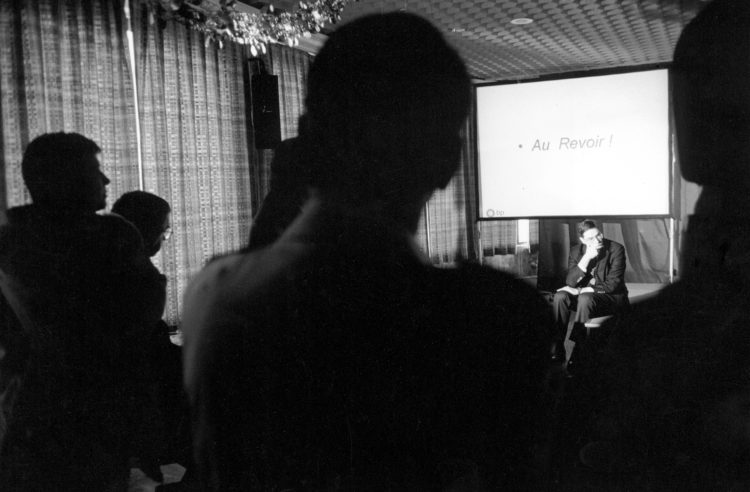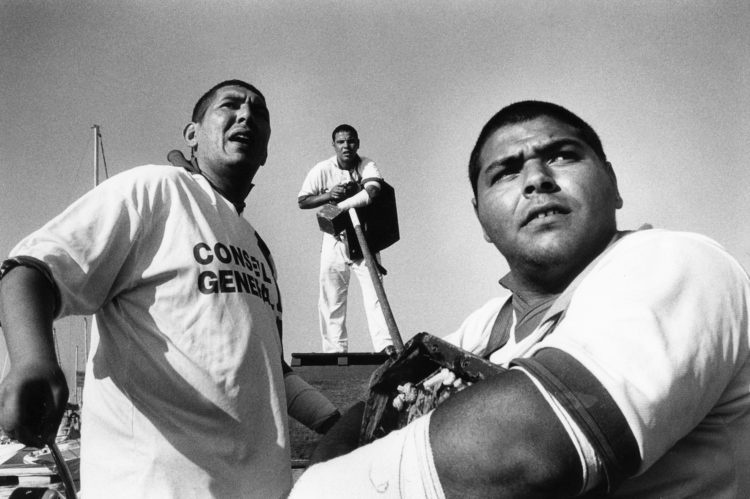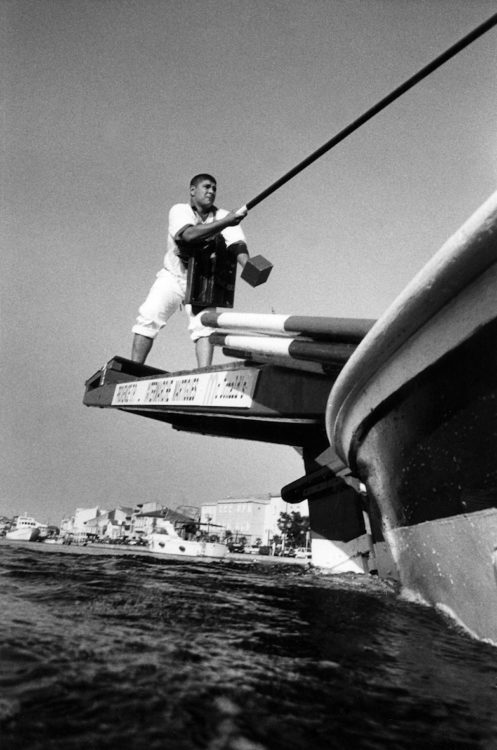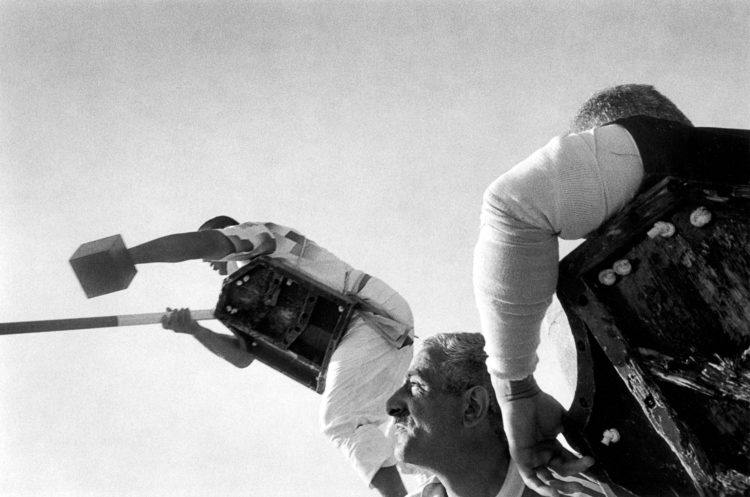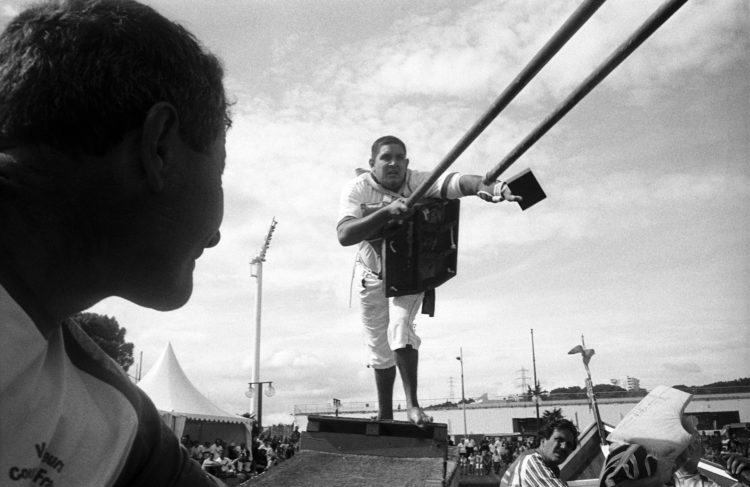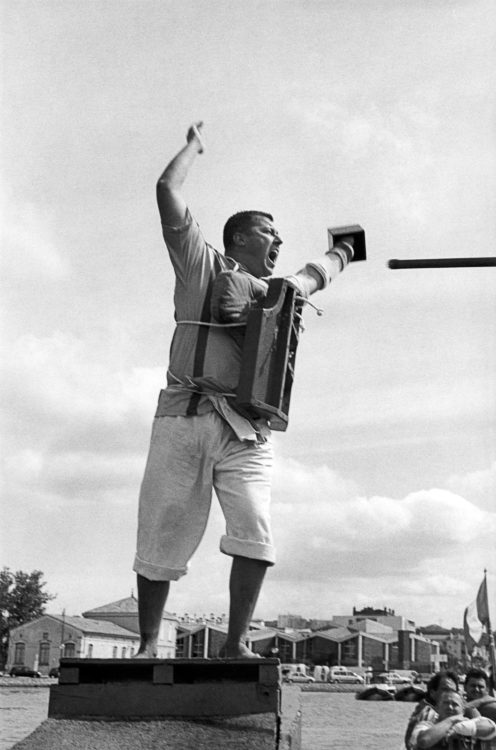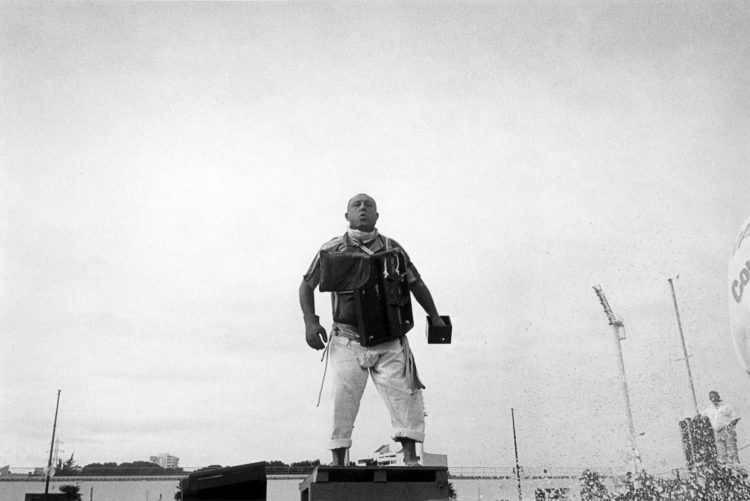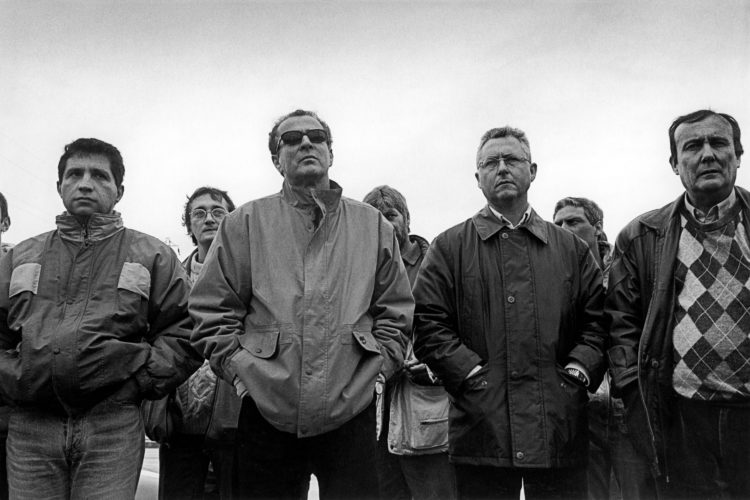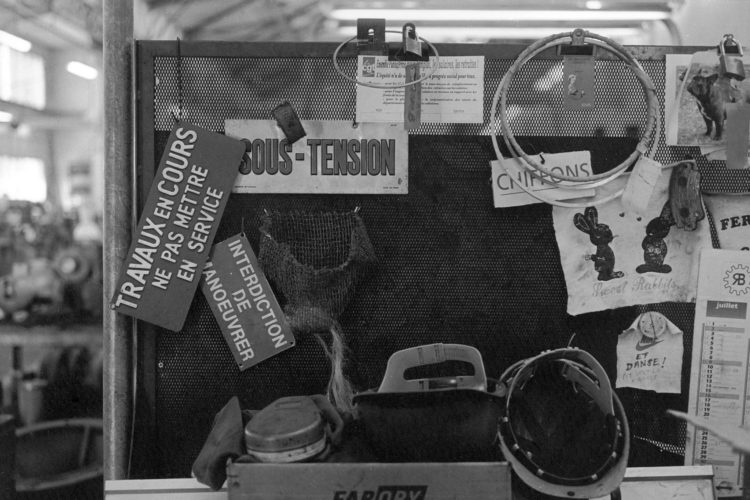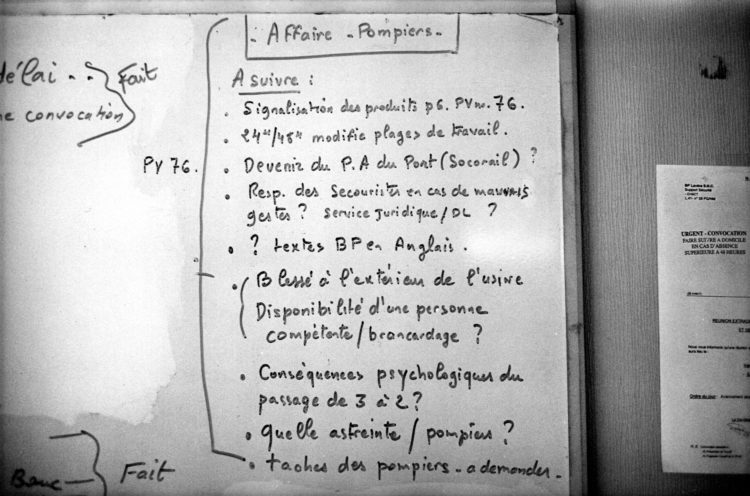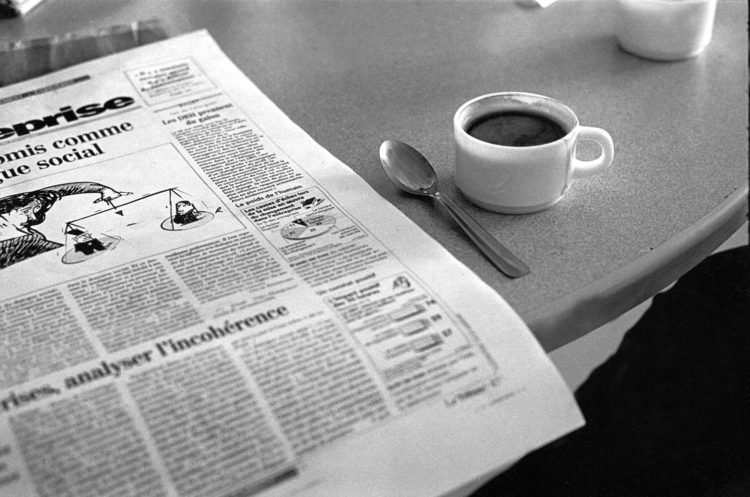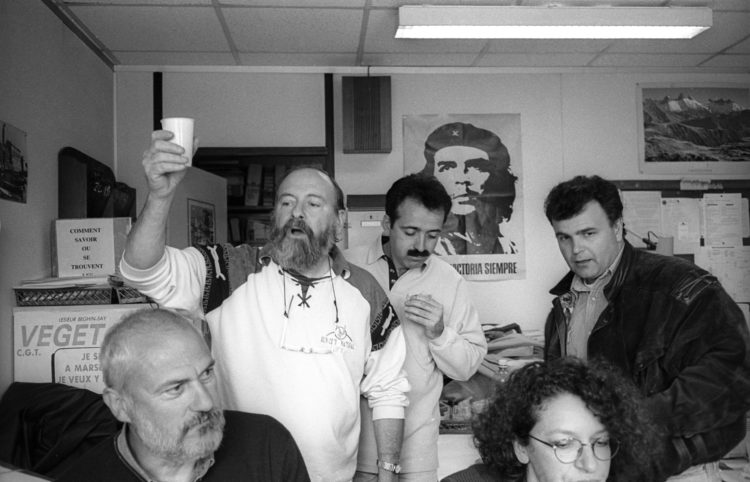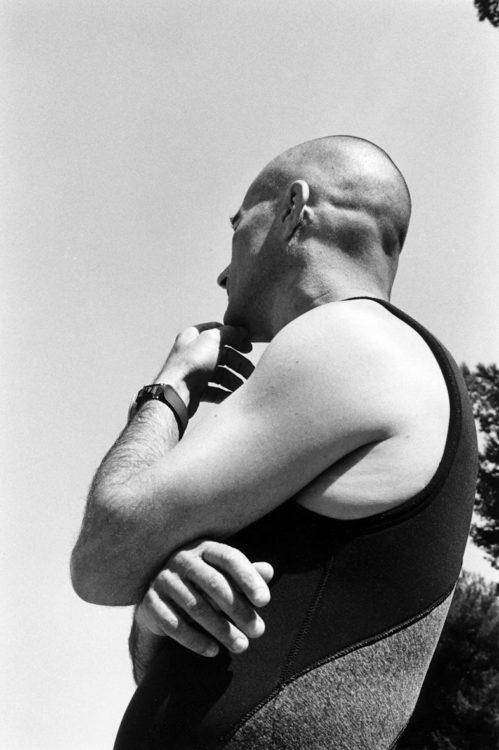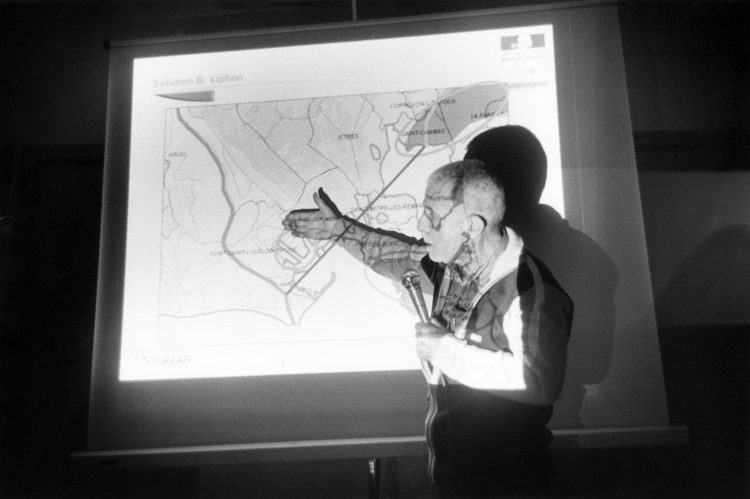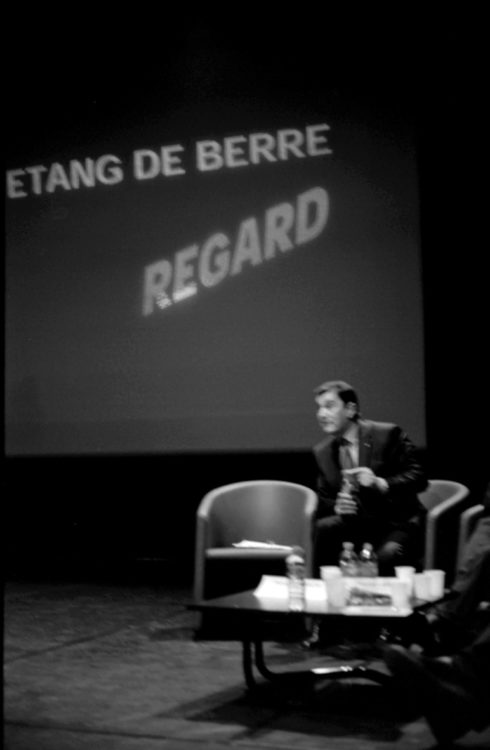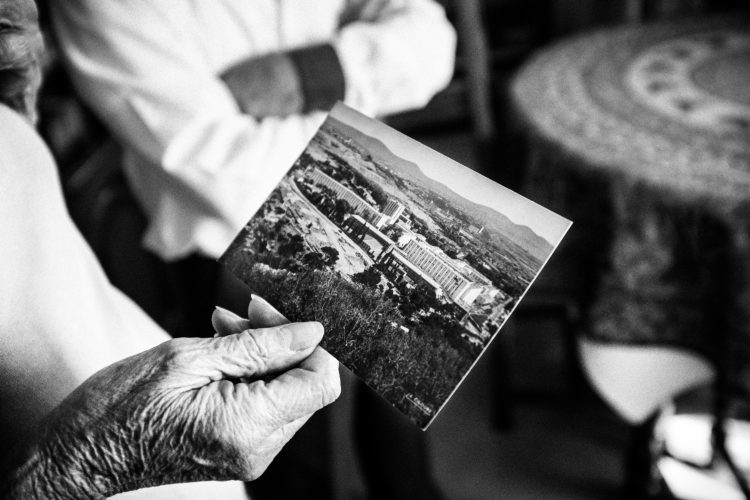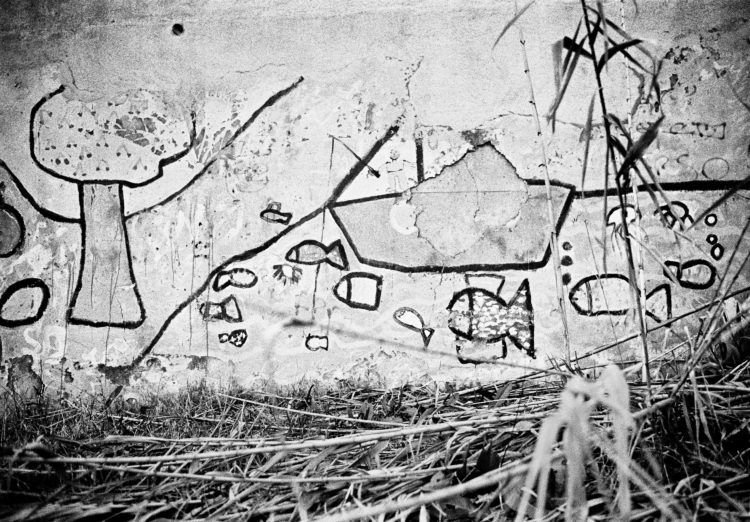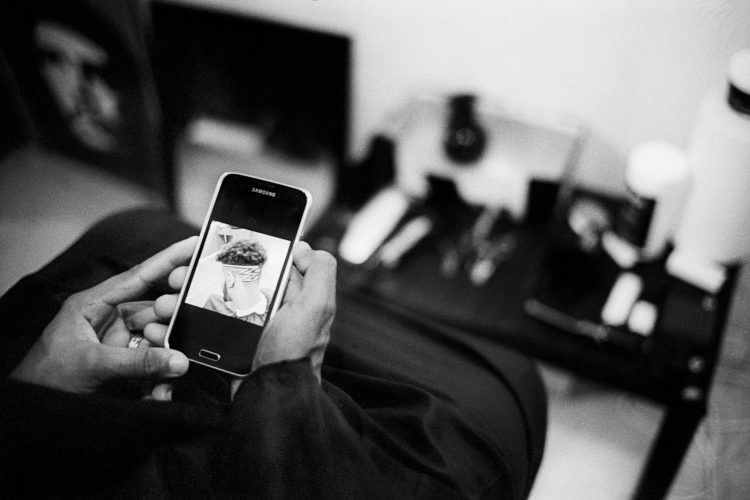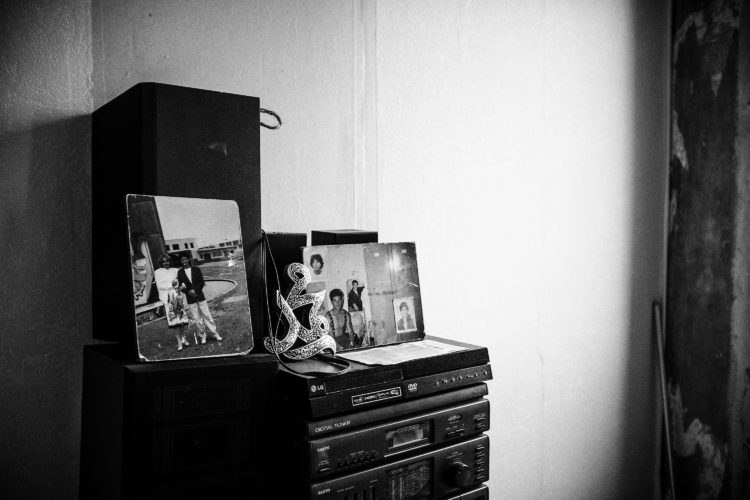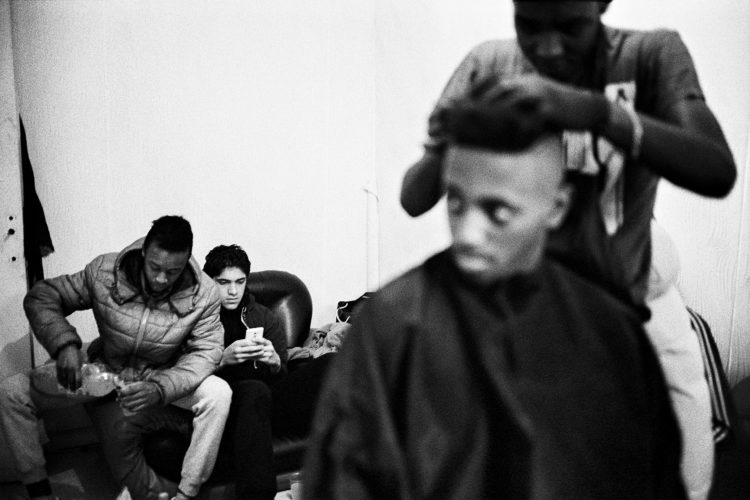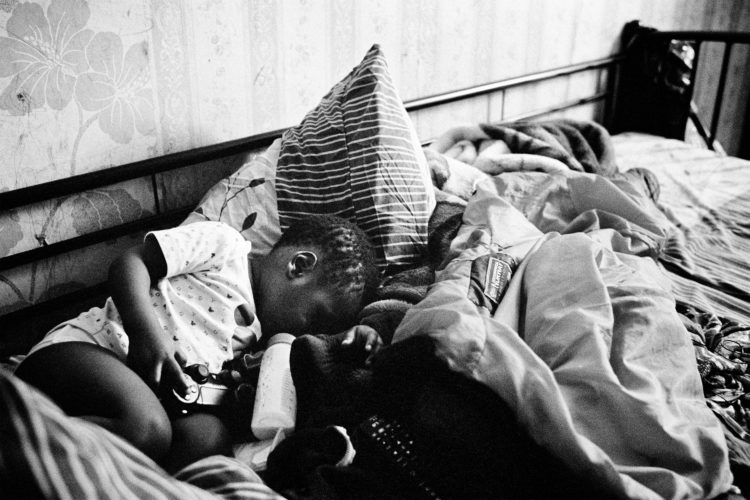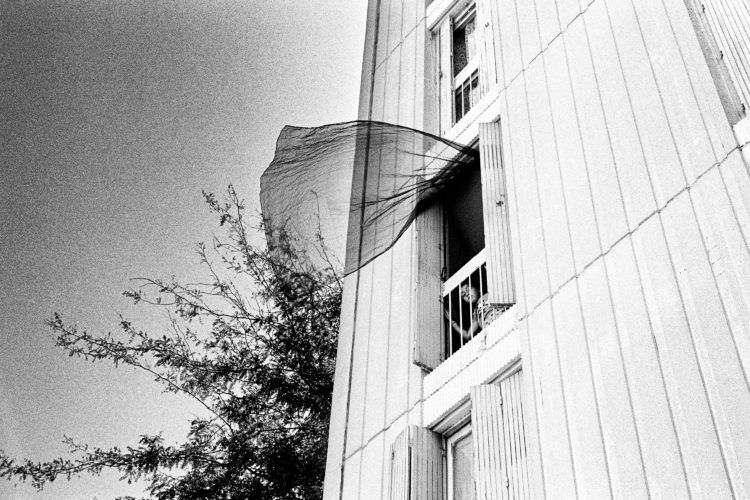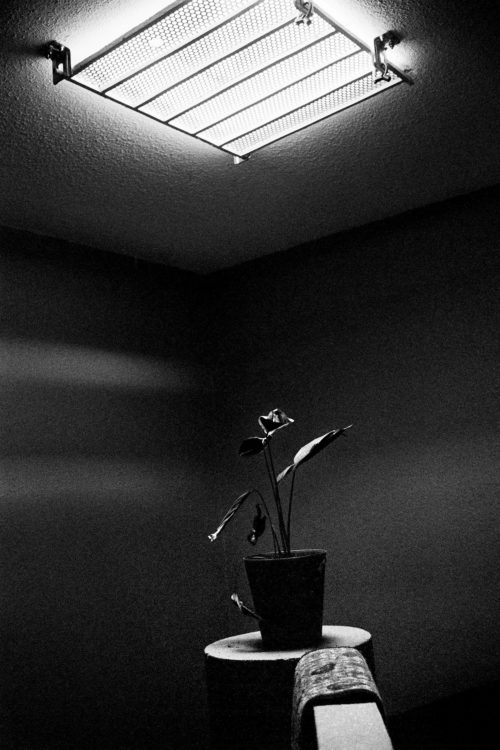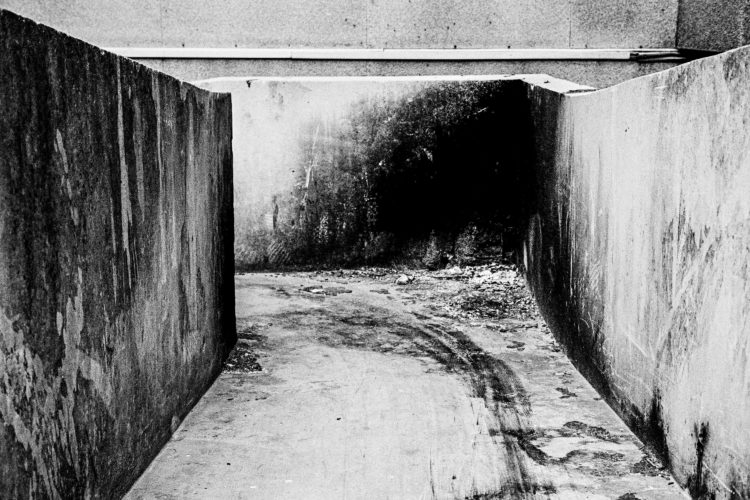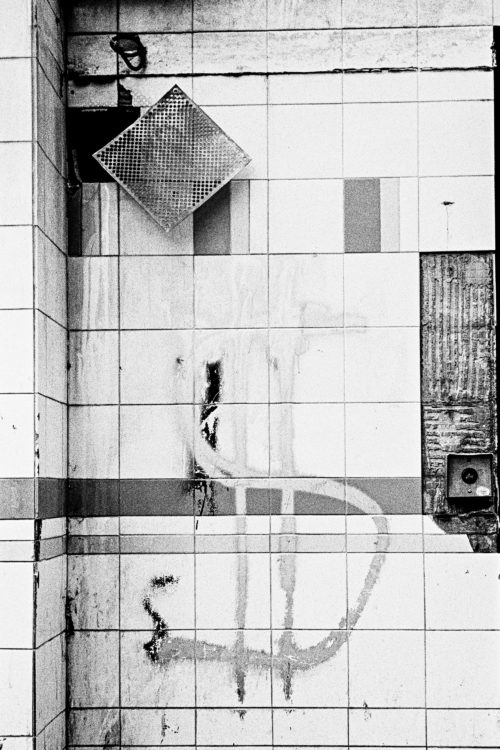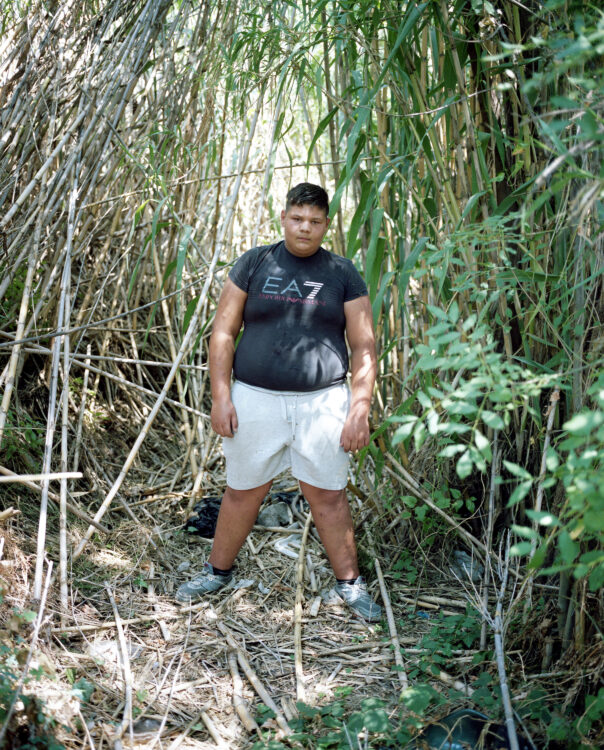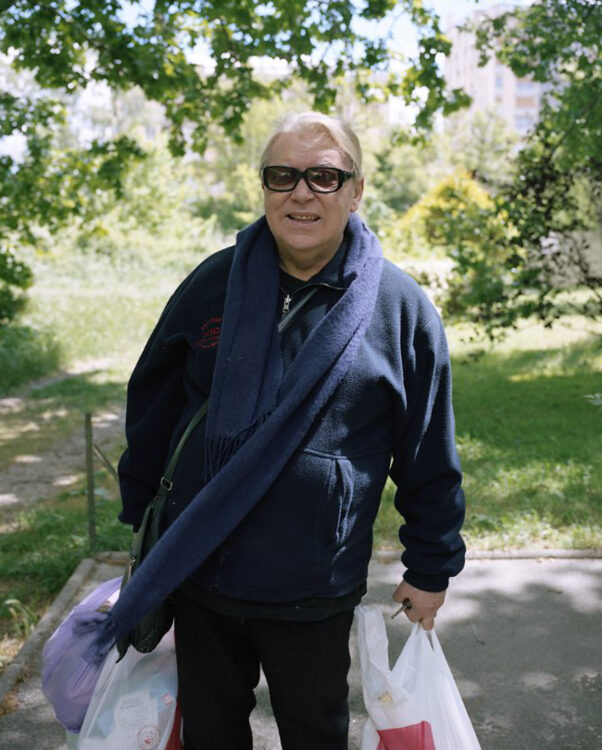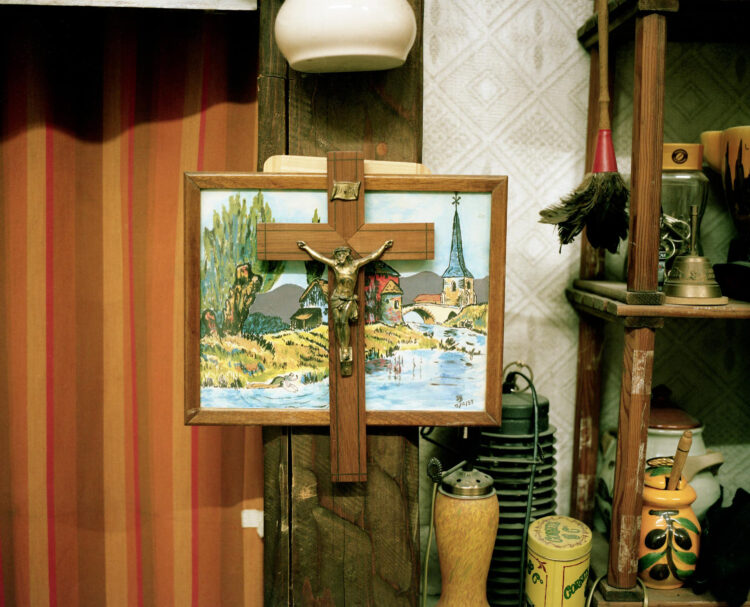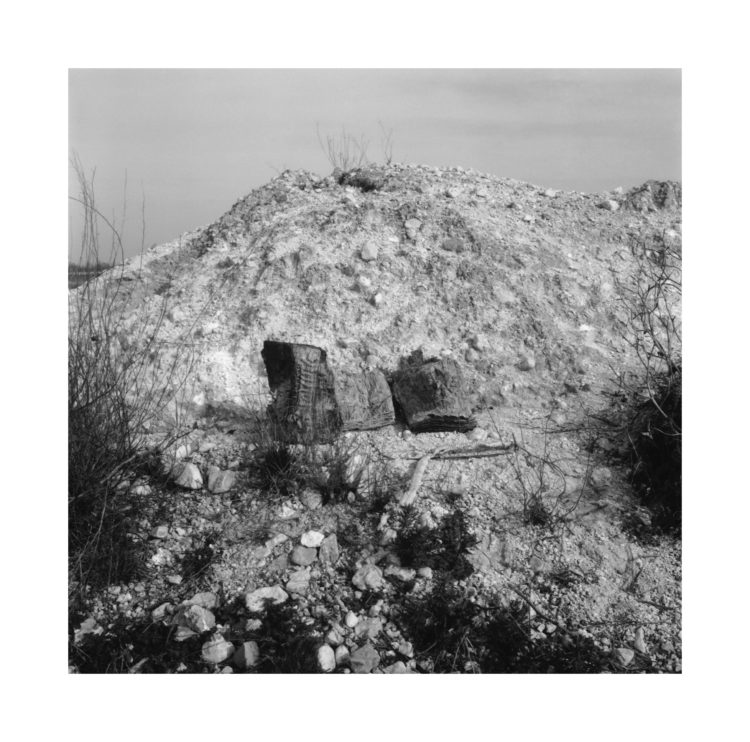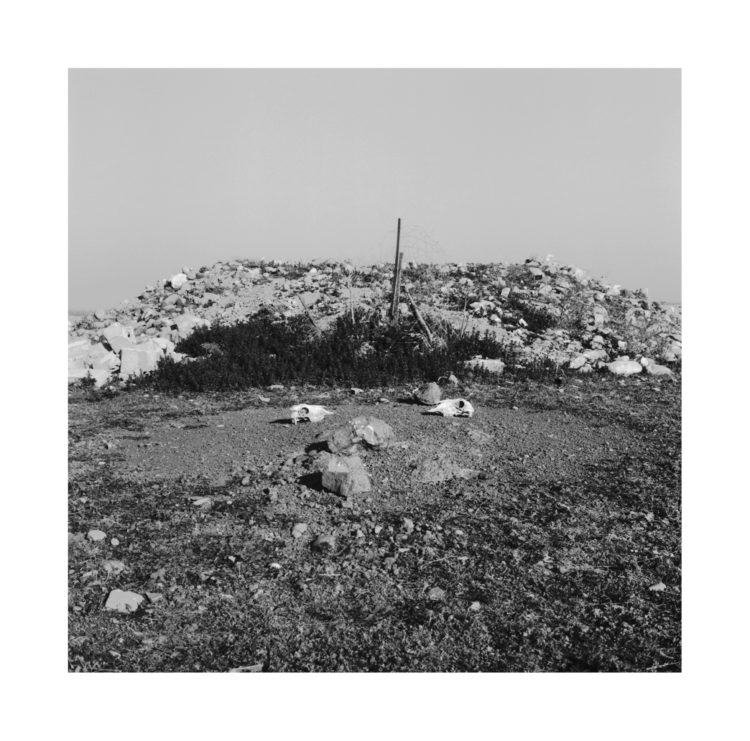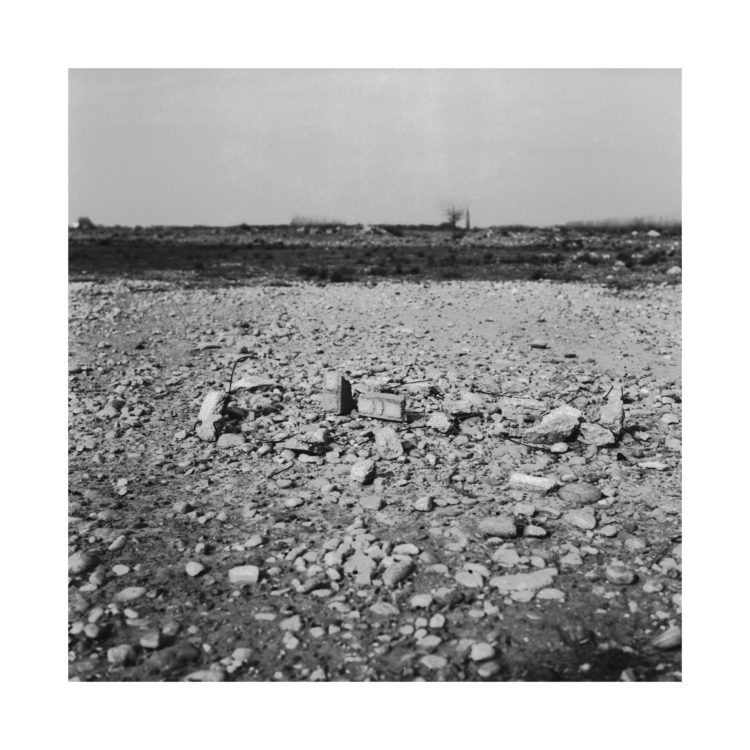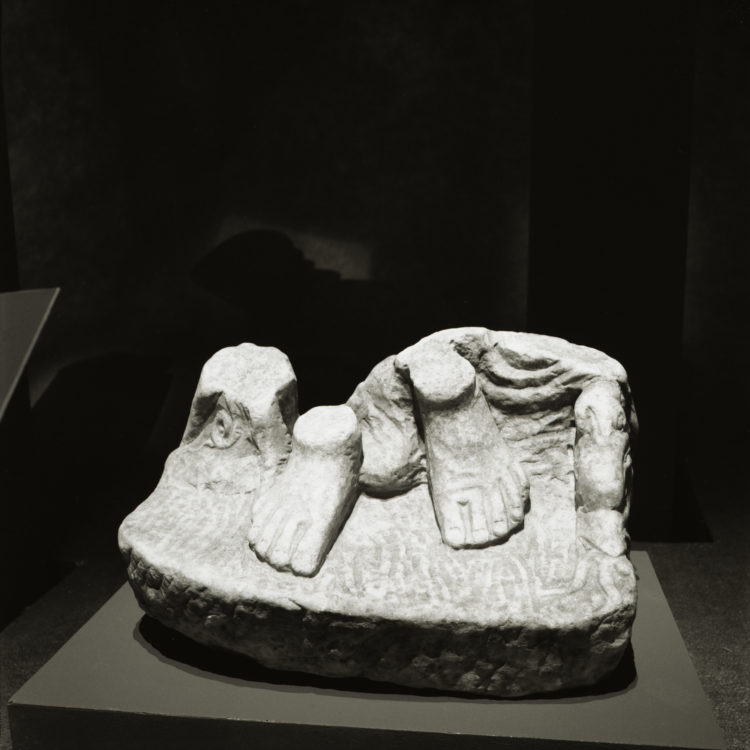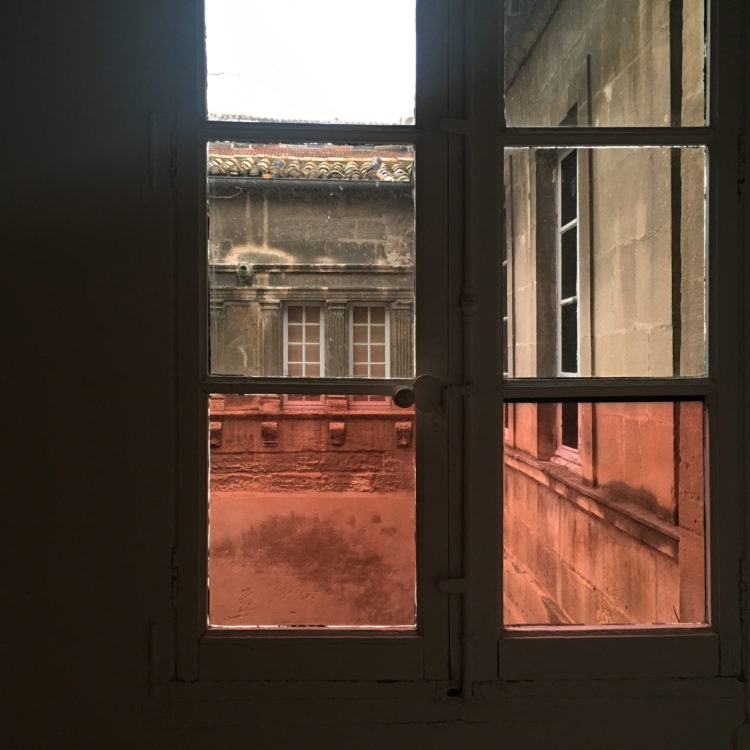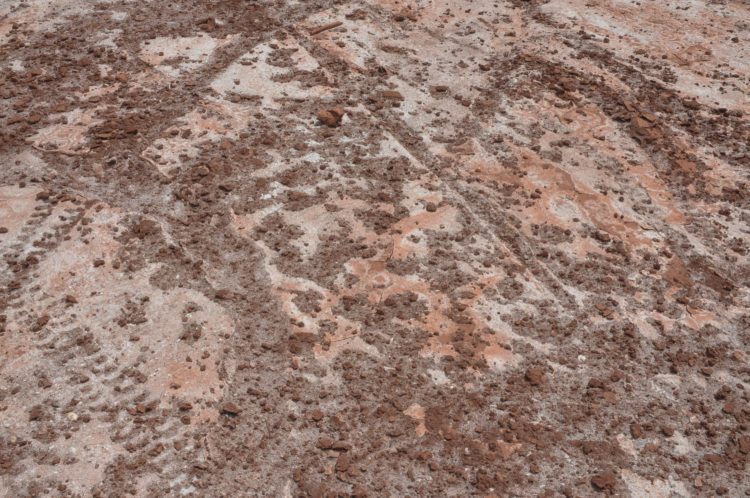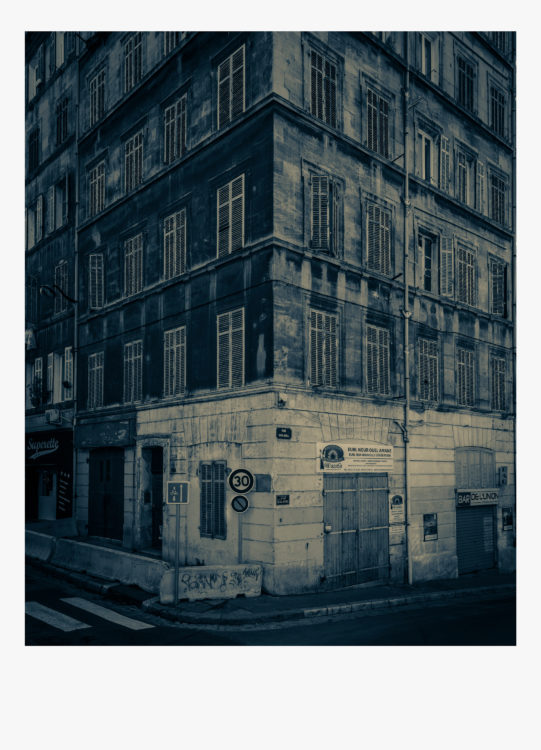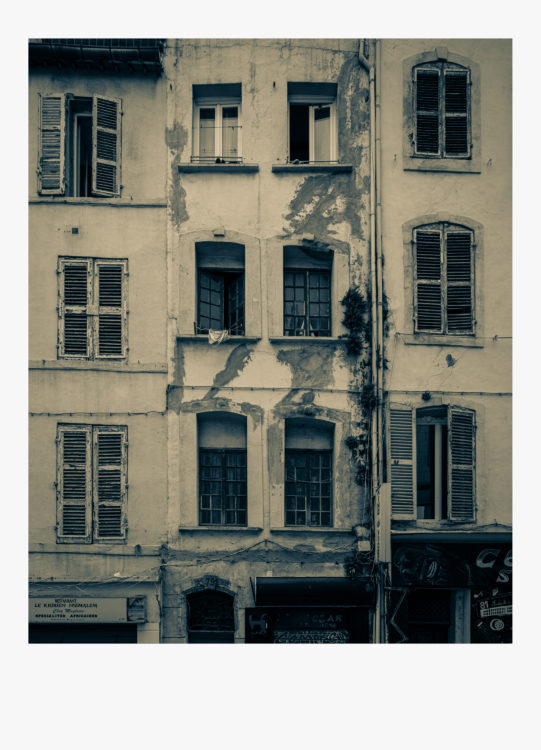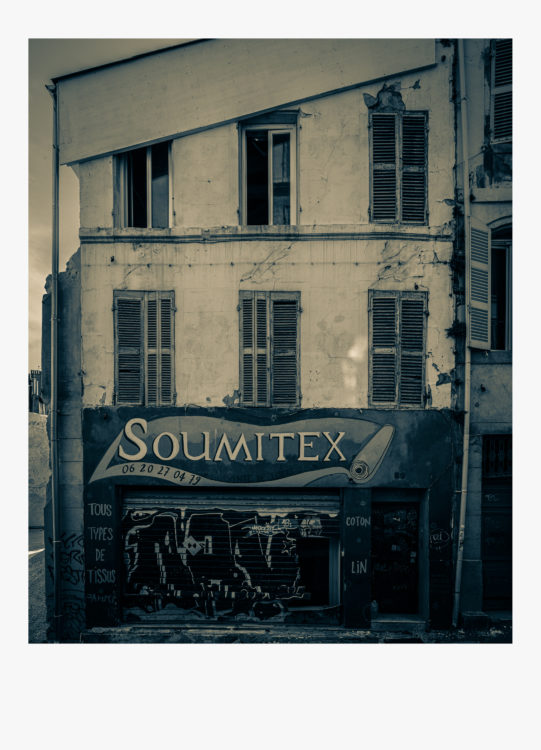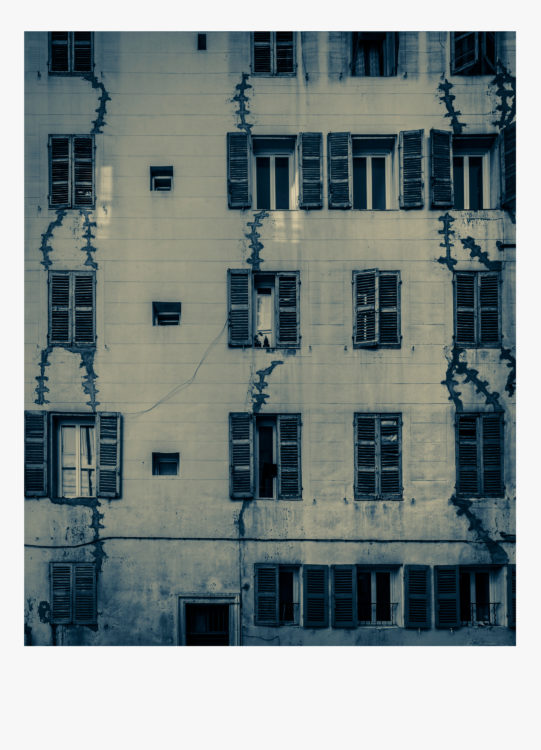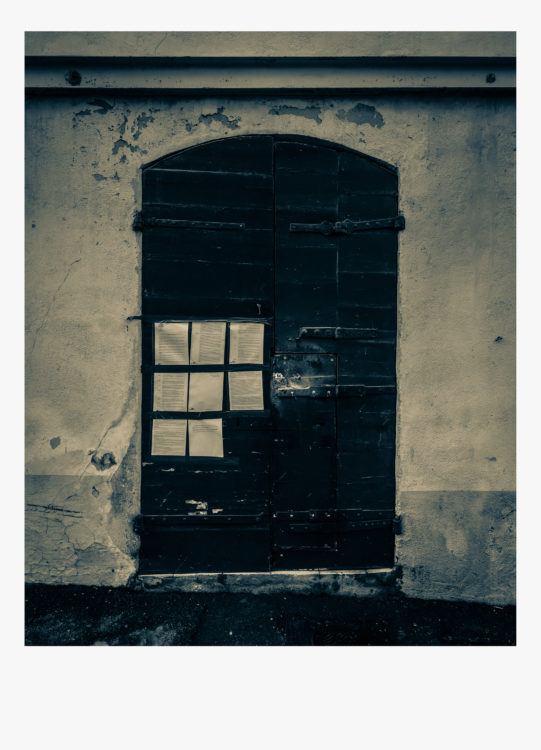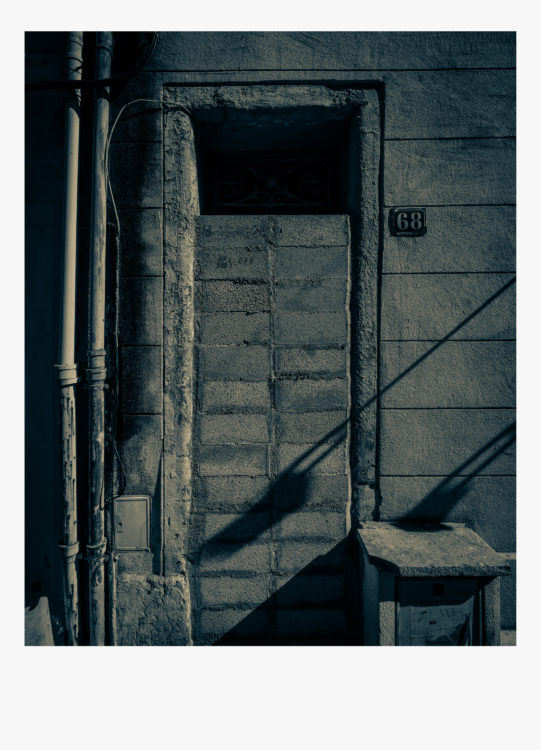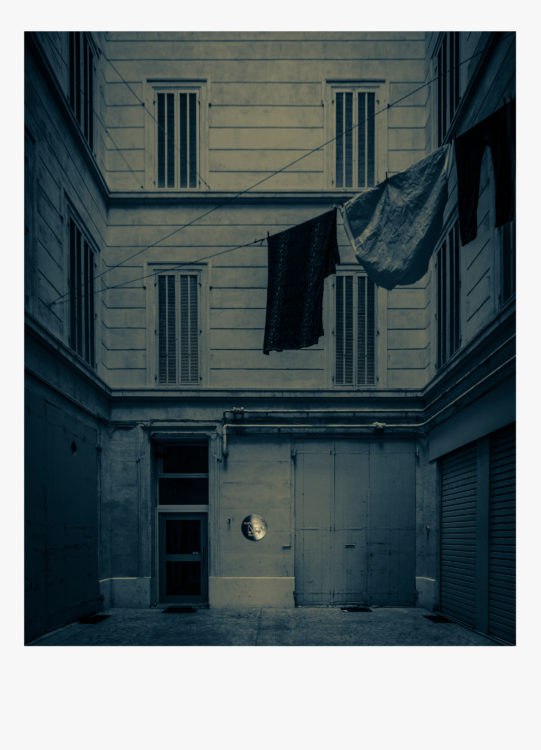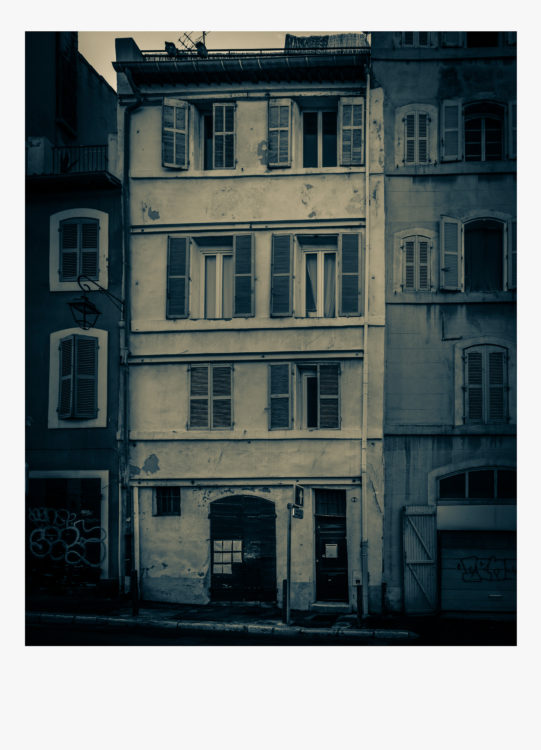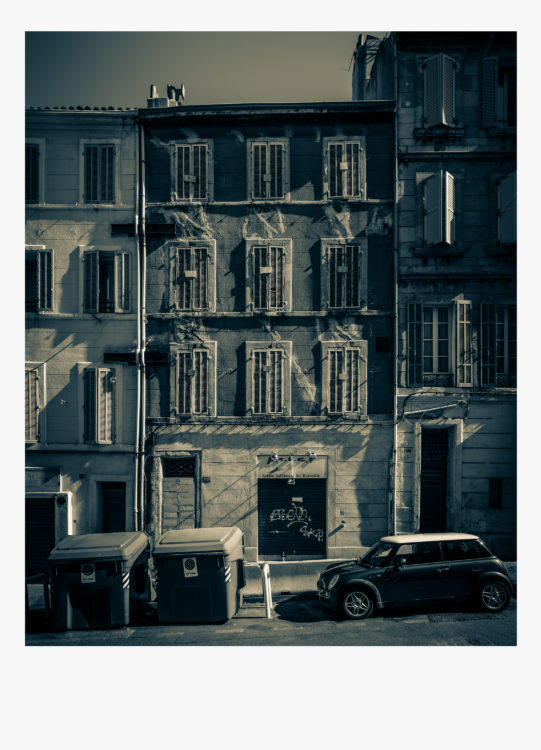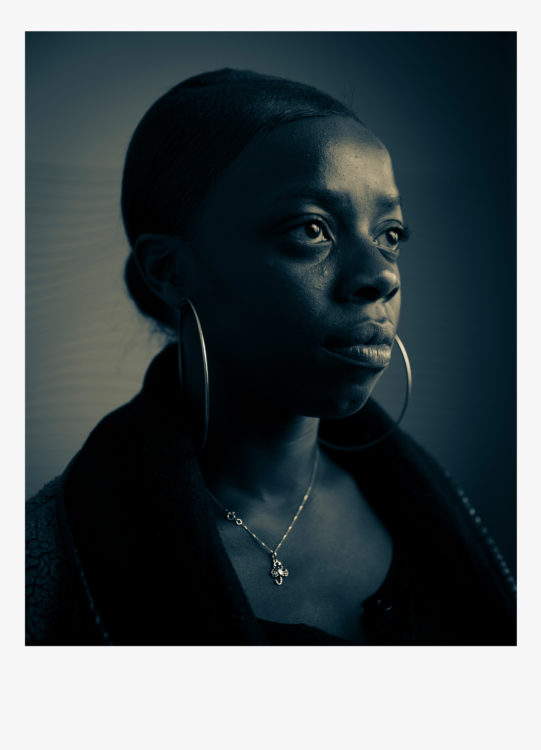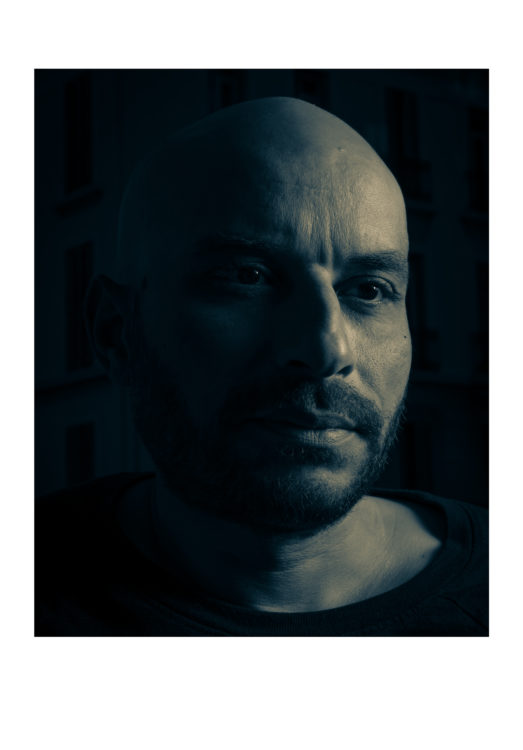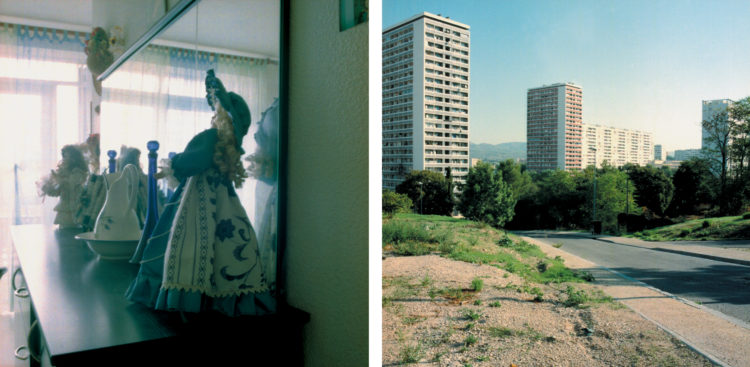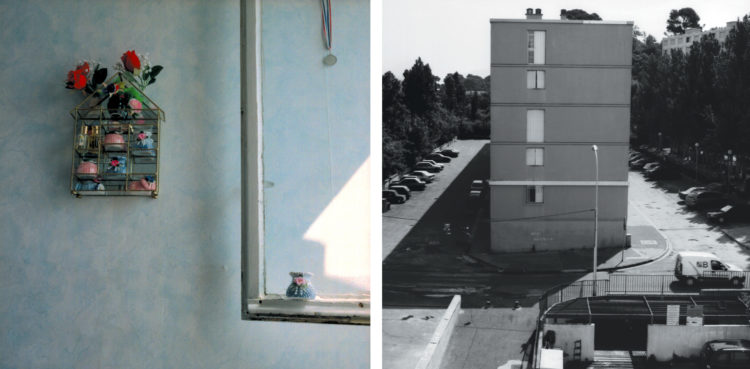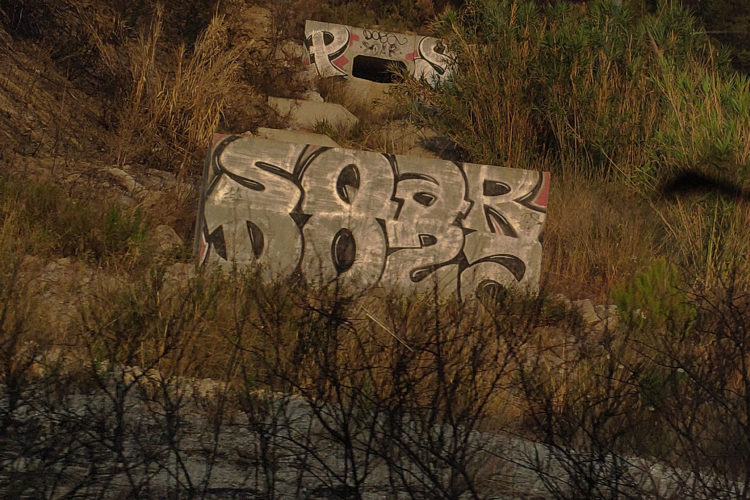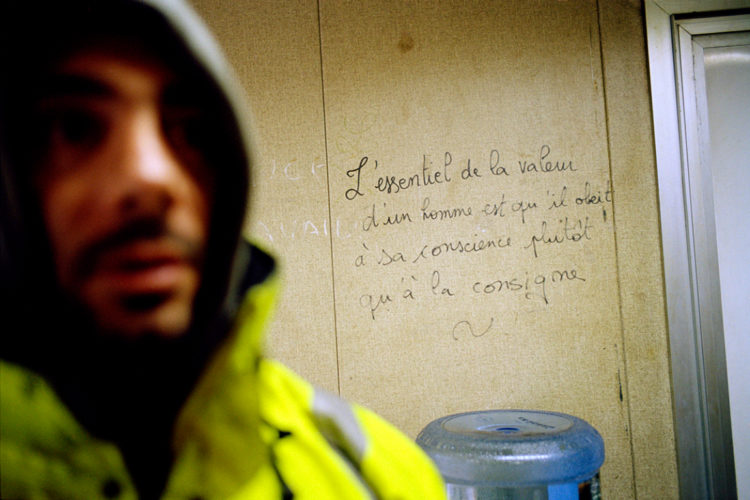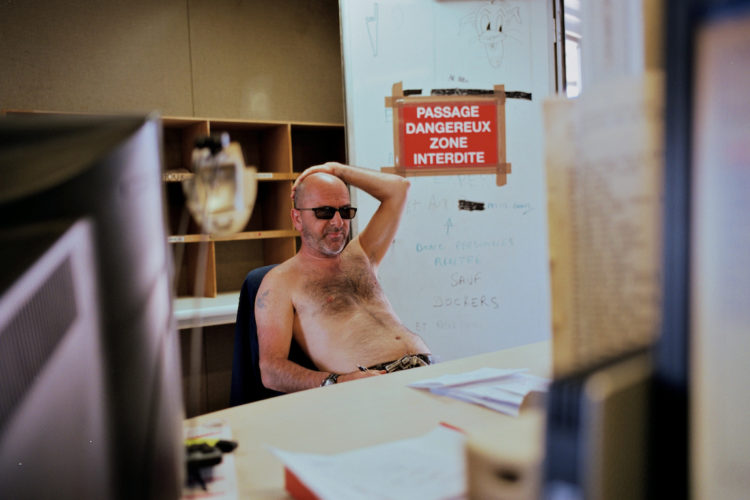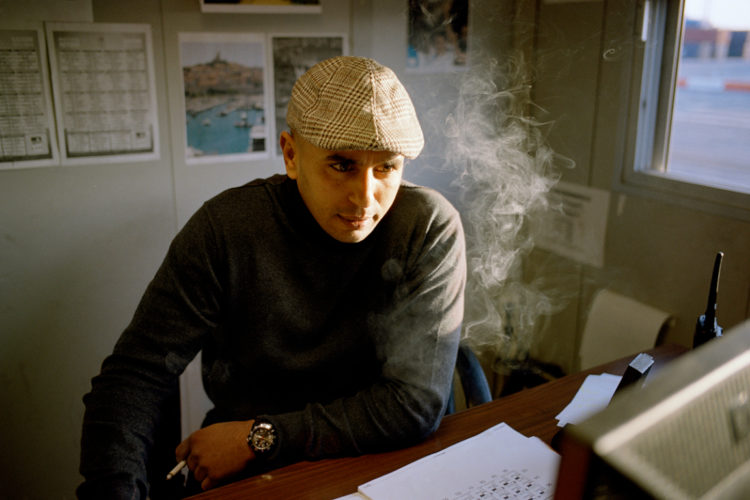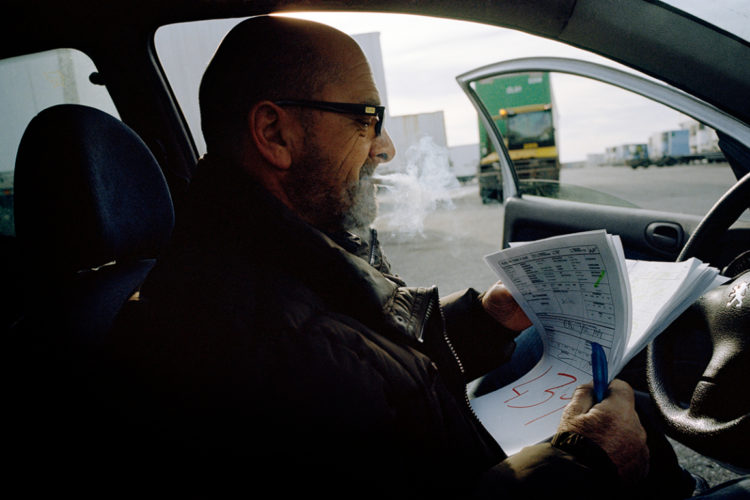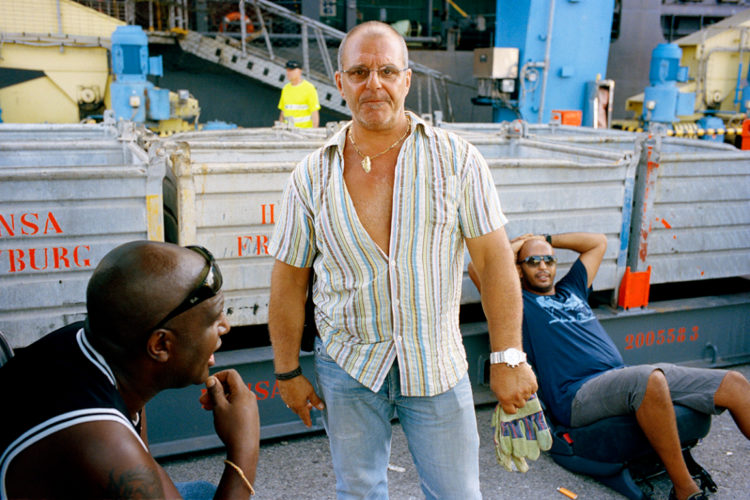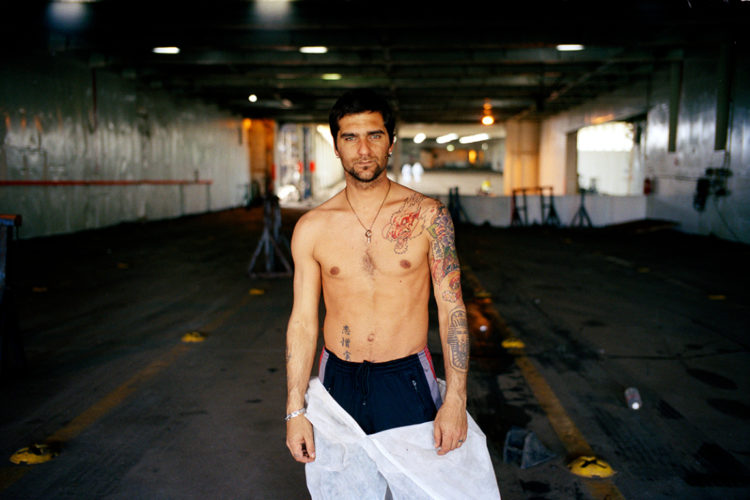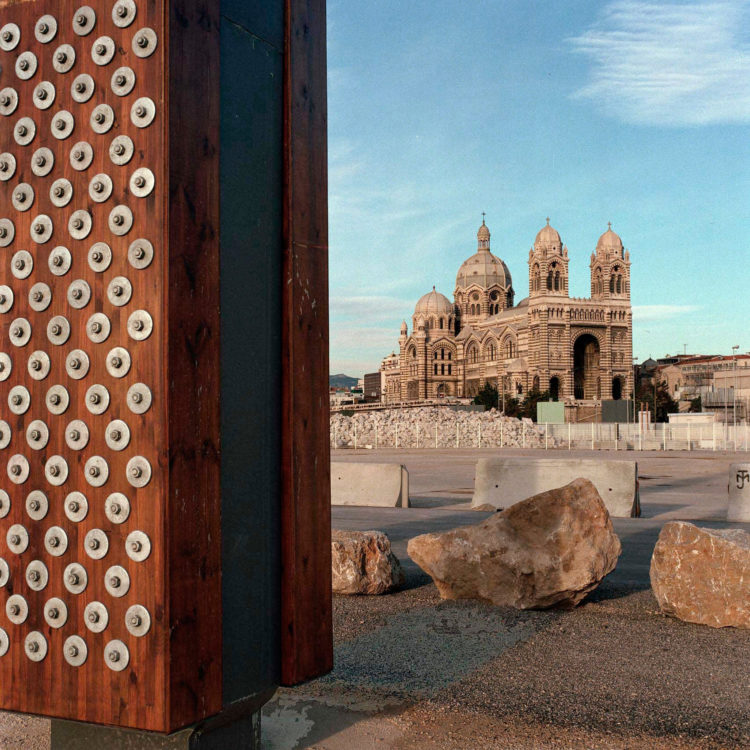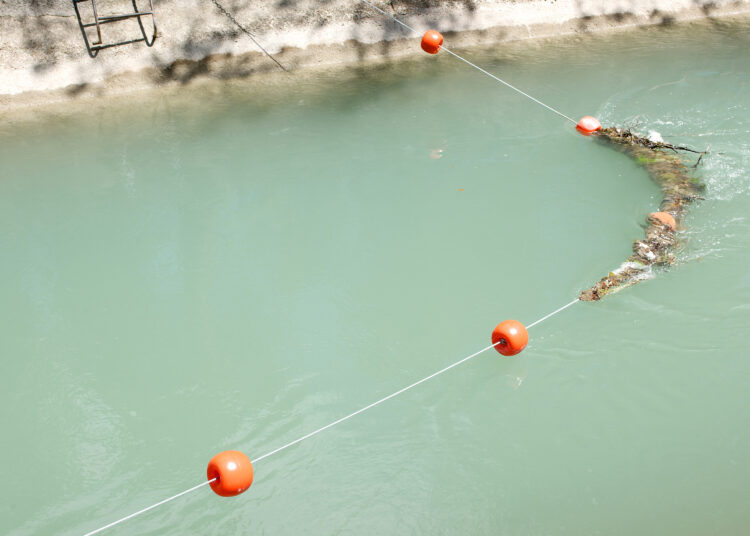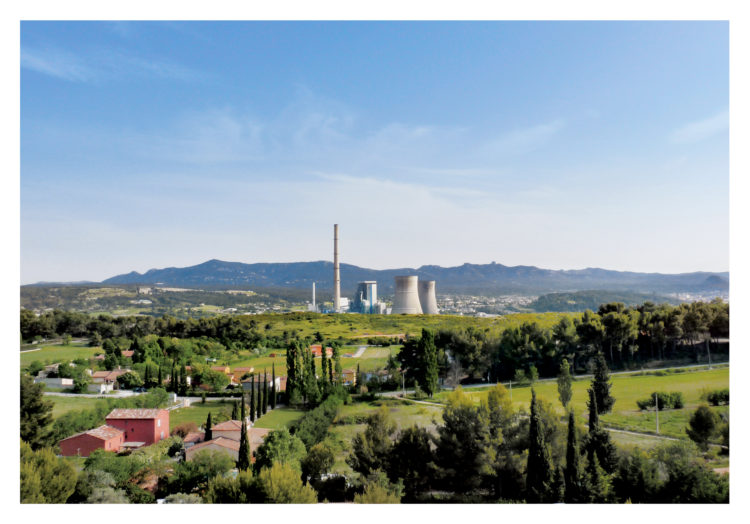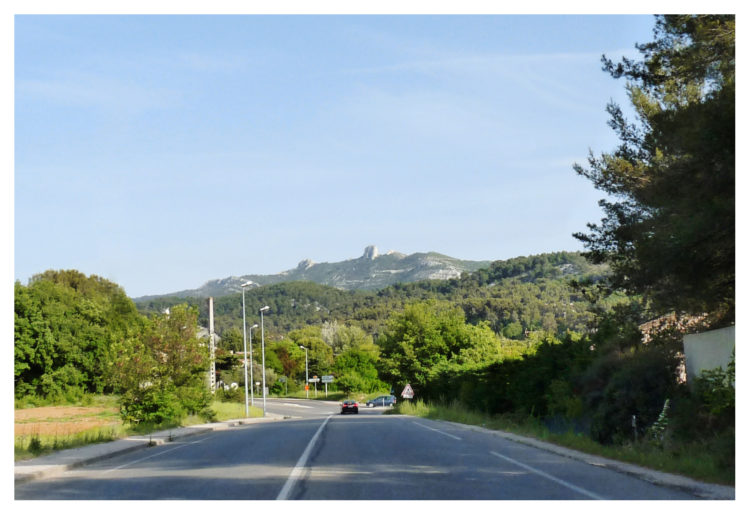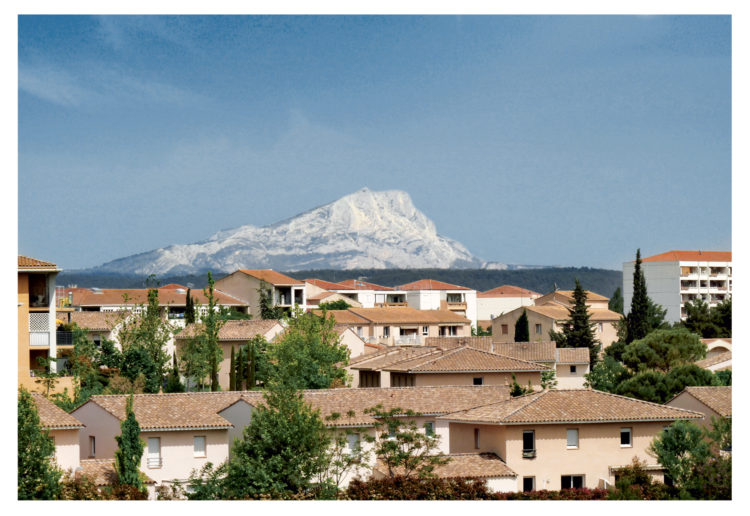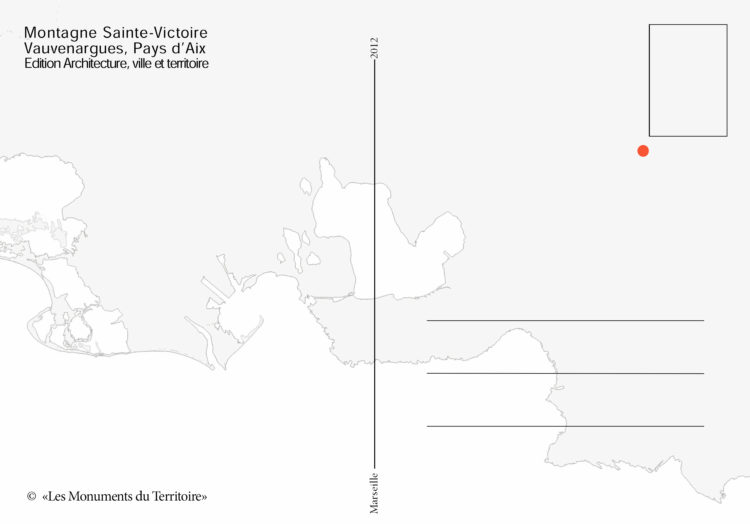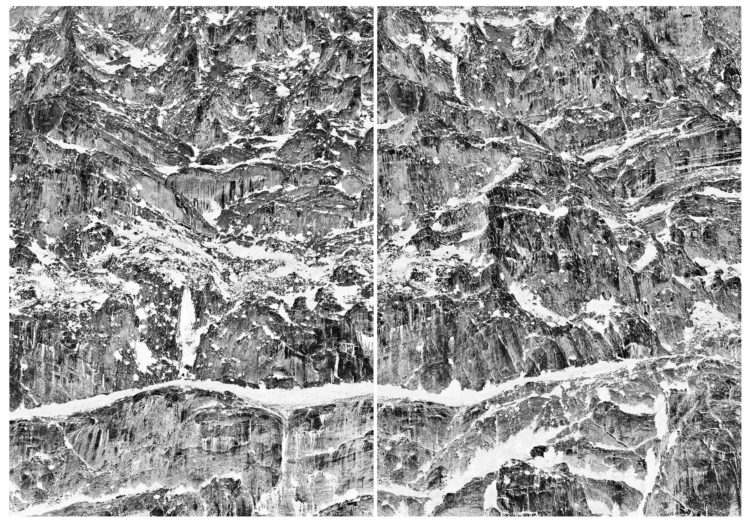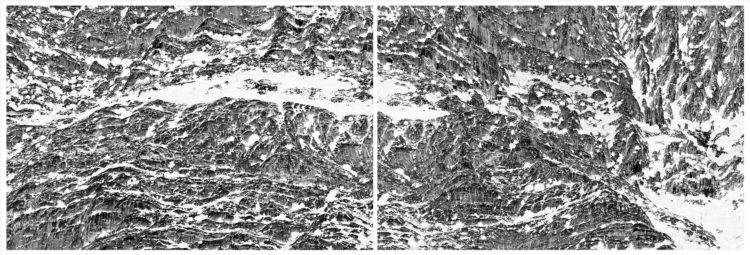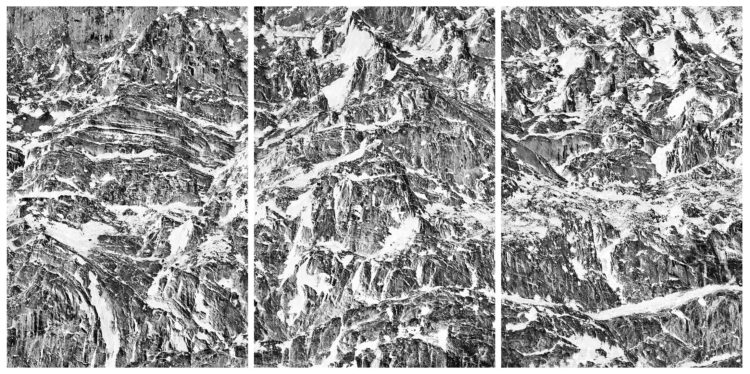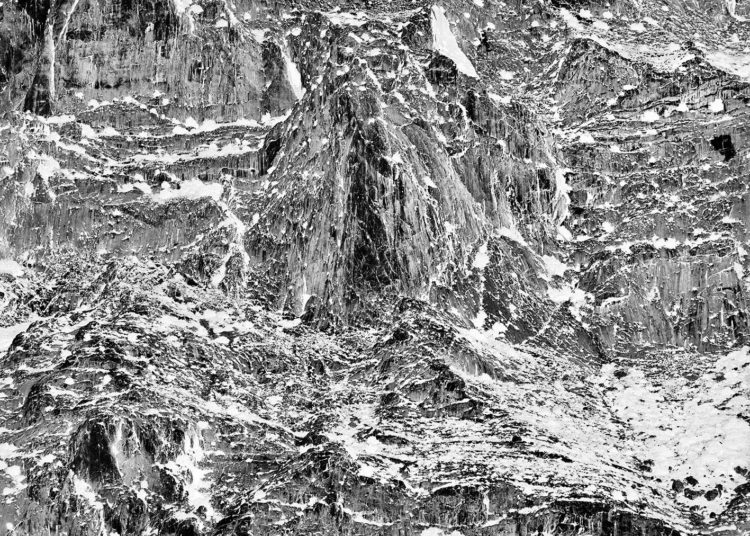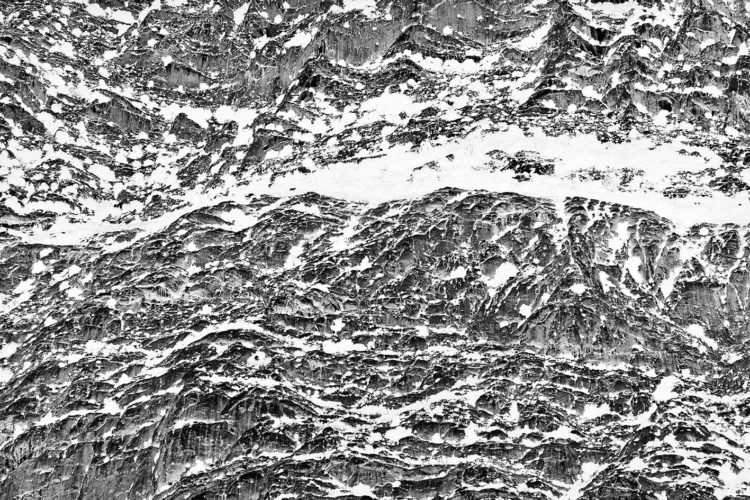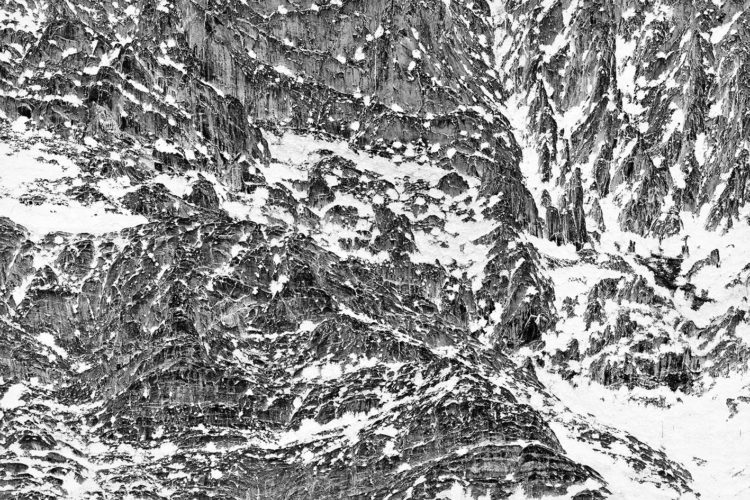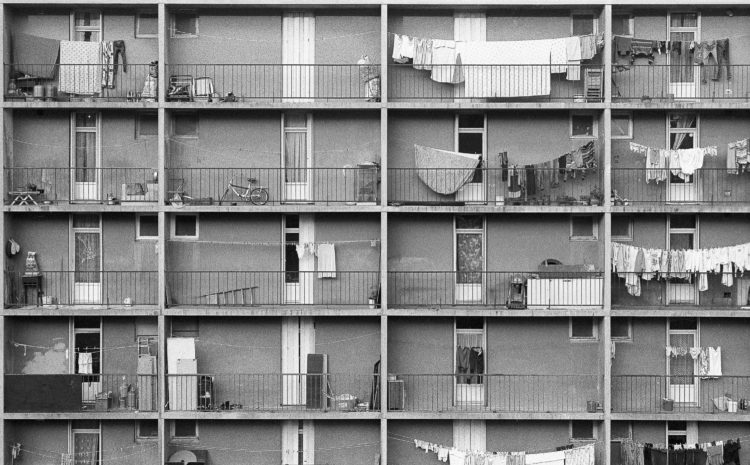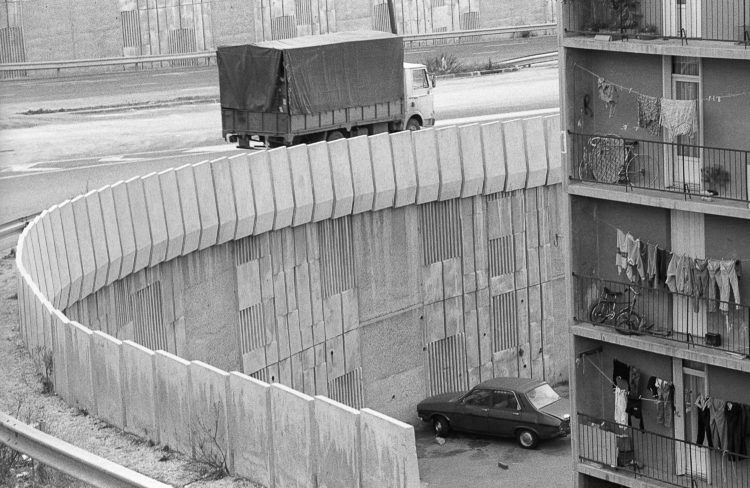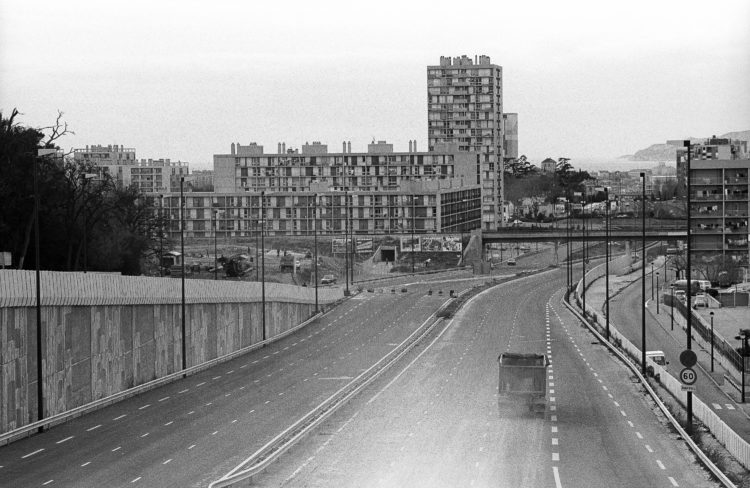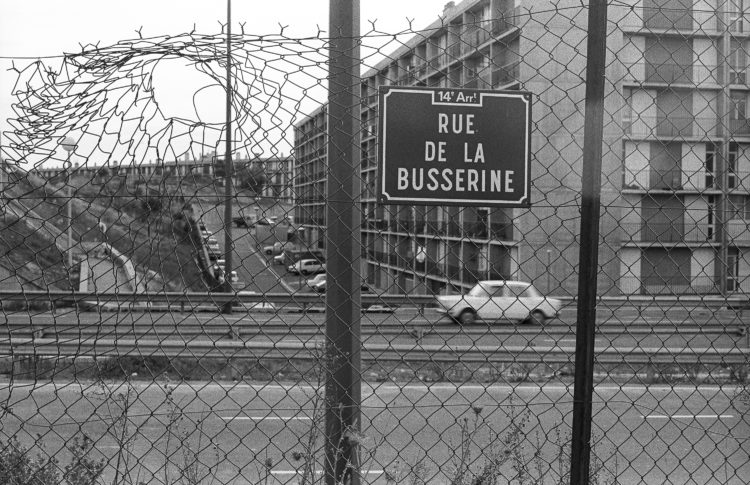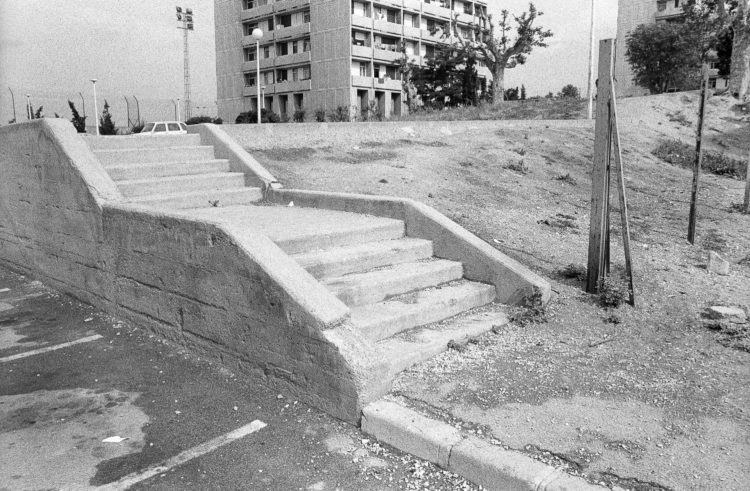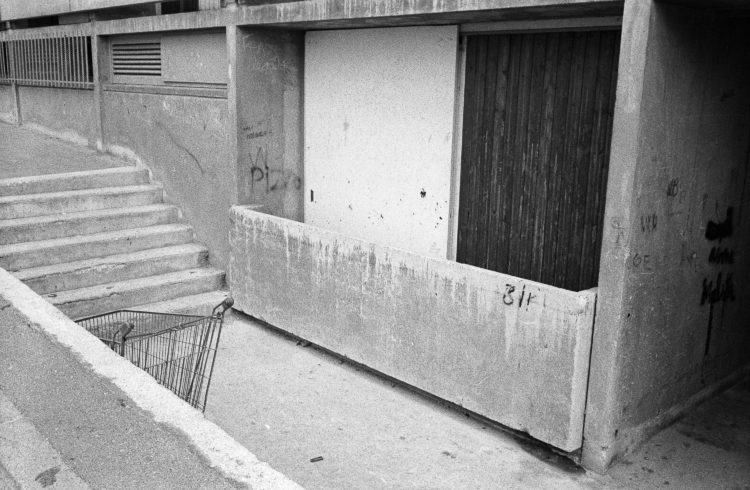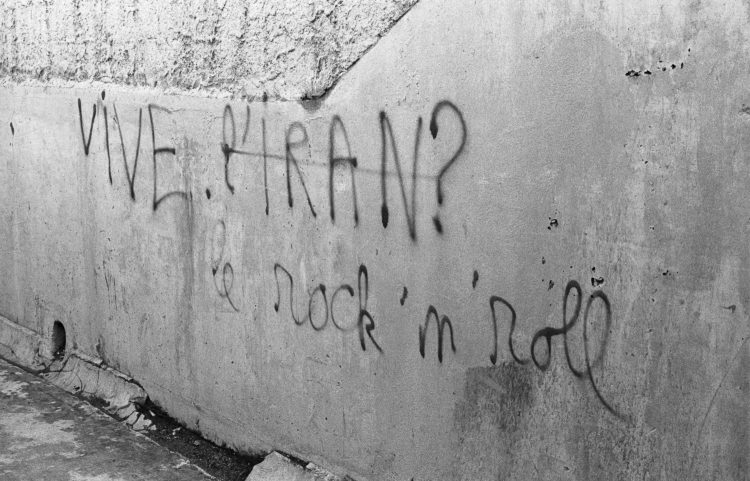Les collections
Les collections présentées dans cette exposition sont des séries d’images issues de l’inventaire et assemblées à nouveau par des personnalités invitées. Ces « collectionneurs » nous offrent ainsi leur point de vue singulier sur ces territoires. Ils deviennent pour un temps les commissaires d’une vaste exposition photographique qui rassemble ces terrains d’enquête en nous proposant de les parcourir avec eux.
Jean-Noël Consales
Agraire
À propos de la collection
Tous les manuels de géographie rurale l’affirment : les paysages agricoles méditerranéens ne peuvent s’envisager qu’au pluriel, au regard de leur grande diversité. En effet, en fonction des variations des caractéristiques physiques locales, mais aussi des différences d’interprétations que font les sociétés méditerranéennes de ces spécificités à travers le temps, les configurations spatiales liées à l’agriculture et à l’élevage changent fortement d’un territoire à l’autre, d’un finage à l’autre.
Quelle diversité agricole traduisent les paysages provençaux, bucco-rhodaniens ou métropolitains ? Par-delà les seuls héritages de la trilogie méditerranéenne (blé, vigne, olivier), se révèle toute la richesse de faciès cultivés qui se déclinent non seulement en raison de facteurs naturels (pente, sols, microclimats, etc.), mais encore en raison de facteurs humains (irrigation, savoir-faire, organisations sociales, techniques, etc.). Les terroirs, qui résultent de la lecture plus ou moins séculaire que font les hommes et les femmes de la petite portion de croûte terrestre qu’ils habitent, donnent ainsi à voir des organisations spatiales subtiles entre l’ager (l’espace cultivé), le saltus (l’espace non-cultivé dédié à l’élevage) et la silva (l’espace des bois et des forêts).
Ces paysages traduisent également quelques invariants agricoles typiquement méditerranéens, parmi lesquels figurent notamment l’irrigation qui répond à la sécheresse du climat, ou les liens étroits qu’entretiennent les économies agraires avec les villes.
Il ne s’agit pas, toutefois, de considérer ces paysages agricoles de manière figée, au seul prisme de leur épaisseur historique. Il faut, au contraire, les apprécier de façon dynamique, c’est-à-dire les envisager comme des structures spatiales en perpétuelle évolution. A cet égard, il convient de mettre en évidence les grandes causes de mutations paysagères, au premier rang desquelles se présente l’urbanisation massive que subissent les territoires méditerranéens. Se posent alors la question de l’avenir de leurs agricultures, dans un contexte d’urgence environnementale et écologique. Sans doute que les multiples appropriations citoyennes de l’agriculture qui s’inventent jusqu’au cœur des villes (agricultures urbaines) dessinent des pistes de réponses possibles, éminemment porteuses d’espoir.
Jean-Noël Consales
Jean Noël Consalès est docteur en géographie et aménagement du territoire depuis 2004. Il est l’auteur d’une thèse intitulée « les jardins familiaux dans l’arc méditerranéen : laboratoires territoriaux de l’agriculture urbaine ». Depuis 2005, il est maître de conférences en géographie, aménagement du territoire et urbanisme (Aix-Marseille Université/UMR TELEMMe). Ses travaux de recherches portent sur les relations ville/nature et sur la mobilisation de la nature dans les projets d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de paysage, à différentes échelles territoriales. Ils se fondent sur quatre champs : les sciences du paysage, la planification et l’urbanisme paysagers, l’agriculture urbaine et le jardinisme.
Jean Noël Consalès est l’auteur d’une cinquantaine de publications sur ces sujets. Il a participé à de nombreux programmes de recherches sur la nature en ville (trame verte et bleue ; agriculture urbaine ; sols urbains). Il co-dirige le parcours de Master « Projet de Paysage, Aménagement et Urbanisme » de l’IUAR (AMU).
Véronique Mure
Habiter à plusieurs peuples sur le même sol
À propos de la collection
Je fais impudemment mien ce titre d’un article du sociologue Antoine Hennion1 posant une question : Comment co-habiter, égaux et différents ?
C’est cette question que je voudrais prolonger ici. Comment habiter en arbre dans le monde des hommes ?
Les données scientifiques ne manquent pas. Nous le savons, les arbres ne vivent jamais seuls, ils ont besoin de faire société. Nous savons aussi, au moins inconsciemment, que nous sommes intimement liés aux arbres, et plus généralement au règne végétal. Nous, genre humain, ne poursuivrons pas le voyage sans eux, sans leur présence bienveillante et salvatrice. Dans l’antiquité déjà, le platane d’Orient (Platanus orientalis), père de notre platane hybride, était planté dans l’espace public. Pline l’ancien, au 1er siècle, en témoigne.
Mais qui ne s’étonnera à juste titre qu’on fasse venir d’un monde étranger un arbre, uniquement pour son ombrage ? (…) Cela se passait vers l’époque de la prise de Rome (an de Rome 364 – IVe siècle avant notre ère). Depuis, cet arbre est devenu dans une telle estime, qu’on le nourrit en l’arrosant de vin pur.2
Nous devons cependant prendre acte de la façon dont nous accueillons aujourd’hui le règne végétal dans la ville, et plus précisément dans les aménagements produits par nos sociétés carbonées, noyées dans le bitume. Nous avons perdu le lien, l’estime. Pour reprendre les mots de Baptiste Morizot, nous devons prendre acte de l’appauvrissement de la relation que nous tissons avec le monde vivant. (…) on « n’y voit rien », on n’y comprend pas grand-chose, et surtout, ça ne nous intéresse pas vraiment (…) ça n’a pas de place légitime dans le champ de l’attention collective, dans la fabrique du monde commun.3
- Hennion, A., Habiter à plusieurs peuples sur le même sol, Actes du colloque « Brassages planétaires, jardiner le monde avec Gilles Clément » Ed. Hermann, 2020.
- Pline l’ancien, Naturalis historia, 1er siècle.
- Morizot, B., Il faut politiser l’émerveillement. Itw par Nicolas Truong, Le Monde – 04 août 2020
Véronique Mure
Botaniste et ingénieur en agronomie tropicale, Véronique Mure défend depuis 30 ans la place des arbres dans les villes, les jardins et les paysages méditerranéens.
Une grande partie de son parcours professionnel s’est fait dans le domaine public où elle s’est attachée, entre autre, à préserver et valoriser les paysages qui font l’identité de ces territoires.
Elle exerce aujourd’hui une activité indépendante d’expertise et conseil en botanique. Crée en 2010, Botanique-Jardins-Paysage, basé à Nîmes, est spécialisé dans l’étude de la flore, en particulier méditerranéenne, et de ses liens avec les paysages d’un point de vue naturaliste, historique ou prospectif. Que ce soit dans ses missions d’analyse, de conseils ou d’interprétation Véronique Mure œuvre pour donner toute sa place au vivant dans les projets. C’est une conviction qu’elle aime partager et transmettre, qui l’a amené à publier plusieurs ouvrages et à enseigner la botanique à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles site de Marseille, ainsi qu’à l’université du temps libre de Nîmes.
Zoé Hagel
Raconter d’autres histoires
À propos de la collection
La possibilité d’un monde commun exige de nous éloigner de ce que l’on considère comme évident et qui nous exonère trop facilement de nous interroger sur ce, celles et ceux qui se trouvent exclus par ces apparences d’incontestabilité et d’inéluctabilité. Les injustices embarquées écrasent en effet la pluralité de ce qui nous constitue en tant que vivants, de même qu’elles occultent la diversité de nos appartenances et interdépendances, réduisant ce faisant la diversité de nos possibles devenirs.
Il s’agit en ce sens de réapprendre à être sensible au fait qu’habiter « c’est toujours cohabiter » (Morizot) et de cesser par là-même de refuser aux « autres que soi », humains comme « non-humains », le statut d’habitant (Ferdinand, Morizot). Faire face à la mise en danger continuelle du vivant suppose donc de transformer le champ de nos attentions et nos manières de faire importer. Cela nécessite d’apprendre à déhiérarchiser pour laisser émerger de nouvelles questions et parvenir à ne plus séparer mais au contraire penser et rencontrer « des êtres toujours-déjà mélangés, attachés » (Hache 2011).
Nous avons dès lors besoin d’élargir nos facultés à écouter, regarder, mais aussi nous laisser toucher par nos milieux et les raconter. Les photographies exposées s’offrent ici comme des prises concrètes, véritables voies ouvertes sur des possibilités de lire autrement les présences qui à la fois nous accompagnent et nous constituent. Expériences sensibles de nos milieux, elles nous mettent en capacité d’autres récits, où l’autre n’est pas forcément celui ou celle voire même ce que l’on croit. Réinterrogeant nos modes d’habiter par ce qu’ils nous font concrètement, à travers ce qu’ils engendrent, mettent en relations et génèrent, ces œuvres redonnent de l’épaisseur à ce qui nous fait vivre. Dépliant nos communautés, elles organisent la possibilité de futures rencontres.
Ce sont dès lors notre pouvoir d’agir et nos conditions mêmes d’êtres vivants qu’elles intensifient.
Zoé Hagel
Zoé Hagel est Maître de Conférence à l’université d’Aix-Marseille. Son cheminement de l’écologie scientifique à l’urbanisme s’ancre dans la nécessité de déhiérarchiser nos regards sur l’existant et le désir de déplier nos manières de vivre et d’habiter. Faisant place aux dimensions sensibles et vécues, ses approches interrogent la fabrique urbaine au prisme de ce que les milieux urbains nous font concrètement, à travers ce mais aussi celles et ceux qu’ils mettent en relations.
Bertrand Folléa
Paysages de lisière
À propos de la collection
En écologie, la lisière au plein sens du terme constitue un véritable espace d’interface, qui garantit la transition douce entre deux milieux. C’est un écotone : espace de transition écologique entre deux écosystèmes, avec ses conditions de milieu propres, avec des espèces végétales et animales également propres.
En urbanisme, la lisière urbaine est l’espace d’interface entre « ville » et « nature économique », en charge de gérer la relation et les échanges entre les deux, relation fondatrice de paysage. Elle constitue la transition entre l’espace urbanisé ou à urbaniser et l’espace agricole, forestier ou « naturel ». La lisière urbaine peut se matérialiser de multiples façons et à toutes les échelles, depuis la vision métropolitaine d’une agglomération inscrite dans un espaces naturel, jusqu’à la clôture du jardin s’ouvrant sur un espace agricole.
Elle peut se constituer progressivement en étant programmée dans les opérations d’urbanisme, concrétisant la limite d’urbanisation par son épaisseur. Elle peut être spécifiquement aménagée pour cela, participant ainsi de l’organisation du territoire. La lisière prend alors le plus souvent la forme d’un espace planté, accessible et appropriable pour les habitants : manière pour la ville ou le quartier de se tourner vers l’espace agricole ou de nature, de reconnaître tout simplement son existence et sa valeur.
Or, souvent, les espaces de relation entre les zonages de l’urbanisme et de l’aménagement (zone urbaine, zone agricole, zone naturelle) forment les angles morts des politiques publiques, révélateurs de leur sectorisation : entre grands ensembles et massifs ; lotissements et espaces agricoles, naturels ou forestiers ; zones d’activités et campagne agricole ; villes ou villages et littoral, cours d’eau ou zones humides ; espaces de loisirs et nature ; etc. La lisière, non reconnue en tant que telle, s’amenuise, donnant lieu à des situations problématiques pour les usagers des limites urbaines : oubli des connexions vers les espaces de nature environnants dans les nouveaux quartiers, disparition des terres agricoles au profit d’une urbanisation mal contrôlée, accroissement des risques liés aux incendies par la confrontation directe entre habitat et forêt, etc.
Le Projet de Paysage métropolitain a identifié dans de nombreuses démarches en cours ces secteurs d’interfaces comme une thématique récurrente et polymorphe devant être mise au service des objectifs de (re)qualification, restauration, préservation et valorisation du territoire. La Métropole Aix-Marseille Provence a missionné dans ce sens l’Agence Folléa-Gautier pour réaliser un Plan de paysage visant à réinterpréter ces espaces de lisières, comme une véritable interface d’échanges et de diversités.
Bertrand Folléa
Bertrand Folléa est, avec Claire Gautier, cofondateur et cogérant de l’agence Folléa-Gautier paysagistes urbanistes, Grand Prix National du Paysage en 2016.
Depuis 1991, l’agence Folléa-Gautier conçoit et met en oeuvre des projets d’aménagement en France métropolitaine, en outremer et à l’international : jardins, espaces publics, écoquartiers, renouvellement urbain, infrastructures, sites culturels et touristiques, espaces naturels, … Elle réalise également des études et projets d’urbanisme, de paysage et d’aménagement du territoire aux échelles régionales, départementales, intercommunales et communales : plans d’urbanisme et de paysage, documents d’urbanisme, atlas de paysage, … L’agence Folléa-Gautier considère le paysage comme la spécialité de la non spécialité : tel que perçu et vécu par les populations, il concerne en effet l’ensemble des champs sectoriels de l’aménagement. L’approche sensible, qui met l’humain au centre, est toujours privilégiée par l’agence dans ses processus d’étude, de conception et de mise en oeuvre.
Bertrand Folléa partage son temps entre les projets de l’agence Folléa-Gautier et l’enseignement (Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois/INSA CVL, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles – Marseille). Il est également directeur de la chaire d’entreprise ‘Paysage et énergie’ à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles – Marseille depuis 2015.
Sylvain Prudhomme
Romans
À propos de la collection
J’ai voulu rassembler ici des photos qui avaient à mes yeux cette particularité : être à elle seule des romans. Photos-romans, comme il y a des romans-photos, à ceci près que ces images-là n’illustrent rien, ne montrent nulle action en cours, ne renferment nulle anecdote – surtout pas d’anecdote.
Simplement elles attendent. Hospitalières. Ouvertes. Actives.
Images en attente de fiction. Qui sitôt contemplées enclenchent l’imagination, appellent la fable. Ce n’est pas quelque chose qui est déjà là, sous nos yeux, dans le cadre. C’est quelque chose qui va se passer, dans une seconde, dans un instant. Et la photo déjà le sait.
Je pense à ces graines capables de rester des décennies sans germer dans le désert, jusqu’au jour où quelques gouttes de pluie les réveillent. Je pense au nom donné par les botanistes à cette faculté : la dormance. Images douées de dormance. Images-mondes, pleines, grosses de possibles, vibrantes d’événements à venir.
Comme si aux trois dimensions de l’espace s’en ajoutait une autre, sorte de profondeur insituable qui aussitôt m’arrête et m’absorbe : quelque chose d’une réserve, d’un suspens avant le surgissement. Un potentiel de fiction partout affleurant. Roman en puissance, sur le point d’éclore.
Sylvain Prudhomme
Biographie à venir.
Les séries
Les photographies rassemblées par cet inventaire sont issues de travaux d’enquêtes réalisés depuis les années 1980 dans l’aire métropolitaine des Bouches-du-Rhône. Chaque série d’images est présentée par son auteur, renseignée par lui et accompagnée des informations et des documents qui permettent de comprendre la nature de l’enquête et le contexte de la commande. Les séries sont exposées ici les unes en regard des autres et dressent ainsi le portrait complexe et kaléidoscopique d’un territoire métropolitain.
Pierre Girardin
Venelles
À propos de la série
En arrivant à Venelles, j’ai été accueilli par un temps splendide. Je me suis installé à la terrasse du Café des Alpes pour siroter un Coca-Cola, tout en examinant la carte satellite de la ville sur mon téléphone afin de me repérer. L’autoroute que je venais d’emprunter traversait la commune telle une boucle d’un fleuve, avec une largeur de plusieurs dizaines de mètres. D’un côté, j’observais les rectangles colorés des parcelles cultivées, et de l’autre, le tracé sinueux des impasses bordées de maisons aux toits rouges et aux piscines turquoise. Venelles est passée d’une population de 600 habitants en 1960 à plus de 8 000 dans les années 2000, abandonnant ainsi son statut de village pour devenir une ville fonctionnelle. Mon travail est une exploration de l’identité périurbaine. C’est une promenade à travers la carte de cette commune : les quartiers résidentiels, la zone commerciale, les terres agricoles pressées par l’urbanisation, ainsi que l’autoroute qui la traverse en son centre. Son passé semble parfois avoir été délaissé et englouti par la modernité. Venelles ne possède d’ailleurs pas d’histoire marquante ni de monument important. J’ai choisi de me concentrer sur les interactions entre les zones urbanisées et la campagne environnante. Mes images interrogent l’expression de la modernité dans l’occupation de ce territoire qui, il n’y a pas si longtemps, était simplement un petit bourg du pays d’Aix.
- Année•s : 2020
- Commune•s : Venelles
- Commanditaire•s : Centre photographique de Marseille, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Patrimoine Commun
- © Pierre Girardin
Pierre Girardin
Pierre Girardin, né en 1989 à Rennes. Il vit et travaille à Marseille. Après un Bachelor en communication visuelle à l’ECAL (Suisse), c’est à Marseille, lors de son DNSEP aux Beaux Arts (2018—2020) qu’il réoriente sa pratique vers la photographie en expérimentant la matérialité et la couleur par le travail en laboratoire. Il en résulte des images picturales, mélangeant formes abstraites et figuratives. En parallèle, il explore la photographie documentaire en utilisant ses codes et son histoire.
Atlas Métropolitain — Fretti / Maraval
Métropole linéaire
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2013
- Commune•s : Aubagne, Auriol, Istres, La Penne-sur-Huveaune, Marseille, Miramas, Roquevaire
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Fretti / Maraval
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Olivier Amsellem
La poétique du bord
À propos de la série
« L’emprise de l’homme sur le territoire et pas n’importe lequel puisque l’attraction lié à la mer ou sa vue, sont pour moi symptomatique du reflet de la médiocrité et du manque de discernement. » Olivier Amsellem
- Année•s : 2009
- Commune•s : [Non renseigné]
- Commanditaire•s : Conseil Général des Bouches-du-Rhône
- © Olivier Amsellem
Olivier Amsellem
Olivier Amsellem, né le 2 février 1971 à Marseille, vit et travaille à Marseille. Quelque soit le médium utilisé dans son travail, le plus souvent la photographie, l’artiste dirige ses recherches autour de la mémoire, le souvenir, l’abandon, l’effacement et la disparition. Comme s’il devait sans cesse se persuader qu’il existe, son travail, enclin à la mélancolie et la nostalgie, perce le plus souvent la banalité du quotidien. « Lorsque je cadre, c’est pour Tuer ». Tuer un instant, l’esthétique du cadrage, une composition le plus souvent très précise, révélant parfois comme à la manière d’une sculpture, d’autres formes, une autre lecture. Olivier Amsellem regarde peut être un monde qui disparait et y cherche les explications dans son travail.
Sabine Massenet
Lire la ville
À propos de la série
« Suite à l’exposition collective organisée en 2014 par PCPI, « Sauf,…(territoires) » autour du GR13, au Centre d’art Fernand Léger de Port-de-Bouc, Jean-Luc Albert directeur de la Médiathèque de la ville me propose en 2016, de réaliser, toujours avec les habitants, un travail autour du livre et de la lecture. Je souhaite pour cette nouvelle commande, rencontrer un maximum de personnes dans tous les quartiers de la ville, interroger plus de femmes, souvent discrètes et peu présentes dans l’espace public, des jeunes et des enfants. Réaliser des images de la ville en lien avec leurs témoignages, ne pas livrer directement leurs portraits, mais donner la possibilité au spectateur de les imaginer comme on le fait à la lecture d’un roman, grâce aux retranscriptions de leurs témoignages, et aux images de la ville qui leur sont liées. Je rencontre plus de 150 personnes, les échanges sont parfois complexes, la lecture n’étant pas, comme me le dira un pêcheur, le sport favori des port-de-boucains. Je rencontre beaucoup d’illettrés ou d’enfants d’illettrés, de non-lecteurs, mais, comme le souligne bon-nombre de témoignages, le fait de ne pas lire n’est pas synonyme d’absence de culture. Je rencontre aussi de grand lecteurs, tout particulièrement les femmes et les enfants – je devrai pour cette dernière phrase utiliser l’écriture inclusive. Une chose me frappe : l’évocation très fréquente de la Bible et du Coran durant les entretiens menés dans les quartiers les plus déshérités de la ville. Ces textes religieux sont représentatifs de deux communautés, nord-africaine et gitane, très présentes à Port-de-Bouc. R. une femme d’une quarantaine d’années rencontrée au quartier Tassy livre une possible explication à la recrudescence du fait religieux dans une ville fondamentalement de gauche, communiste de surcroît : « Je suis de confession musulmane, ça, c’est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée. Je ne l’affiche pas. Ma mère est arrivée à Port-de-Bouc quand elle avait 17 ans. On a une double culture qui nous a permis d’avancer ici. Je n’ai jamais ressenti d’exclusion et aujourd’hui j’ai du mal à comprendre pourquoi certains ont besoin d’afficher leur appartenance en tant que musulmans. Ici, on a une tradition de vivre ensemble, on n’oublie pas. Mais la nouvelle génération, c’est complètement différent. Ils sont au chômage, ils se sentent exclus et ils ont une grande ignorance de l’histoire. » J’avais pour la médiathèque Boris Vian réalisé des planches de textes et de photos qui venaient se glisser au milieu des livres, dans les espaces laissés vacants des étagères de la bibliothèque. Cette installation spécifique ne pouvant trouver sa place qu’en bibliothèque, j’ai modifié la série afin qu’elle puisse être vue dans un contexte classique d’exposition ou sur écran. Je la présente aujourd’hui par quartiers, secteurs de la ville correspondant aux sites où je rencontrais les personnes interrogées. » Sabine Massenet
- Année•s : 2016
- Commune•s : Port-de-Bouc
- Commanditaire•s : Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Médiathèque Boris Vian, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ville de Port-de-Bouc
- © Sabine Massenet
Documentation :
Sabine Massenet_Lire la ville_Annexes_Inventaire (pdf)Sabine Massenet
Sabine Massenet est vidéaste. Elle vit et travaille à Paris. En 1997, après avoir travaillé différents médiums (terre, plâtre, photo) pour créer des installations auxquelles elle associait parfois des éléments narratifs, Sabine Massenet décide de se consacrer uniquement à la vidéo. Elle explore le portrait avec une ouverture sur le langage et sur la résonance des images dans la mémoire collective ou privée. Elle pratique également le recyclage d’images télévisuelles ou de cinéma, qu’elle remonte en se jouant des codes visuels propres à ces deux médiums. Elle obtient la bourse d’aide à l’art numérique de la SCAM 2003 pour 361° de bonheur, co-édition Incidences / Vidéochroniques. Elle crée aussi des vidéos de commande : pour le théâtre, pour la Maison Rimbaud à Charleville Mézières en 2005, pour la série « Image d’une œuvre » de l’IRCAM en 2019. Ses vidéos sont présentées régulièrement dans des festivals français et étrangers, centres d’art, musées. Des séances monographiques lui ont été consacrées en 2004 à la Cinémathèque Française, en 2005 au festival Némo et au Jeu de Paume, en 2009 au festival des Scénaristes à Bourges. Sa vidéo « Transports amoureux » est éditée dans le n°1 de la collection TALENTS. Elle réalise des séries photographiques tirées d’images de ses vidéos (« Tango », « Un peu plus loin le paradis », « Brûler la mer », « Fire », « J’entends rien »), ou des images réalisées sur le terrain (« Pentagone », « Lire la ville » et tout récemment « Covimmersive »). « Je ne me souviens plus », « Transport amoureux », « Last dance » et « Image trouvée » ont été acquises par le Fond d’Art Contemporain du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Le prix de l’œuvre d’art numérique de la SCAM lui est décerné en 2013, pour l’installation « Image trouvée ». « I am a seaman », film réalisé en 2016, a obtenu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM et le soutien du G.R.E.C. Professeur d’arts visuels de la Ville de Paris, elle a enseigné auprès d’enfants dans des écoles élémentaires puis a travaillé dans les services éducatifs du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée Zadkine et Bourdelle. Elle anime des ateliers vidéos pour Le Bal, la Terrasse, l’école du paysage de Blois…Elle crée en 2002 avec Christian et Véronique Barani l’association de diffusion de vidéos d’artistes est-ce une bonne nouvelle à laquelle elle participe jusqu’en 2007. Ses vidéos sont distribuées par Heure Exquise.
Élise Llinarès
Littoral Marseille
À propos de la série
« Littoral Marseille » est une série qui documente, sous forme de puzzle, une étroite bande de terre : 20 km de long de l’Estaque à la plage du Prado, quelques dizaines de mètres de large, toujours au plus près de la mer. Mais la mer, à Marseille, n’est pas centrale ni touristique contrairement à ce qu’on aurait pu penser. Le centre, c’est le Vieux-Port et la Canebière, non pas le Chemin du littoral dissimulé sous une autoroute. Ainsi, au sud, la mer s’offre par la Corniche Kennedy et ses prolongements, mais il faut parfois prendre des ruelles et passer sous des portiques pour apercevoir des criques bleues et des maisons somptueuses. Au nord par contre, il faut traverser des ronds-points et des embranchements d’autoroute, longer le port gigantesque et absolument interdit : la mer, on ne la voit pas. Pourquoi un puzzle ? Au départ, je voulais être systématique et trouver les clés de cette ville étonnante. Et puis, ayant lu Flaubert, Stendhal et Cendrars reconnaître leur incompréhension, j’ai cessé de vouloir comprendre pour mieux me laisser happer. J’ai photographié Marseille avec cette phrase de Cendrars en tête : « Marseille est une ville selon mon cœur. (…) Ici tout a l’air d’avoir été relégué : la mer, derrière des collines désertiques, le port, au diable vauvert, si bien que l’on peut aimer jusqu’à ses laideurs : le moutonnement interminable de ses tristes maisons de rapport, ses ruelles enchevêtrées, les usines neuves et les raffineries, les palais à l’italienne des nouveaux riches (…) Tout semble perdu en ville et, réellement, tout cela n’a aucune espèce d’importance. » Cette incompréhension acceptée, je pouvais découvrir ce que finalement j’étais venue photographier : le lieu où mon père, en 1962, avait débarqué pour la première fois en France, celui qu’il avait immédiatement fui pour se réfugier à Paris laissant là toute sa famille, et où il retournait pourtant tous les ans pour vivre un été qui ressemblait à celui de l’Algérie. Mais, après ma naissance, il n’y a plus mis les pieds. Il ne m’y a jamais emmenée. Et Marseille a rejoint une longue kyrielle de secrets dans la boite de Pandore paternelle. Littoral Marseille est une série en forme de découverte, d’hommage et de mémoire reconstruite. Elise Llinarès
- Année•s : 2017-2018
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Élise Llinarès
Documentation :
Elise Llinarès_Littoral Marseille_Annexes_Inventaire (pdf)Élise Llinarès
Elise Llinarès a initialement une formation d’historienne, et a été professeure d’histoire et de géographie. Depuis plusieurs années, elle utilise la photographie et l’écriture pour mener une réflexion sur l’identité et la mémoire dans les villes du sud méditerranéen, à Tel Aviv-Jaffa, Marseille, autour de l’Étang de Berre. Ou à Paris. Son travail d’investigation est nourri de sa formation d’historienne et de sa collaboration avec Michel Peraldi, anthropologue directeur de recherche au CNRS. D’une sensibilité politique et littéraire proche des surréalistes et des situationnistes, elle subvertit le réel en mêlant portraits, récits et fictions pour servir son projet documentaire. Il en résulte des images à la douceur trompeuse, comme des mises en garde face à la société du spectacle.
Christophe Galatry
Arcelor
À propos de la série
Série prise en en une saisie, durant une exploration autour des crassiers d’ArcelorMittal sur leur site de Fos-sur-Mer.
- Année•s : 2010
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Christophe Galatry / ADAGP Paris, 2020
Christophe Galatry
« Une approche sur la représentation photographique de territoires et la notion de paysages dans et autour de Marseille. Cette interprétation couvre différents spectres d’échelles, du plus intime et microscopique des points de vues au plus large et partagé par le plus grand nombre comme la représentation d’images satellites. A travers des lieux parfois très localisés, je questionne l’image photographique dans différentes situations spatiales, les matières et objets composants ces espaces ainsi que le statut de ceux-ci et leur forclusion par des barrières visuelles : le délaissé, l’oublie, l’abandon, mais aussi contraintes : oubli/révélation, semblable/différent, passage/infranchissement. » Christophe Galatry
Margret Hoppe
Südwall
À propos de la série
« La serie « Südwall » a été réalisée pendant une résidence d´artistes au Garage Photographie de Marseille avec le soutien du Goethe Institut Marseille. Je suis venu plusieurs fois à Marseille pour un séjour d’environ une semaine entre 2017 et 2019 afin de faire une recherche photographique sur les traces de l’histoire des allemands à Marseille. J´ai découvert des traces militaires dans le paysage des Calanques, sur l’île de Frioul et dans la ville de Marseille. Je n’étais pas au courant avant ma résidence, que les allemands ont construit des blockhaus à Marseille et que leur présence pendant la Seconde Guerre Mondiale avait été assez marquante. Puis je suis tombé sur l´histoire de l´américain Varian Fry, qui a sauvé la vie de plusieurs artistes et intellectuels allemands qui ont fuit les nazis. Entre autres, il y a eu Thomas Mann, Lyon Feuchtwanger, la famille Werfel ou Bertolt Brecht qui ont résidé dans des maisons à Sanary-Sur-Mer. J´ai photographié leurs maisons à Sanary-sur-mer et aussi au camp des Milles, à Aix-en-Provence, ou des résistants et des juifs étaient internés pendant la guerre. Les photos sont accompagnés de documents des Archives de la Ville de Marseille qui témoignent de l’occupation allemande et de la libération en 1945. » Margret Hoppe
- Année•s : 2017-2019
- Commune•s : Marseille, Sanary-Sur-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Margret Hoppe
Documentation :
Margret Hoppe_ Südwall_Annexes_Inventaire (pdf)Margret Hoppe
Née en 1981 à Greiz/Thuringe (Allemagne) Magret Hoppe est diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Leipzig en 2007, puis en 2004-2005 de l´Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Depuis 2007, elle travaille comme photographe indépendante et a participé à plusieurs résidences en France, en Bulgarie, au Canada et en Inde. En 2007, elle reçoit plusieurs prix, dont le Prix de la Photographie Documentaire de la Wüstenrot Stiftung, le Prix « gute aussichten – jeune photographie allemande », et le Prix de la Banque du Saxon pour l´Art en 2014). De 2017 à 2020, elle a été en résidence à Marseille au Garage Photographie, avec le soutien du Goethe Institut, pour le projet « Südwall ».
Thibaut Cuisset
Nulle part ailleurs, La Bouilladisse
À propos de la série
« La commune de La Bouilladisse, au cœur de la Provence, est un grand territoire ouvert et habité essentiellement le long d’un axe de circulation et autour de petits hameaux périphériques. Elle possède de grands paysages préservés de grande qualité souvent méconnus.
La mission de la commune est de gérer ce patrimoine en conciliant protection de l’environnement et développement local. Dans le cadre du centenaire de sa constitution, elle a décidé de mettre en place une procédure de commande photographique. Le but principal est d’engager la collectivité dans la durée sur une politique de valorisation des différentes disciplines artistiques contemporaines et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Par cette commande photographique, elle veut également se doter d’un outil pour valoriser ses espaces qui montre la réalité d’un village, à savoir celle d’un territoire habité avec un environnement naturel et remarquable.
Le regard expert et extérieur d’un photographe permet de témoigner et de questionner ces espaces, sous une forme décalée, curieuse et contemporaine. Celui-ci interroge indirectement l’histoire de la commune, ses contradictions, sa géographie… Son travail offre un pré-diagnostic qui favorise les vues croisées sur la ville pour mieux se l’approprier et mieux la partager. Il devient également un formidable outil pour faire connaître notre village.
Le choix de Thibaut Cuisset s’est vite imposé à nous comme une évidence. Son travail s’attache aux grands paysages qu’il aborde de façon intimiste.
Ce fut d’abord une rencontre avec un homme généreux, patient et curieux. Il est venu chez nous à plusieurs reprises pour capter les différentes lumières et saisir la nature selon les saisons. Il a arpenté tous les chemins, gravi toutes nos collines. L’apparition des premières épreuves fut un enchantement. Face à ces images, on ne cherche pas à reconnaître un lieu, on le redécouvre, plus dense, plus riche, plus profond. Les traces de la présence humaine sont souvent présentes mais toujours sous l’autorité de la nature. Cette nature va bien au-delà du territoire de la commune. De la Sainte-Victoire à la Sainte-Baume, les vallons et collines se succèdent pour mieux nous envelopper, mieux nous protéger. Le parcours que nous propose Thibaut Cuisset est composé de morceaux choisis par lui, sans contrainte de notre part. Il ne s’entend pas comme un inventaire exhaustif mais tout simplement comme une succession de tableaux où le territoire se révèle dans sa profondeur, sa singularité et sa vérité. »
André Jullien, Maire de la Bouilladisse – Extrait de l’ouvrage Nulle part ailleurs, La Bouilladisse, CUISSET Thibaut, BAILLY Jean-Christophe, Ed. Images en manœuvres.
- Année•s : 2010
- Commune•s : La Bouilladisse
- Commanditaire•s : Ville de La Bouilladisse
- © Thibaut Cuisset / Adagp, Paris, 2020.
Thibaut Cuisset
Né en 1958 à Maubeuge, décédé en 2017 à Paris.
Ancien pensionnaire de la Villa Médicis à Rome(1992-1993) et de la villa Kujoyama à Kyoto (1997), Thibaut Cuisset s’est consacré, depuis les années 80, à la photographie de paysage à travers le monde, de la Namibie au Japon, en passant par le Venezuela, la Syrie et la France (Corse, Bretagne, Val de Loire, Normandie, Hérault…).
Thibaut Cuisset est le lauréat du prix de photographie 2009 de l’Académie des Beaux-Arts pour son projet sur la campagne française.
Son travail a notamment été montré en 2017 lors de l’importante exposition ‘Paysage français : une aventure photographique (1984-2017)’ réunissant une centaine de photographes iconiques à la Bibliothèque nationale de France, et lors du festival Images Singulières de Sète ; en 2014 à l’Hôtel Fontfreyde – Centre Photographique à Clermont-Ferrand ; ou encore à Arles en 2013. En 2015, il fut lauréat du Prix Résidence pour la Photographie de la Fondation des Treilles.
Son œuvre, d’une très grande richesse, a été l’objet de nombreuses acquisitions dans des collections privées et publiques telles que le Musée National d’Art Moderne du Centre Georges Pompidou, la Maison Européenne de la Photographie, la Société Générale ou le Musée Carnavalet à Paris.
« Le travail photographique de Thibaut Cuisset se déploie par campagnes successives et, à chaque fois, un pays différent fait l’objet de la série. Dans ces campagnes généralement assez longues où le repérage se dilue peu à peu dans la prise, aucune place n’est laissée à l’improvisation ou à l’accidentel et d’autant moins que nous sommes avec elles aux antipodes du reportage : un pays n’est pas le terrain d’une actualité qu’il faudrait couvrir, ni celui d’un réseau d’indices qu’il faudrait capter, mais un ensemble de paysages où le type se révèle lentement, à travers des scènes fixes qui sont comme autant de cachettes. La Turquie, l’Australie, l’Italie, la Suisse, l’Islande, les pays de Loire, et j’en oublie, ont été ainsi visités et prospectés. » Extrait de « L’étendue de l’instant » par Jean-Christophe Bailly
Sabine Massenet
Pentagone
À propos de la série
« En 2012, au cours d’ une promenade de reconnaissance pour la préparation du GR13 avec PCPI, je découvre la petite ville de Port-de-Bouc. La passe, le canal d’Arles à Bouc, l’ambiance du café où nous nous arrêtons me séduisent immédiatement. Je décide d’y retourner et Christophe Galatry avec son association PCPI me propose une résidence en lien avec le Centre d’art Fernand Léger. L’idée est de réaliser une vidéo, sur les habitants et le lien qu’ils entretiennent avec leur ville. Je suis hébergée au Centre d’art pendant quinze jours. Je prends très vite conscience qu’il me faudrait plus d’une année de travail pour réaliser un film : je ne peux effleurer ce lieu, n’en donner qu’un aperçu rapide. Je décide de réaliser des photos et des enregistrements que je présenterai ensemble en installation, les retranscriptions du matériel sonore constituant une sorte de photographie de la parole dans l’exposition. Je fais de multiples rencontres au cours de mes déambulations à pied dans la ville et décide de focaliser mon attention sur quelques « personnages » qui constituent la mémoire vivante de la ville. Port-de-Bouc est une ville « moderne » et ceux qui l’ont vu naître vont disparaître. Michel, Denys, Mohammed, Esteban, Régine, Michel, Daniel… vont me guider dans cette découverte. Je prends conscience au cours de mes promenades de l’extraordinaire complexité structurelle de la ville modelée par l’industrie. C’est elle qui a dessiné, creusé les espaces vierges, pour ouvrir de grandes artères (route, canal, voies de chemins de fer), construire une jetée, des usines aujourd’hui disparues. Dans les espaces intermédiaires laissés vacants, se sont installées, par vagues successives des populations étrangères : grecques, maltaises, espagnoles, italiennes, gitanes, arméniennes, nord-africaines, vietnamiennes. Les nouveaux arrivants, embauchés dans les usines chimiques et au chantier naval, occupent dans un premier temps des baraquements qui seront remplacés petit à petit par des immeubles ou maisons en dur. Ils vont former la très jeune et métissée population de Port-de-Bouc. Dans ce patchwork de quartiers très hétéroclites, affleurent les traces de cultures diverses qui s’expriment dans l’habitat avec naïveté, discrétion, parfois humour. La série photographique que j’ai construite tente de retracer cette histoire. Je juxtapose dans certains clichés mes photographies avec des images du passé que je découvre chez Esteban, collectionneur de cartes postales anciennes et qui a recueilli et classé la totalité des clichés et négatifs du photographe de la ville disparu dans les années 70. Des fragments des entretiens retranscrits et tirés sur papiers photo sont présentés sur des cartels sous les images. Ils soulignent avec humour, parfois gravité des événements ou anecdotes vécues par ceux dont j’ai parfois photographié les lieux de vie souvent situés sur des lieux symboliques de la ville.Trois des protagonistes, pour certains aux très fortes personnalités et très engagés politiquement (on appelait autrefois Port-de-Bouc le Petit Moscou), sont aujourd’hui disparus. Je leur dédie ce travail. » Sabine Massenet
- Année•s : 2014
- Commune•s : Port-de-Bouc
- Commanditaire•s : Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- © Sabine Massenet
Documentation :
Sabine Massenet_Pentagone_Annexes_Inventaire (pdf)Sabine Massenet
Sabine Massenet est vidéaste. Elle vit et travaille à Paris. En 1997, après avoir travaillé différents médiums (terre, plâtre, photo) pour créer des installations auxquelles elle associait parfois des éléments narratifs, Sabine Massenet décide de se consacrer uniquement à la vidéo. Elle explore le portrait avec une ouverture sur le langage et sur la résonance des images dans la mémoire collective ou privée. Elle pratique également le recyclage d’images télévisuelles ou de cinéma, qu’elle remonte en se jouant des codes visuels propres à ces deux médiums. Elle obtient la bourse d’aide à l’art numérique de la SCAM 2003 pour 361° de bonheur, co-édition Incidences / Vidéochroniques. Elle crée aussi des vidéos de commande : pour le théâtre, pour la Maison Rimbaud à Charleville Mézières en 2005, pour la série « Image d’une œuvre » de l’IRCAM en 2019. Ses vidéos sont présentées régulièrement dans des festivals français et étrangers, centres d’art, musées. Des séances monographiques lui ont été consacrées en 2004 à la Cinémathèque Française, en 2005 au festival Némo et au Jeu de Paume, en 2009 au festival des Scénaristes à Bourges. Sa vidéo « Transports amoureux » est éditée dans le n°1 de la collection TALENTS. Elle réalise des séries photographiques tirées d’images de ses vidéos (« Tango », « Un peu plus loin le paradis », « Brûler la mer », « Fire », « J’entends rien »), ou des images réalisées sur le terrain (« Pentagone », « Lire la ville » et tout récemment « Covimmersive »). « Je ne me souviens plus », « Transport amoureux », « Last dance » et « Image trouvée » ont été acquises par le Fond d’Art Contemporain du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Le prix de l’œuvre d’art numérique de la SCAM lui est décerné en 2013, pour l’installation « Image trouvée ». « I am a seaman », film réalisé en 2016, a obtenu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM et le soutien du G.R.E.C. Professeur d’arts visuels de la Ville de Paris, elle a enseigné auprès d’enfants dans des écoles élémentaires puis a travaillé dans les services éducatifs du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée Zadkine et Bourdelle. Elle anime des ateliers vidéos pour Le Bal, la Terrasse, l’école du paysage de Blois…Elle crée en 2002 avec Christian et Véronique Barani l’association de diffusion de vidéos d’artistes est-ce une bonne nouvelle à laquelle elle participe jusqu’en 2007. Ses vidéos sont distribuées par Heure Exquise.
Lewis Baltz
Fos-sur-Mer, secteur 80
À propos de la série
« Fos-sur-Mer, secteur 80 » était une commande du gouvernement français impliquant plusieurs artistes photographes.
Le sujet était un vieux port remontant à l’époque romaine, dont la ville était devenue au début du 20ième siècle une zone franche industrielle. A la fin des années 1970, l’industrie a commencé à se délocaliser hors d’Europe de l’Ouest, ce qui a amené le port à traverser une période difficile. L’objet de cette commande du gouvernement français était un effort visant à donner un souffle nouveau à la communauté avec une perspective fraiche et moderne centrée sur la réutilisation du terrain.
- Année•s : 1985
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Mission photographique de la DATAR
- © Lewis Baltz / Mission photographique de la DATAR. Courtesy : Gallery Luisotti
Lewis Baltz
L’œuvre révolutionnaire de Lewis Baltz a été reconnue dès 1975 quand l’artiste a participé à « New Topographics », nouvelles topographies, une exposition phare qui fut un élément essentiel dans la création d’un changement de paradigme dans l’histoire de la photographie. Décrit comme un« critical enlightener » ou comme une personne qui apporte un éclairage capital, Baltz se démarque au début de sa carrière pour avoir élaboré des séries d’exquis clichés en noir et blanc qui incitent à la réflexion à cause de leur esthétique minimaliste combinée à une fervente approche conceptuelle. De 1967 à 1989, il a produit 11 séries de travaux comprenant « The Tract houses », les maisons du lotissement (1971), et « les Nouveaux parcs industriels », près d’Irvine en Californie (1974), qui sont des œuvres de précurseur destinées à attirer l’attention sur les marges négligées de notre société de consommation.
Dans « Sites de la technologie » (1989-91) Baltz montre les mondes dystopiques où a lieu la recherche technique dans des sociétés comme Toshiba ou Mitsubishi, en évoquant sur la pellicule le pouvoir invisible que les machines détiennent sur l’homme. Bien que son travail soit souvent aligné sur le cinéma, cela apparait de la manière la plus évidente dans les installations couleur à grande échelle avec bande sonore – La ronde de nuit (1992), Corps Dociles (1995), et La Politique des Bactéries(1995) – où il expose les environnements fabriqués des cybermondes et leur impact sur l’écologie et la société.
L’œuvre de Baltz a été exposée dans plus de 50 expositions individuelles dans des endroits comme la Leo Castelli Gallery, la Corcoran Gallery of Art, le Victoria and Albert Museum, le San Francisco Museum of Modern Art, PS1, New York, LACMA, le Tokyo Institute of Polytechnics, et l’Albertina. Ses oeuvres se trouvent dans les collections du MOMA de New York, du Whitney Museum of American Art de New York, du Tate Modern de Londres et du Museum of Contemporary Art de Los Angeles, parmi beaucoup d’autres.
Baltz était boursier de la Fondation Nationale pour les Arts en 1973 et 1976. Il a reçu une bourse Guggenheim en 1977 et une bourse bicentenaire UK/USA en 1980.
Philippe Piron
Repérage GR2013 : Lançon-Provence – Berre l’Étang
À propos de la série
Cette série comme toutes celles réalisées lors des parcours de repérage du GR2013, servait à documenter le GR2013, enregistrer la succession des paysages traversés.
- Année•s : 2011
- Commune•s : Berre-L'Étang, Lançon-Provence
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Philippe Piron
Philippe Piron
Philippe Piron a d’abord travaillé sur des projets d’analyse et de gestion des paysages ruraux au sein de différents organismes (CAUE, Conseil général…). Cette première approche technique du paysage sera complétée par une formation en photographie dirigée par Serge Gal à l’école Image Ouverte (Gard).
Après s’être établi à Marseille, il réalise des commandes pour des architectes et des institutions (CAUE13, DRAC PACA, Euroméditerranée…). Il développe également des projets personnels et participe notamment à de nombreuses marches collectives qu’il documente photographiquement en réalisant des carnets. En 2013, au côté d’artistes marcheurs, il participe à la création du GR2013, sentier de grande randonnée périurbain. Il s’installe à Nantes en 2012. Il est né en 1974 dans le Maine et Loire.
Karine Maussière
L’Huveaune et tiers paysages
À propos de la série
« En 2002 je m’installe à St Marcel dans 11eme arrondissement de Marseille, près du fleuve l’Huveaune et découvre ses territoires adjacents, son passé industriel, ses mutations. Terrains de jeu, lignes paysages en devenir, Tiers Paysages ou fragments indécidés, font références aux recherches de Gilles Clément et désignent la somme des espaces où l’homme abandonne l’évolution du paysage à la seule nature. Afin de comprendre et de révéler ce qu’il est, je décide de descendre l’Huveaune jusqu’à la mer et commence à construire un travail personnel sur la transformation du paysage les pieds dans l’eau. D’autres explorations suivront dans la vallée, à différentes époques, avec différentes outils : en 2002 à mon arrivée j’utilise un rolleiflex, en 2005 j’essaie un petit outil un photophone Sony Ericsson, en revenant d’un mon tour du monde en 2008 l’Iphone. Les photographies prises de manière frontale, représentent des paysages en devenir, souillés par l’histoire et les hommes. Elles questionnent les strates de la mémoire, se veulent une lecture du territoire tout à la fois sensible et poétique. En 2010, j’ouvre le champ au public et propose avec la Galerie des Grands Bains Douches ma première balade urbaine « les pieds dans l’eau » : une nouvelle approche artistique à la découverte d’un territoire. D’autres suivront … la L2, le Boulevard Urbain Sud… Territoires marseillais, à la fois domptés et sauvages, souillés et parfois d’une beauté sereine, je nous parle d’un jardin. D’un jardin discontinu, passant par les jardins oubliés, terrains vagues, friches industrielles… inventant de nouveaux tracés pour des petites randonnées urbaines (PRU). » Karine Maussière
- Année•s : 2002-2017
- Commune•s : Vallée de l'Huveaune
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Karine Maussière / SAIF 2020
Karine Maussière
« Je vis sous le soleil, exactement, au milieu d’un jardin, dans le sud de la France. Née en 1971 d’un père passionné de haute montagne, je me familiarise très tôt à la marche. De cette enfance baladée, il me reste des paysages arpentés, écoutés, contemplés, humés, aimés. Traces durables qui me font aujourd’hui encore m’émerveiller face à la beauté du monde. C’est dans cet élan que je positionne mon esprit dans un mouvement d’ouverture. Les paysages me procurent un sentiment d’être au monde en favorisant une appartenance commune à la terre. Diplômée des Beaux Arts, j’utilise la photographie dans ma relation au monde tout en interrogeant ma place dans la pensée écologique à l’ère de l’anthropocène. « Ensemble, nous décidons que la Terre est un seul et petit jardin. » Cette proposition de Gilles Clément, initiateur du jardin planétaire, bouleverse la réflexion sur l’homme et son environnement. La Terre est, comme le jardin, un espace clos, fini et arpentable que l’Homme doit ménager. A partir de ces idées, je choisis de mettre le paysage au coeur de mes préoccupations et décide de développer des axes de recherches sur les paysages. Paysages à la nature changeante mais aux qualités esthétiques indéniables, le paysage devient sujet d’étude et de représentation. La quête de son appropriation habite ma recherche artistique. Cette appropriation se fait par l’image et par le mouvement du corps. Depuis, la notion du mouvement est comme un leitmotiv. » Karine Maussière
Atlas Métropolitain — Lapeyrin / Sibilat
Paysage interstitiel
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2014
- Commune•s : Aubagne, Cadolive, Carnoux-en-Provence, La Fare-les-Oliviers, La Penne-sur-Huveaune, Marseille, Miramas, Roquefort-la-Bédoule, Ventabren
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Lapeyrin / Sibilat
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Fabrice Ney
Fos-sur-Mer : regard sur un quotidien localisé
À propos de la série
« Le fond dont est extraite la série présentée ici, a servi de support et de matériau à la rédaction de mon mémoire de DEA : « Fos-sur-Mer : regard sur un quotidien localisé » (EHESS, 1979). Mes premières images photographiques ont été réalisées en 1977 sur le site de Fos-sur-Mer. Fin 1978, je me suis concentré sur l’habitat et l’étude de trois quartiers : le centre ville ancien, les lotissements dans le quartier des Jonquières (auxquels s’est ajoutée une série sur les lotissements en chantiers dans le quartier du Mazet en construction), le quartier des Plages (le port de Plaisance de Saint-Gervais était en chantier). L’approche photographique a consisté en une étude visuelle des espaces urbains, conduite par une interrogation à valeur heuristique: les images photographiques des lieux étaient-elles susceptibles d’accompagner une approche sociologique des pratiques urbaines des habitants? Cette question sur la fonction documentaire de l’image photographique, s’accompagnait d’une réflexion sur les choix esthétiques et thématiques du photographe dans la constitution du corpus. L’originalité de cette approche relevait d’une attention exclusivement portée sur l’environnement urbain, ses détails. Elle s’effectuait en rupture avec les pratiques, dominantes à l’époque, de la photographie dite sociologique qui privilégiait la représentation de l’humain comme essentiellement représentative des relations sociales. Ici, il s’agissait d’aborder les différents jeux de marquage des parties prenantes intervenant dans cet environnement physique, matériel, comme révélateurs d’une réalité sociale. Les séries thématiques, construites au fur et à mesure de l’observation du terrain, sont un axe de recherche essentiel. Il ne s’agissait pas d’illustrer des pratiques, mais d’effectuer des relevés de pratiques, à partir de l’espace collectif, de la rue. La mise en représentation consciente du point de vue du photographe est révélatrice de ses propres recherches, en particulier ici, les cadrages resserrés sur des détails. Il s’agit moins de prouver ou d’argumenter sur une réalité sociale, que d’attirer l’attention sur l’ensemble des choses qui entourent les êtres, qu’ils utilisent, disposent, s’approprient, transforment, délaissent, échangent… dans un cadre social déterminé, selon des règles plus ou moins formalisées et en évolution. L’étude photographique de la disposition de ces choses met en valeur à la fois des agencements relativement réguliers, et des écarts déstabilisants. Elle questionne sur une sociabilité construite au quotidien. L’intérêt de l’utilisation de la photographie dans l’étude de ces phénomènes est que les objets sont nécessairement représentés dans un contexte. Cet outil permet de réaliser des images de l’environnement, dans un double mouvement toujours aussi surprenant de rapprochement et d’éloignement, mêlant les sentiments d’intimité et de mise à distance des lieux photographiés. » Fabrice Ney
- Année•s : 1977-1979
- Commune•s : Fos-sur-Mer, Salins
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Fabrice Ney
Documentation :
Fabrice Ney_Fos-sur-mer_Annexes_Inventaire (pdf)Fabrice Ney
Fabrice Ney est né en 1953, à Bizerte. Ses premiers travaux photographiques datent de la fin des années 1970, associés à ses études universitaires à l’EHESS: « Fos-sur-Mer » (1979), « La Seyne-sur-Mer » (1980-83), « Zup n°1 » (1981-83). Sa recherche se développe ensuite autour de la question de la représentation des lieux et du territoire: « Cap Sicié » (1984), « Km 296 » (1986). En 1989, il crée à Marseille l’association SITe (Sud, Image, Territoire), un collectif de photographes porteurs de propositions autour du thème de l’environnement et des enjeux de ses représentations photographiques (« Soude » (1993), « Quarantaine » (1993), « Résurgence », (1994), « Origine(s) », (1998)). En 1998, Il arrête son travail photographique qu’il reprend en 2013 (« Tentatives d’effleurements » (2014), « Abords et limites » (2015), « De Rerum Natura », (2018)) et revisite ses archives, après en avoir effectué des enregistrements numériques. Il regroupe l’ensemble de son œuvre sous le titre « Un regard sans personne ». Son travail photographique se caractérise par le choix de ses thèmes et la manière de les traiter: une unité territoriale à un moment choisi de son histoire saisie dans les détails révélateurs de ses enjeux. Privilégiant l’accumulation sérielle qui puise sa cohérence dans un cadrage rapproché des éléments constitutifs de l’environnement immédiat, l’accrochage au mur se présente sous des formes permettant des interprétations ouvertes, et pouvant s’articuler avec d’autres matériaux (scientifiques, sonores, poétiques…).
Vincent Bonnet
Des concertations (les mains sur la ville)
À propos de la série
« Entre 2002 et 2004, j’ai constitué un fonds photographique autour d’un objet problématique : l’image d’une ville, Marseille Provence Métropole, située quelque part dans le cours mouvant, provisoire, spéculatif, imprévisible des choses et des sites, sans centre, ni identité. Dans cette approche, j’ai voulu faire l’expérience de l’image, en allant directement sur le terrain, à pied, en marchant aux confins et aux limites, où la ville devient autre chose – théâtre des opérations, espaces en devenir, territoires de spéculation : des Baumettes au Tunnel des Treize Vents, des Trois Lucs à Belsunce, de Château-Gombert à La Pomme, d’Arenc à l’aéroport Marseille-Provence, du square de Narvik à l’avenue Arthur Rimbaud… J’ai construit ces images entre nature morte et paysage, comme des sortes de géographies concrètes. Ce fonds d’images a donné lieu à la production de six affiches photographiques ainsi qu’à l’édition d’une série de quatorze cartes postales. »
- Année•s : 2002-2004
- Commune•s : Métropole Aix-Marseille-Provence
- Commanditaire•s : [Non renseigné]
- © Vincent Bonnet
Documentation :
Vincent Bonnet_Annexes_Inventaire (pdf)Vincent Bonnet
Diplômé de l’École Nationale Louis Lumière en photographie, il est engagé dans le champ de la création à plusieurs titres : en tant que conférencier, commissaire, éditeur, enseignant mais d’abord en tant qu’artiste.
Si la photographie est son médium privilégié de création, sa problématique est celle de l’image en général et de ses enjeux publics en particulier. Depuis près d’une quinzaine d’années, sa pratique artistique évolue entre une approche documentaire et la construction rigoureuse d’images reproductibles – accompagnées de campagnes de diffusion dans l’espace public, avec des photographies imprimées en nombre sur des supports tels que la carte postale, le tract, le flyer, l’affiche, l’auto-collant, le journal, le livre etc. Ces actions représentent autant de manières d’investir, de façon éphémère, « le champ social et politique ». Il a été membre actif de la revue café verre, du collectif d’artistes de la compagnie, (Marseille) et du groupe Ici-Même [Gr.]. Il travaille actuellement à une thèse de création autour de « L’image entre le degré zéro et un ».
Martine Derain
Républiques
À propos de la série
J’ai repris ici le fil d’un travail sur ce qui lie la maison et la chose publique comme on peut le voir dans l’exemple D’un seuil à l’autre, avec Dalila Mahdjoub – installation pérenne sur le seuil d’un foyer Sonacotra à Belsunce. À cela, s’ajoute l’expérience, cette fois rendue plus complexe encore par le compagnonnage des militants de Centre-Ville Pour Tous, de deux chercheurs et d’une institution de l’État, tous producteurs de discours…
Je me suis résolument placée aux côtés des habitants ; j’ai partagé et documenté leur lutte – une belle bataille ! La recherche-action, arrivée après l’engagement premier, m’a permis d’imaginer un nouvel agencement de mes « préoccupations d’espaces ». En naviguant de l’un à l’autre, traversé par le politique, le scientifique et l’artistique, l’accumulation de matière sans certitude, mais ne se résignant pas à l’ordre du monde, a permis qu’un chemin se dessine.
Hors d’une simple dénonciation ou d’un constat, la transformation de la colère ressentie a permis d’agir en proposant des images et des gestes ancrés dans l’expérience qui ne serviraient aucune idéologie (pas même une contre-idéologie comme le dit Dan Graham). Sans tenter d’expliquer ou d’illustrer un quelconque problème social ou politique, sans doute, ai-je choisi, pour commencer, de photographier – exercice silencieux du regard et de l’écoute, entre activité et passivité—afin d’échapper à tout discours fonctionnaliste ?
Dans l’action peuplée et bruyante, il y avait comme en creux, à la fois l’absence, et les absents : ceux qui partaient discrètement, comme soustraits à la vue, ou ceux que nous n’avions pas pu compter, partis avant le début de la mobilisation. Mais ces absents manquaient-ils ? Et à qui ? Sont alors arrivées les images des appartements haussmanniens tout récemment quittés par leurs habitants ou ruinés par leurs propriétaires – « dévitalisés », tel est le mot, rendus inhabitables – et inhabités parfois depuis plus de vingt ans. Au sol, un voile fin de poussière, qu’aucune empreinte de pas ne déchire. En regard de ces images, une tension s’opère entre ces demeures où les habitants n’étaient plus, de celles où ils ne pouvaient être, de celles qui se construisent tout à côté, dans cette « zone de prospérité partagée » appelée Euroméditerranée, mais dépeuplées aussi, prévues pour les « classes moyennes et supérieures » tant attendues, tant espérées. Entre Haussmann et Kaufman, des images sans action, sans événements, presque vides, d’un vide qui me rendait visible le lent processus de transformation de la ville, sinon d’éviction de certains de ses citoyens, et les failles voire la faillite, d’un « projet » rêvé d’un centre-ville qui ne serait pas le centre de Marseille (Ascaride-Condro)…
- Année•s : 2004-2010
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Martine Derain
Documentation :
Derain_documentation (pdf)Martine Derain
Martine Derain est artiste et éditrice. Elle aime travailler en dialogue et en collectif. Depuis ses premières créations en France, en Palestine (avec Dalila Mahdjoub) ou au Maroc (avec Hassan Darsi), elle noue des récits qui lient histoires collectives et espace public. Les livres qu’elle publie au sein des éditions commune, qu’elle a fondées en 2010, comme les films dont elle est aujourd’hui la « conteuse », sont des fables documentées dont les lignes narratives entremêlent art et politique, urbanisme et poésie. La mise en récit d’archives trouvées ou confiées, institutionnelles ou personnelles – fonds constitués au cours de longs compagnonnages avec des lieux ou des êtres – y tient une place essentielle.
Sur l’autre versant de la création, elle se préoccupe de faire vivre (d’administrer, en français ancien, prendre soin) des lieux-outils de travail pour artistes : elle a partagé l’expérience de la Compagnie, elle accompagne aujourd’hui celle du Polygone étoilé, lieu de création cinématographique non-aligné.
Philippe Piron
Arenc
À propos de la série
Projet documentaire sur le quartier d’Arenc (Marseille) avant sa transformation par le projet d’aménagement urbain Euroméditerranée. Ensembles de photographies de paysages urbains et d’architectures. Projet réalisé avec le soutien de l’association le Mur du Son.
- Année•s : 2007-2008
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Philippe Piron
Documentation :
Philippe Piron_Arenc_Annexes_Inventaire (pdf)Philippe Piron
Philippe Piron a d’abord travaillé sur des projets d’analyse et de gestion des paysages ruraux au sein de différents organismes (CAUE, Conseil général…). Cette première approche technique du paysage sera complétée par une formation en photographie dirigée par Serge Gal à l’école Image Ouverte (Gard).
Après s’être établi à Marseille, il réalise des commandes pour des architectes et des institutions (CAUE13, DRAC PACA, Euroméditerranée…). Il développe également des projets personnels et participe notamment à de nombreuses marches collectives qu’il documente photographiquement en réalisant des carnets. En 2013, au côté d’artistes marcheurs, il participe à la création du GR2013, sentier de grande randonnée périurbain. Il s’installe à Nantes en 2012. Il est né en 1974 dans le Maine et Loire.
John Davies
Fos-sur-Mer and the Industrial Zone
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 1994
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Ville de Fos-sur-mer
- © John Davies / Adagp, Paris 2020. Courtesy : Galerie des filles du Calvaire
John Davies
John Davies was born in 1949 in County Durham, England. His formative years were spent living in both coal mining and farming communities. His images of Ireland, Scotland and England, made between 1976-1981, were first published in the monograph Mist Mountain Water Wind 1985. In 1981 he started in Sheffield to document the urbanised landscape of Britain – first published in his book A Green & Pleasant Land 1987. An update of his British work from 1979 – 2006 was published in the book The British Landscape 2006.
During the mid 1980’s and throughout the 1990’s he was invited to work on numerous landscape and urbanisation commissions in France, Italy, Spain, Holland, Belgium, Portugal, Germany, Austria and Switzerland. His first commissioned work in France started in 1987 for a group book project ‘Les Quatre Saisons du Territoire’ for CAC, Befort. In 1994 he was commissioned to work in Fos-sur-Mer and the Industrial Zone – this was published as a group book by Fos Action Centre & Images En Manoeuvres, Fos natures d’un lieu 1999.
John Davies has four monographs that were commissioned and published in France: Temps et Paysage 2000, Le retour de la nature 2001, Seine Valley 2002 and Shadow – Terrils d’Europe du Nord 2016 (featuring the Artois’ mining basin in Northern France).
A fundamental aspect of his approach in visualising landscape is the sense of power it can symbolise and evoke and as metaphor; reflecting emotional and spiritual states. At the same time Davies is aware of the landscape representing power in terms of land ownership and material wealth.
Emma Riviera
Des Idées fausses
À propos de la série
Comme l’a titré un journal local, Fos-Sur-Mer c’est un peu : “le ciel, les oiseaux et le cancer”.
Fos est avant tout connue pour ses usines, sa pollution et son taux de cancer élevé et depuis peu, pour ses gilets jaunes. C’est une ville étrange et paradoxale, où l’on n’a pas forcément envie de passer des vacances.
Elle est perchée en haut d’une colline, entourée de chevaux, de taureaux et d’infrastructures post-apocalyptiques qui rejettent de la fumée verte. L’été, les touristes affluent dans ce lieu de villégiature.
Et au milieu de tout ça, les habitants. Ils continuent leur vie, rythmée par la mer et les fêtes locales organisées par la mairie. Mais au loin gronde toujours le bruit des luttes sociales et politiques, laissant elles aussi leurs traces dans le paysage.
- Année•s : 2018-2020
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Emma Riviera / ADAGP, Paris
Documentation :
Riviera_documentation (pdf)Emma Riviera
Emma Riviera vit et travaille entre Paris, Marseille et Arles. Après une Licence Cinéma et Audiovisuel, elle intègre l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles en 2017 dont elle sort diplômée en 2021. Elle a développé une pratique de la photographie autour de la notion de rencontre, que ce soit avec un sujet ou un spectateur. Ce médium est pour elle, un moyen de raconter des histoires glanées par monts et par vaux. Elle a, entre autres, été exposée aux Rencontres d’Arles, à l’exposition collective 100 % à la Villette à Paris, au festival des Boutographies à Montpellier et au Festival Parallèle à Marseille. Elle a participé à plusieurs résidences de créations comme celle de la Villa Pérochon à Niort ou aux Ateliers Vortex à Dijon. Actuellement, elle est exposée au festival Usimages dans le bassin creillois et au Centre Photographique Marseille.
Yasmine Goudjil
Dent creuse
À propos de la série
Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties. Une telle situation peut résulter d’une ancienne zone agricole où une unique parcelle est restée vierge de constructions, ou de la démolition d’un édifice sans reconstruction ultérieure.
Le projet « Dent Creuse », a été initié en 2018 suite aux effondrements de la rue d’Aubagne. Cette catastrophe, qui a bouleversé nombre d’habitants, et a révélé des années de délaissement de la part des politiques publiques sur la question du logement à Marseille.
Qu’est-il advenu de cet espace ? Comment a été traité le vide généré par la disparition des immeubles ?
Dans un premier temps, il a été invisibilisé. En effet, quelques semaines après l’événement, un agent de sécurité présent 24h/24 m’a alors interdit de prendre des photos de cet espace. Il a été entièrement repeint en blanc, sans aucune commémoration de la part de la ville pour rendre hommage aux personnes décédées. En observant au fil des mois la gentrification de la rue d’Aubagne se poursuivre à grande vitesse, du bas vers le haut, j’ai décidé de représenter le vide de manière graphique. Cette forme est devenue le symbole d’un déséquilibre plus global. Comme on peut le voir sur l’image (#2), j’ai découpé la forme de la dent creuse dans du papier noir et l’ai collée sur un mur extérieur. Cette manipulation révèle une dimension squelettique, presque fantomatique, de la résurgence de cet espace effondré. Par la suite, j’en ai fait un pochoir et je suis venu inscrire par le biais du tag les immeubles en péril du 1er arrondissement. Cette démarche me permet de signaler les lieux en danger, je réitère ainsi cette marque dans l’espace urbain. Ensuite, j’ai photographié ces portes condamnées, marquées par la forme abstraite de la dent creuse de la rue d’Aubagne. J’ai ensuite rassemblé ces photographies ainsi qu’une liste de tous les immeubles condamnés pour péril dans le 1er arrondissement de Marseille (8 pages) dans un fanzine. J’invite le spectateur à prendre conscience de l’ampleur de la situation et, s’ils le souhaitent, à se rendre sur place. Ce travail a également une dimension mémorielle.
Après avoir identifié les immeubles menaçant de s’effondrer et les avoir condamnés, la ville de Marseille se devait de changer son image afin d’accroître son attractivité. En blanchissant les façades, on cherche à donner une impression de propreté et de sécurité dans les rues. Ainsi, des dizaines d’échafaudages ont été installés rue après rue pour entreprendre d’importants travaux de rénovation des façades. Les filets et les bâches bleues des échafaudages prennent des formes diverses. Le bleu vif de ces filets et bâches vient à la fois colorer et stigmatiser ces bâtiments. Ces photographies révèlent la mise en scène de la ville, qui met en scène elle-même ses propres insuffisances. J’interroge également la notion de réparation en observant les éléments modestes des échafaudages, compte tenu de l’ampleur du travail à accomplir. C’est une tentative de maintenir un équilibre fragile à travers la réparation.
- Année•s : 2018-2022
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Yasmine Goudjil
Documentation :
Yasmine_ Goudjil_documentation (pdf)Yasmine Goudjil
Yasmine Goudjil est une artiste marseillaise née en 1995. Après avoir obtenu une licence en Arts plastiques à l’université d’Aix-Marseille, elle a intégré un master à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles.
Dans une ville en constante évolution, elle s’efforce de capturer les formes des espaces en transformation en se focalisant sur les chantiers. À travers ces espaces d’inachèvement et d’éphémère, elle interroge le devenir de la ville et mène une réflexion sur l’ordre urbain et notre environnement construit. Pour elle, le chantier représente un espace d’ouverture, une brèche dans le tissu urbain qui laisse place à la réflexion sur l’avenir de nos espaces de vie.
Philippe Piron
Repérage GR2013 : Martigues – Rassuen
À propos de la série
Cette série comme toutes celles réalisées lors des parcours de repérage du GR2013, servait à documenter le GR2013, enregistrer la succession des paysages traversés.
- Année•s : 2011
- Commune•s : Istres, Martigues
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Philippe Piron
Philippe Piron
Philippe Piron a d’abord travaillé sur des projets d’analyse et de gestion des paysages ruraux au sein de différents organismes (CAUE, Conseil général…). Cette première approche technique du paysage sera complétée par une formation en photographie dirigée par Serge Gal à l’école Image Ouverte (Gard).
Après s’être établi à Marseille, il réalise des commandes pour des architectes et des institutions (CAUE13, DRAC PACA, Euroméditerranée…). Il développe également des projets personnels et participe notamment à de nombreuses marches collectives qu’il documente photographiquement en réalisant des carnets. En 2013, au côté d’artistes marcheurs, il participe à la création du GR2013, sentier de grande randonnée périurbain. Il s’installe à Nantes en 2012. Il est né en 1974 dans le Maine et Loire.
Vincent Beaume
Chemins[perdus?]
À propos de la série
Poursuivant une démarche sur la géographie sensible des territoires que je mène depuis plus de dix ans dans la série Chemin[s], j’ai choisi de travailler sur le patrimoine commun, fragile et éphémère.
J’ai porté mon regard sur les chemins qui disparaissent dans la ville et dans les alentours de Saint-Cannat. Mes photographies sont une invitation à reprendre les sentiers ruraux, les pistes pastorales, les chemins de transhumance, les via antiques, romaines ou royales qui traversent notre territoire. Ces chemins, autrefois vivants, tombent aujourd’hui dans l’oubli.
Jonchés par les propriétés privées, barricadés par les rubalises, fils électriques et autres barrières, ces chemins sont souvent méconnus par les promeneurs, habitants et acteurs publics. Transformés en terres agricoles ou confisqués par des particuliers, ces chemins deviennent des terres privées inaccessibles. Cette problématique n’est pas propre à Saint-Cannat et se pose sur l’ensemble du territoire national.
Des chemins qui s’effacent.
Disparaissent dans la broussaille.
Effacent le bruit des pas.
Restera t-il une trace ?
Restera t-il des traits noirs sur les cartes ? Serons-nous capables de les revoir ?
Ces chemins appellent pourtant à une poésie des pas et à la contemplation. Chênes centenaires, bords de rivière, fermes en ruine… Lieux d’une porosité sensible, ils pourraient devenir des territoires d’apprentissage commun sur notre monde.
Voir à nouveau les arbres qu’on ne regarde plus. Les roches qui ne semblent être que de simples cailloux alors qu’elles sont ancrées dans la lente géologie du monde et racontent nos histoires.
Percevoir le paysage de notre quotidien pour en prendre soin et le cultiver.
Voir et regagner ces chemins.
- Année•s : 2020
- Commune•s : Saint-Cannat
- Commanditaire•s : Centre photographique de Marseille, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Patrimoine Commun
- © Vincent Beaume / SAIF
Vincent Beaume
Vincent Beaume, auteur photographe, né en 1980, vit et travaille à Marseille. Formé par Léon Claude Vénézia, son parcours débute au moment du passage de l’argentique au numérique. Alors photographe de presse, la « chasse à l’image » lui renvoie à la morbidité du rapport de notre société à celle-ci. Après la coupure d’une longue marche dont il est coutumier, le retour de Vincent transforme profondément sa relation à la photographie.
Son refus de « la prise de vue » à l’affût, le mène vers l’image-projet, une conception de la relation à l’autre et à un monde sensible partageable.
Ses créations « L’Insomnante », « Chemin[s] », « Le Groupe des 15 » ont été exposées dans de nombreuses scènes nationales (à Gap, Besançon, Marseille, Arras, Foix, Metz…) et des galeries (Zemma, Aux Docks d’Arles, Maison de la Photographie Vivian Maier…). Ces dernières années, il a bénéficié de résidences de création (Institut français du Maroc, Scènes nationales, Résidence territoire (DRAC), Centre Photographique Marseille, etc.) et de commandes institutionnelles (Politique de la Ville, Archives Départementales).
En 2023, il a obtenu la bourse Soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP pour son projet « Chemin[Le Drac] ».
Son attrait aux mélanges des pratiques et écritures artistiques l’ont amené à collaborer avec plusieurs artistes, (Loïc Guénin, Camille Boitel, Claire Ruffin, Robin Decourcy, …) soucieux des passerelles qui existent entre la photographie et les autres formes sensibles.
Atlas Métropolitain — Lamy / Delfour
Énergie
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2013
- Commune•s : Berre-L'Étang, Châteauneuf-les-Martigues, Fos-sur-Mer, Gardanne, Marseille, Martigues
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Lamy / Delfour
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Nicolas Felician
Zone d’influences
À propos de la série
Cette série reprend l’idée qu’un port est au carrefour de différents actes : culture commerce, tourisme… et qu’il subissait les changements de son époque.
- Année•s : 2012
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Nicolas Felician
Hélène David
Noces ou les confins sauvages
À propos de la série
« En 2012, je sollicite l’aide à la photographie documentaire contemporaine du CNAP pour mon projet « Kerkennah, la renaissance du bleu ». Il s’agit de poursuivre une recherche sur le littoral méditerranéen, en explorant les modalités de relations durables entre les habitants des îles Kerkennah – Tunisie – et leur espace maritime. Un premier séjour en Novembre 2012 me permet de poser les bases d’un travail documentaire. Mais, en 2013, je suis contrainte de renoncer à mes déplacements à l’étranger et à mon activité de grand reportage. Je recentre alors cette recherche sur le littoral de ma région, en puisant dans la connaissance familière de ce territoire, mais aussi dans mon expérience intime. Pratiquant la danse contemporaine, la question de la relation du corps à la nature méditerranéenne devient centrale, et la notion de vulnérabilité, celle de la diversité du vivant, soutient en filigrane ce récit en devenir. Je m’appuie également sur l’essai d’Albert Camus, « Noces à Tipasa », où le jeune écrivain raconte son expérience des rives algéroises, comme un vécu fondateur de son « être au monde ». Les mots de Camus stimule un nouvel imaginaire des calanques, et me relie à cet autre rive, en écho à la nôtre. Peu à peu se dessine le récit « Noces ou les confins sauvages ». Bien que contrarié, ce projet a permis de renouveler mon écriture documentaire, et d’aborder par un biais sensible des questions écologiques. Il a ouvert une réflexion, puis un partenariat, avec une jeune institution sur le territoire (2012) : le Parc National des Calanques. La réalisation de l’ouvrage avec Céline Pévrier, éditrice, lance les bases d’une recherche sur l’objet livre, à développer sur de prochains projets. (Avec le soutien du CAC Arts plastiques de la région PACA (Sud), l’aide à l’édition du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, et une souscription du Parc National des Calanques). » Hélène David
- Année•s : 2012-2017
- Commune•s : Cassis, La Ciotat, Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Hélène David
Hélène David
« Depuis 2005, et la co-réalisation de l’ouvrage « Réfugiés climatiques » du collectif Argos, mes travaux documentaires sont inspirés par une « écologie du sensible », selon l’expression de l’anthropologue Tim Ingold. Cette démarche cherche à questionner nos relations au vivant, plus particulièrement en Méditerranée, où j’ai choisi de m’installer en 2008. Dans un contexte de crise environnementale, je souhaite ainsi participer à la construction transdisciplinaire de nouvelles manières d’habiter, en produisant des récits avec d’autres auteurs ou institutions (comme les Archives Départementales des Bouches du Rhône avec la création d’un fond photographique à partir de « L’esprit des calanques » en 2012). Noces ou les confins sauvages, traversée intime du littoral, m’a amené à redéfinir de précédentes pratiques documentaires – des écritures aux objets – et à envisager différemment la place des publics dans le dispositif de création. Après différentes expositions, la publication de l’ouvrage aux éditions sunsun en 2018 et plusieurs acquisitions (Arthotèque Intercommunale Ouest Provence, FCAC Ville de Marseille), je prolonge cette recherche grâce au soutien du CNAP (2019). Il s’agit maintenant de suivre la piste de l’homme-animal : une expérience de la rencontre entre espèces et de la traversée des frontières, pour composer un récit choral de nos relations aux non-humains. Entamé au cours d’une résidence participative en pays de Grasse (Alpes maritimes) en 2018/2019, cette collecte de documents est désormais menée avec les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, pour une restitution à l’occasion du Congrès mondial de la nature en 2021. » Hélène David
Sylvain Duffard
Observatoire photographique des paysages des Alpilles
À propos de la série
« En 2010, le Parc Naturel Régional des Alpilles me confie la conduite de la mission photographique de l’Observatoire des paysages. Dans ce cadre, mon intention a été de saisir quelque chose de l’histoire des lieux sur lesquels je me suis arrêté tout en m’attachant simultanément aux signes révélant les permanences observables comme les transformations paysagères à l’œuvre. Passer par la production de prises de vue – acte par essence furtif – pour interroger le temps long du paysage, voilà pour ainsi dire résumée l’ambition qui est celle du photographe qui intervient dans le cadre d’un tel Observatoire. Après avoir réalisé la campagne photographique initiale au printemps 2011, j’ai re-photographié une dizaine de points de vue durant l’hiver 2012 avant d’assurer successivement la reconduction photographique complète des cinquante points de vue de l’Observatoire en 2013 puis 2017. » Sylvain Duffard
- Année•s : 2011
- Commune•s : Parc Naturel Régional des Alpilles
- Commanditaire•s : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles
- © Sylvain Duffard / Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles
Sylvain Duffard
Né en 1975, Sylvain Duffard est photographe indépendant. Il vit et travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Diplômé de l’Institut de Géographie Alpine (IGA), Université Joseph Fournier de Grenoble en 1999, c’est en autodidacte que Sylvain Duffard développe sa pratique photographique. Se confrontant à la commande dès 2006, il développe un travail portant sur le paysage quotidien, démarche rapidement sous-tendue par l’émergence de questionnements relatifs à ses modes de fabrication. Il fait ensuite l’expérience de la commande publique dans le cadre de missions photographiques consacrées à l’observation du paysage ; commandes inscrites dans le sillage de missions photographiques historiques telle que celle que la DATAR engagea au début des années 1980. Ces expériences constituent pour lui un espace d’apprentissage privilégié et le lieu d’une expérimentation riche et personnelle du paysage. De 2008 à 2010, il répond à une commande de l’Office National des Forêts ; commande qui donnera naissance à sa série « La forêt habitée ». Il réalisera ensuite successivement les séries chronophotographiques de trois Observatoires photographiques des paysages, à l’échelle du Parc Naturel Régional des Alpilles, puis du département de Haute-Savoie et enfin de l’Archipel Guadeloupe. De 2017 à 2018, l’Atelier des Places du Grand Paris lui confie une commande de paysage relative aux sites jouxtant certaines des futures gares du Grand Paris Express.
Éric Bourret
Sainte-Victoire, Sainte-Baume, Alpilles, le temps de la marche.
À propos de la série
Eric Bourret a consacré les trois hivers 2010-2013 à photographier les massifs de la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume et les Alpilles, trois massifs emblématiques des Bouches-du-Rhône. Il a fait de l’arpentage photographique une pratique artistique qui capte le temps de la marche. De son implication physique à l’élément, Bourret tire des images qui se veulent des enregistrements méditatifs des paysages traversés. Le temps de la marche s’inscrit dans l’action Images contemporaines/Patrimoine, coordonnée par le Factotum, aux côtés du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, exposition présentée aux Archives départementales d’Aix en Provence et Abbaye de Montmajour, Arles dans le cadre Marseille Provence capitale européenne de la culture 2013.
- Année•s : 2011-2013
- Commune•s : Massif de la Sainte-Baume, Montagne Sainte-Victoire, Parc Naturel Régional des Alpilles
- Commanditaire•s : Conseil Général des Bouches-du-Rhône
- © Éric Bourret
Documentation :
Eric Bourret_Le temps de la marche_Annexes_Inventaire (pdf)Éric Bourret
Né en 1964 à Paris, Éric Bourret vit et travaille dans le Sud de la France et en Himalaya. Son oeuvre d’« artiste marcheur », s’inscrit dans la lignée des Land Artists anglais et des photographes-arpenteurs de paysages. Depuis le début des années 1990, Il parcourt le monde à pied, traversant tout horizon à toute altitude, effectuant des prises de vues photographiques qu’il nomme « expérience de la marche, expérience du visible ». Dans ces images, Éric Bourret exprime les transformations sensorielles et physiques profondes que provoque la marche. L’expérience du trajet parcouru exacerbe la perception et la réceptivité au paysage. Au cours de ses marches, de quelques jours à plusieurs mois, selon un protocole conceptuel précis qui détermine le nombre et les espacements des prises de vue, l’artiste superpose différentes vues du même paysage sur un seul négatif. Ces séquences intensifient et accélèrent l’imperceptible mouvement des strates géologiques et fige l’éphémère temporalité de l’homme. L’accident, l’imprévu sont assumés dans ce concept de saisies photographiques aléatoires. Elles témoignent d’une expérience subjective, ainsi qu’il le confie lui-même : « Je suis constitué des paysages que je traverse et qui me traversent. Pour moi, l’image photographique est un réceptacle de formes, d’énergie et de sens. » Cet éphéméride photographique désintègre la structure de l’image initiale et crée une autre réalité mouvante, sensible. L’image, née de ce « feuilleté temporel », est vibrante, oscillante, presque animée. Des séries plus factuelles insèrent date, lieu, durée, distance parcourue et transmettent ainsi le rythme et l’espace de ce carnet de marche. Depuis 1990, son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et acquisitions dans les musées et Centres d’art, en Europe, aux États-Unis et en Afrique, notamment the Finnish Museum of Photography à Helsinki ; the Museum of Contemporary Art of Tamaulipas au Mexique ; le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice ; le Musée Picasso à Antibes ; la Maison Européenne de la Photographie de Paris.En 2015-19, il a participé à plusieurs expositions : la 56e Biennale de Venise ; Joburg Contemporary African Art ; AKAA à Paris ; Start à la Saatchi Gallery de Londres ; Shenzhen Art Museum, Chine ; l’Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux ; Sapar Contemporary, New-York ; Xie Zilong Art Museum, Chine.
Pierre-Emmanuel Daumas
Le Champ de L’Ogre
À propos de la série
Le Champ de L’Ogre est un travail personnel. Ce corpus d’image, bien que portant une réflexion sur la ville de Marseille et ses extensions, s’attarde tout particulièrement sur les infrastructures et lieux qui sont en dehors de la ville et qui entretiennent une connivence directe avec la nature. Le regard proposé tente avant tout de comprendre comment les deux univers cohabitent. Ce n’est pas tant la lutte de deux protagonistes que leur rencontre qui est intéressante. Ces nouveaux paysages ainsi créés par leur chevauchement sont riches de sens et portent avant tout à la réflexion plus qu’à une forme de dénonciation. À L’image de Dieu, l’homme créa la ville, ogre insatiable qu’il faut nourrir et dont l’homme aménage le territoire dans l’espoir d’y assouvir l’appétit du monstre. Ne pouvant lui créer son propre monde, l’homme lui abandonne son propre jardin. Cette recherche photographique, s’attelle à recenser les infrastructures qui viennent alimenter Marseille. Les gazoduc, les lignes à hautes tensions, ainsi que les barrages apportent l’énergie. Les routes, les chemins de fer et voies de communication apportent les travailleurs ainsi que les matières premières. Ces réseaux permettent à la ville de communiquer au delà de ses frontières et de son territoire. Ils s’étalent, s’immiscent tel des tentacules. Les bassins de rétentions d’eau et les canaux d’irrigations épanchent sa soif. Les carrières dévorent la terre pour assouvir l’expansion de la ville et fournissent les matériaux nécessaires à sa construction. Mais comme tout être, l’ogre digère ce qu’il engloutit et développe donc des stratégies afin de terminer le processus de digestion. En ce sens les déchèteries, les décharges sauvages, comme les stations d’épuration remplissent leur rôle. Grâce à GoogleMap je scrute les alentours de la ville de Marseille. Cette méthode me permet de déceler les endroits potentiellement intéressant à photographier, leur orientation, les points de vue susceptibles de révéler au mieux le sujet et la manière d’y accéder. Une fois sur place il n’est pas rare de trouver d’autres infrastructures, d’autre lieux à photographier.
- Année•s : 2020
- Commune•s : Aix-en-Provence, Marseille, Métropole Aix-Marseille-Provence
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Pierre-Alexandre Daumas
Pierre-Emmanuel Daumas
Né en 1982, Pierre-Emmanuel Daumas grandi à Nice et est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art de Saint-Luc à Liège en 2004. Attaché à la photographie plasticienne, très vite dans son travail on retrouve une approche qui mélange documentaire et fiction dont les « supports / sujets » vacillent entre portrait et paysage. Il est co-fondateur de l’espace photographique « Fermé le lundi » basé à Marseille. Il intervient depuis 2007 dans les milieux scolaires et sociaux afin d’ouvrir la photographie à un public plus large. Depuis 2019, il anime des ateliers photographiques à la Fontaine Obscure à Aix-en-Provence.
Brigitte Bauer
Montagne Sainte-Victoire
À propos de la série
« La montagne des tableaux de paysages. Depuis longtemps j’ai été intriguée par la présence quasiment constante de montagnes au fond des tableaux de paysages dits classiques. Que ce soit dans les tableaux de Nicolas Poussin ou dans ceux de Claude le Lorrain, Philippe de Champaigne, Jacob van Ruysdaël, Pierre Patel, De Dominiquin et bien d’autres encore, c’est en fait une seule montagne, une certaine forme surgissant de l’horizon qui revient sans cesse. Je sais que la présence de ces sommets lointains peut s’expliquer par des raisons symboliques ou par les besoins de la composition, j’ai beau savoir que cette montagne-type fait partie du répertoire usuel des éléments de paysage, et ce depuis toujours, elle me paraît pourtant être plus que cela.C’est à partir de la montagne du fond que semble se construire le paysage, c’est sur elle que finit toujours par venir le regard. Elle est à la fois point de départ et point d’arrivée. Sa constance et ses variations me sont devenues familières, nécessaires même.Ici, la montagne s’appelle Sainte-Victoire. Ce lieu, quoique chargé comme aucun autre de références picturales et littéraires, est résolument charmeur (comme on dit d’un magicien qu’il exerce un charme). Ce massif calcaire surgissant de la plaine, ces couleurs constamment changeantes, ces chemins qui invitent à la déambulation et en même temps nous tiennent à distance … Comment en parler, puisque tous les qualificatifs appliqués à ce lieu sont devenus tellement banals ? Pourtant, il est difficile de ne pas succomber au charme, et il est impossible de tout voir, de tout saisir en une seule fois, en une seule image. D’emblée, l’idée d’une série d’images s’impose, car l’émerveillement demande à être renouvelé, il me faut retourner sur ce lieu, souvent, pour regarder et essayer de comprendre pourquoi je reste sous le charme. Car il est vrai aussi que parfois l’emprise de la montagne devient trop forte, elle me pèse et elle m’agace, je n’ai plus prise et il n’y a plus d’images, alors je m’éloigne. Et puis j’y retourne. Au fur et à mesure que la quantité d’images augmente, la multiplicité des points de vue, les changements de saison et les variations de lumière font de cette montagne un paysage dont on ne peut faire le tour, dont on ne peut épuiser la diversité. Photographier la Sainte-Victoire – qui finalement se dérobe et reste inaccessible – c’est décliner à l’infini les indispensables questions de l’image : forme, couleur, lumière, construction… J’avais juste voulu photographier une montagne, et c’est devenu un véritable apprentissage des choses du paysage. Le charme de la Sainte-Victoire tiendrait-il dans le fait qu’elle serait toutes les montagnes – serait-ce finalement elle, la montagne du fond des tableaux de paysages ? » Brigitte Bauer, Mai 1999. Publié dans l’ouvrage « Montagne Sainte-Victoire », éd. IEME, Marseille 1999).
- Année•s : 1992-1994
- Commune•s : Aix-en-Provence
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Brigitte Bauer / Adagp, Paris, 2020
Brigitte Bauer
Née en Allemagne (Bavière), Brigitte Bauer vit et travaille à Arles. Après le développement d’une culture du paysage dans ses premières séries de photographies telles que Montagne Sainte-Victoire ou Ronds-Points, ses recherches s’orientent aujourd’hui davantage vers les territoires du quotidien, que ce soit dans l’espace urbain, rural ou familial ou encore à la lisière de son monde professionnel avec Vos Devenirs, un ensemble de portraits de ses anciens étudiants. Parmi ses principales publications, on trouve « Haus Hof Land » (éditions Analogues, 2017), « Aller aux Jardins » (Trans Photographic Press, 2012), « Fragments d’Intimité » (Images en Manœuvres, 2007), « Fugue » (Estuaire 2005), « D’Allemagne » (Images en Manœuvres 2003), « Montagne Sainte-Victoire » (Images en Manœuvres, 1999) et, plus récemment, les auto-éditions « Seoul Flowers and Trees, tribute to Lee Friedlander », 2018 et « akaBB – tribute to Roni Horn », 2019. Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’international et sont présentes dans des collections publiques et privées telles que le Fonds National d’Art Contemporain, la Bibliothèque Nationale de France, la Deutsche Bank, l’Union des Banques Suisses, le musée Carnavalet, le Centre de Photographie de l’Université de Salamanca…. Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 1990 et de l’Université Aix-Marseille en 1995, Brigitte Bauer enseigne la photographie à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes.
Atlas Métropolitain — Cantin / Crist / Leone
Hydrographie
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2011
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Cantin / Crist / Leone
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Thibaut Cuisset
Le pays clair, Camargue
À propos de la série
« En collaboration avec la Tour du Valat (Arles), l’association Asphodèle, à l’initiative de sa directrice Laetitia Talbot, a invité le photographe Thibaut Cuisset en Camargue pour une résidence déployée en trois temps – automne 2011, puis printemps et hiver 2012 –, avec pour mission de photographier les paysages qui sont ceux de cet espace singulier modelé par le delta du Rhône.
Les photographies réalisées par Thibaut Cuisset pendant cette résidence ont fait l’objet d’une exposition présentée simultanément à la galerie L’espace pour l’art (Arles) et au Magasin électrique, Parc des ateliers SNCF, Association du Méjan (Arles), durant l’été 2013.
Publié à l’occasion de ces expositions, l’ouvrage Le pays clair – Camargue rassemble ces photographies accompagnées d’un texte de l’écrivain Jean Echenoz, commandé à celui-ci par l’association Asphodèle et les éditions Actes Sud. »
Jean-Paul Taris, président de l’association Asphodèle In CUISSET Thibaut, Le pays clair – Camargue, Actes Sud
- Année•s : 2011-2012
- Commune•s : Arles, Étang de Vaccarès, Le Sambuc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Salin-de-Giraud
- Commanditaire•s : Association Asphodèle, Tour du Valat
- © Thibaut Cuisset / Adagp, Paris, 2020.
Documentation :
Thibaut Cuisset_Le pays clair, Camargue_Annexes_Inventaire (pdf)Thibaut Cuisset
Né en 1958 à Maubeuge, décédé en 2017 à Paris.
Ancien pensionnaire de la Villa Médicis à Rome(1992-1993) et de la villa Kujoyama à Kyoto (1997), Thibaut Cuisset s’est consacré, depuis les années 80, à la photographie de paysage à travers le monde, de la Namibie au Japon, en passant par le Venezuela, la Syrie et la France (Corse, Bretagne, Val de Loire, Normandie, Hérault…).
Thibaut Cuisset est le lauréat du prix de photographie 2009 de l’Académie des Beaux-Arts pour son projet sur la campagne française.
Son travail a notamment été montré en 2017 lors de l’importante exposition ‘Paysage français : une aventure photographique (1984-2017)’ réunissant une centaine de photographes iconiques à la Bibliothèque nationale de France, et lors du festival Images Singulières de Sète ; en 2014 à l’Hôtel Fontfreyde – Centre Photographique à Clermont-Ferrand ; ou encore à Arles en 2013. En 2015, il fut lauréat du Prix Résidence pour la Photographie de la Fondation des Treilles.
Son œuvre, d’une très grande richesse, a été l’objet de nombreuses acquisitions dans des collections privées et publiques telles que le Musée National d’Art Moderne du Centre Georges Pompidou, la Maison Européenne de la Photographie, la Société Générale ou le Musée Carnavalet à Paris.
« Le travail photographique de Thibaut Cuisset se déploie par campagnes successives et, à chaque fois, un pays différent fait l’objet de la série. Dans ces campagnes généralement assez longues où le repérage se dilue peu à peu dans la prise, aucune place n’est laissée à l’improvisation ou à l’accidentel et d’autant moins que nous sommes avec elles aux antipodes du reportage : un pays n’est pas le terrain d’une actualité qu’il faudrait couvrir, ni celui d’un réseau d’indices qu’il faudrait capter, mais un ensemble de paysages où le type se révèle lentement, à travers des scènes fixes qui sont comme autant de cachettes. La Turquie, l’Australie, l’Italie, la Suisse, l’Islande, les pays de Loire, et j’en oublie, ont été ainsi visités et prospectés. » Extrait de « L’étendue de l’instant » par Jean-Christophe Bailly
Christophe Bourguedieu
Marseille
À propos de la série
« Il s’agit d’un travail personnel. Comme pour la majorité de mes projets, j’en ai financé la réalisation. J’ai passé deux étés à Marseille, où j’ai travaillé au jour le jour, en fonction des rencontres, ou plus souvent, de la difficulté d’en faire sans intermédiaires. L’idée qui s’est le plus vite dégagée est celle que suggéraient cette lumière très verticale et les tensions de la vie quotidienne, celle d’une histoire où se croiseraient des réminiscences de ma vie au Maroc, dans le sud de la France, des lectures (« L’été » de Camus, en particulier) et la brutalité de certaines évidences : les matériaux, les climats, les individus, les postures. Les tirages actuellement disponibles ont été financés par Le Bleu du ciel (Lyon) et De Visu (Marseille). » Christophe Bourguedieu
- Année•s : 2009-2010
- Commune•s : Ensuès, Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Christophe Bourguedieu
Christophe Bourguedieu
Photographe, Christophe Bourguedieu a travaillé en Finlande, aux État-Unis et en Australie et, depuis 2009, majoritairement en France (Marseille, Clermont-Ferrand, Saint-Nazaire). Il est l’auteur de plusieurs livres : « Le Cartographe », « Tavastia », « Éden et Les Passagers », chez Le Point du Jour Éditeur, et « La Montagne » aux éditions Loco. Ses images figurent dans diverses collections publiques et sont régulièrement montrées en France et à l’étranger : 779 (Paris), Musée d’Art Contemporain (Lyon), Centre photographique de Clermont-Ferrand, Centre Régional de Cherbourg-Octeville, Photographers’ Gallery (Londres), Finnish Museum of Photography (Helsinki), Boxgalerie (Bruxelles), Musée de la photographie (Anvers), Bloo Gallery (Rome), Centre de la photographie (Genève), Fremantle Arts Centre (Australie)…
Pablo Rigault-Béligand
Paysage impossible
À propos de la série
Régulièrement en transit entre Marseille et Arles, j’ai longuement observé à travers la vitre du train qui offre une vision panoramique du paysage, les vastes plaines des Coussouls de Crau. Ces étendues planes, disparates, mystérieuses et arides, évoquent un paysage aux allures de Far-West français qui a nourri mon imaginaire, peut-être un fantasme, mais aussi une certaine inquiétude, une appréhension, lorsque je m’imaginais au milieu de ce vide apparent. Qu’y trouverais-je ? Quels seraient les signes, les sons ? Comment se déploient ces chemins noirs à peine perceptibles ? Comment s’y mouvoir ? Enfin, que se passe-t-il dans ces plaines rocailleuses ?
J’ai entamé mes explorations en partant de la gare de Saint-Martin de Crau, longeant la voie ferrée, parfois jusqu’à Miramas, afin de découvrir davantage ce paysage, de fouiller ces chemins sinueux que j’avais aperçus au loin, de m’assurer de leur existence réelle et de comprendre leur atmosphère. Mon parcours s’est révélé plus complexe que prévu : propriétés privées, riverains inquiets de ma présence, terrains militaires dont l’accès strictement interdit et dangereux ne m’ont été révélés qu’après-coup. Les sols que j’avais foulés à de nombreuses reprises se sont avérés potentiellement dangereux. Quelques minuscules panneaux disséminés ici et là, au beau milieu de rien, face à de rares troupeaux et autres traces d’une vie discrète, affichaient la mention « danger de mort ».
J’ai tenté de transcrire en images ces points de tension, de dresser le portrait de ce lieu qui se révèle à la fois une réserve naturelle magnifique et un territoire altéré, amputé, rendu hostile à l’homme par l’homme.
- Année•s : 2021-2022
- Commune•s : Saint-Martin-de-Crau
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Pablo Rigault-Béligand
Pablo Rigault-Béligand
Après avoir travaillé comme tireur au studio AZA à Marseille dans le cadre de son BTS en photographie, Pablo Rigault-Béligand a souhaité entreprendre des études plus approfondies sur l’image. Pour cela, il s’est orienté vers l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles où il débutera un master en septembre 2023. Sa démarche photographique s’articule toujours autour d’un lieu, d’un topos, dont il étudie en premier lieu les ambiances, les émotions et l’histoire. Sensible à la poésie des paysages, qu’ils soient urbains ou ruraux, il ne se contente pas de flâner, mais préfère dériver et créer des situations. Il fouille, retourne, balaye et marche. Les traces qu’il conserve de ces expérimentations et recherches se traduisent en images, en textes tels que des nouvelles ou des poésies, en bandes sonores, en carnets informels, en cartographies surréalistes et en collages.
Lucien Ayer
Là où le feu
À propos de la série
Il y a environ 10000 ans, le dessèchement de l’ancien delta de la Durance a donné naissance à la région des Coussouls, située entre Arles et Fos-sur-Mer. Ce territoire se caractérise par le charriage de galets et la formation d’une sédimentation minérale qui empêche la croissance des plantes. Il est considéré comme une steppe en raison de sa faune et de sa flore spécifiques.
Visuellement pauvre, ce territoire est composé par des éléments qui échappent à la vue, tels que le passage de pipelines en son sol ou encore des zones militaires interdites d’accès. Ce sont les bergeries qui forment le relief de ce territoire plat et aride dans ce lieu aux enjeux majeurs tant à l’échelle nationale qu’à l’internationale. La série photographique explore ainsi ce territoire en utilisant l’analogie du feu.
- Année•s : 2022
- Commune•s : Plaine de la Crau
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Lucien Ayer
Lucien Ayer
Diplômé de l’École Nationale Supérieure de la photographie d’Arles, Lucien Ayer se consacre à la photographie documentaire contemporaine. Son travail explore la manière dont les espaces sont habités à travers le médium photographique. Il met en relation l’architecture vernaculaire et son environnement. Il accorde une grande importance à l’évolution des milieux dans lesquels il réalise ses séries, qu’ils soient urbains ou ruraux, et cherche à documenter les enjeux qui les caractérisent.
Jean-Christophe Béchet
Marseille, ville natale
À propos de la série
« Marseille appartient à qui vient du large », Blaise Cendrars.
« J’ai habité Marseille jusqu’à l’âge de 21 ans. Depuis 1985, je vis « ailleurs ». Mais je reste un « marseillais ». A chaque retour dans ma ville natale, je fais le même trajet, attiré, aimanté, par le bord de mer. Je marche de la Joliette au Prado, de la Pointe Rouge à Callelongue. Et je photographie… Je suis au milieu de nulle part et pourtant je suis encore dans le huitième arrondissement d’une cité qui s’étire au delà du raisonnable… Si j’aime autant les grandes métropoles, les voyages lointains et les montagnes inhospitalières, c’est sans doute à Marseille que je le dois. La ville, le dépaysement, la pierre. L’urbain, l’ailleurs, le minéral. Les trois fondements de mon parcours photographique viennent de Marseille. Ils en sont aussi la matrice, les racines. Je n’ai compris cela que récemment, quand j’ai commencé à travailler sur ce livre. La lecture de Blaise Cendrars, dans « l’Homme foudroyé », m’a aidé. J’avais trouvé un guide « étranger » et décédé dans ma « ville natale »… Je devais faire le point, voir si mes images « marseillaises », souvent intimes et personnelles, livraient quelques vérités sur une ville insaisissable. Car Marseille, chaque habitant le sait, n’est pas une « vraie » ville. C’est un ensemble de villages, une suite de petites entités. C’est un sujet impossible pour un photographe. Marseille s’échappe de tous les côtés. Ici c’est le son, pas seulement l’accent, mais les paroles, le bruit, le soleil, le vent, qui créent l’unité de la ville…Aujourd’hui, trop de clichés sont associés à la ville ; on ne sait plus quand on est dans le « vrai », dans le « réel », dans une « fiction »… Avec Marseille, on navigue à vue et on sait que de toute façon, on ratera sa cible. Alors, tant pis allons-y, jetons nous à l’eau… Oui, Marseille est d’abord pour moi la ville de mon enfance, de mes souvenirs, de mes premières photos et de mes premières amours, oui c’est une ville sensuelle et distante, chaleureuse et froide, excessive et cachée, inquiétante et débonnaire, vulgaire et enthousiasmante… Ici on parle trop… trop fort, trop vite, trop longtemps et Marseille a surtout besoin qu’on la laisse tranquille et qu’on écoute le vent, la mer et les mouettes du Frioul… » Jean-Christophe Béchet
- Année•s : 2013
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Jean-Christophe Béchet / SAIF
Documentation :
()Jean-Christophe Béchet
Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet vit et travaille depuis 1990 à Paris. Mêlant noir et blanc et couleur, argentique et numérique, 24×36 et moyen format, polaroids et « accidents » photographiques, Jean-Christophe Béchet cherche pour chaque projet le « bon outil », celui qui lui permettra de faire dialoguer de façon pertinente une interprétation du réel et une matière photographique. Son travail photographique se développe dans deux directions qui se croisent et se répondent en permanence. Ainsi d’un côté son approche du réel le rend proche d’une forme de « documentaire poétique » avec un intérêt permanent pour la « photo de rue » et les architectures urbaines. Il parle alors de ses photographies comme de PAYSAGES HABITÉS. En parallèle, il développe depuis plus de quinze ans, une recherche sur la matière photographique et la spécificité du médium, en argentique comme en numérique. Depuis 20 ans, ce double regard sur le monde se construit livre par livre, l’espace de la page imprimée étant son terrain d’expression « naturel ». Il est ainsi l’auteur de plus de 20 livres monographiques. Ses photographies sont aussi présentes dans plusieurs collections privées et publiques et elles ont été montrées dans plus de soixante expositions, notamment aux Rencontres d’Arles 2006 (série « Politiques Urbaines ») et 2012 (série « Accidents ») et aux Mois de la Photo à Paris, en 2006, 2008 et 2017.
Franck Pourcel
La petite mer des oubliés – Paradoxes
À propos de la série
Dans l’esprit des gens de passage depuis l’autoroute ou sur les routes et voies de chemin de fer qui arborent l’étang de Berre, mais aussi à l’atterrissage à Marignane, ou depuis les villes extérieures, l’homme n’existe plus sur ce territoire. Il n’est plus à sa place, il a été oublié. Les baignades ne se pratiquent plus, le chasseur prend son gibier au supermarché de la zone commerciale, les cabanons sont en ruines et ont laissé place aux puissantes cuves de pétroles, le pêcheur n’est plus dans sa barque… L’homme s’est laissé engloutir par ces kilomètres de tuyaux métalliques et la fumée qui sort des cheminées, mêlée aux douces ondulations d’une eau poussée par le vent vers la mer donnent au spectateur la nostalgie d’un passé révolu. Les machines technologiques et industrielles ont dépassé la présence humaine, par les balais incessants des avions, et tous les signes d’apocalypse renforcent ces absences. Le vide est partout. Le déséquilibre du milieu est flagrant, donnant ce fort sentiment de désorientation et cette vision de cohabitations incohérentes : salins, culture maraîchère, centres commerciaux, plages, criques, industrie… L’étang rencontre une poétique bien différente de celle d’antan peinte par Ziem, narrée par Pelletan. Pourtant, ces hommes et ces femmes vivent encore sur l’étang et les histoires voguent encore. Ainsi, il n’est pas étonnant de croiser sur les marchés ces « hommes de l’autre époque », aux épaules larges, aux mains lourdes et lacérées par les filets, ou d’apercevoir perdu dans une immensité industrielle, un nuage d’oiseaux accompagnant les derniers « bateaux ivres » dont l’ivresse est justement de se trouver sur cette « petite mer » pour « fuir » le temps et l’espace surchargés d’une époque moderne. Il n’est pas étonnant non plus d’apercevoir des dizaines de voiles de kite surf ou de planches à voile balayant la plage du Jaï entre Marignane et La Mède ou d’entendre les vrombissements des moteurs surpuissants Offshore dans le port de Saint-Chamas. La vie y est partout, aux pieds de la ville nouvelle de Vitrolles, aux pieds de la raffinerie de Total la Mède, le long du canal du Rove. On pourrait penser que l’homme n’est plus à sa place dans cet univers et pourtant, tous les univers se côtoient dans une opposition volontaire qui semblerait oppressante pour tout individu extérieur à ce monde. Il semble surprenant de constater avec quelle fascination, « l’homme est capable de faire abstraction d’un univers d’apocalypse ». Le lieu semble garder sa poétique et son enthousiasme.Tous les points de vue qu’on peut prendre sur l’étang ne suffisent pas à constituer un paysage. Ils sont réduits au statut de fragments. En permanence, le regardeur est conduit à un travail de cadrage et de recadrage.
- Année•s : 1996-2006
- Commune•s : Berre-L'Étang, Étang de Berre, Martigues, Vitrolles
- Commanditaire•s : ATD Quart Monde, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, GIPREB, Musée archéologique d'Istres, SHADYC, SISSEB
- © Franck Pourcel / SAIF
Franck Pourcel
Franck Pourcel est né en 1965. Photographe hyperactif, il porte une attention toute particulière aux failles de notre temps et aux régions qu’elles abîment – dont l’espace intime des corps. Souci et poétique documentaires définissent son regard, qui longe sans cesse les lignes de partage entre l’habitable et l’inhabitable. Territoires, objets, techniques, gestes : l’accumulation joue un rôle important dans son œuvre. Il s’agit en quelque sorte de faire l’inventaire des formes et modes de vie ayant cours dans un monde globalement ravagé par le capitalisme, pour mieux cerner ses possibilités de réinvention – dont notre survie dépend.
Brigitte Bauer
Aller aux jardins
À propos de la série
« Aller aux jardins est un ensemble de photographies et de deux installations vidéo, réalisé entre 2010 et 2011 dans des jardins, parcs et autres espaces publics à travers le département treize, dans le cadre d’un partenariat de production et de diffusion avec le Service Patrimoine du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Qu’est-ce qu’un jardin ? Y aller, oui, mais pour quoi faire ? Parce que l’on est de passage, en attente, parce que c’est la pause de midi, ou parce que l’on n’a pas de jardin chez soi, ou pas de chez soi tout court. Je perçois les jardins publics comme un immense territoire de relations sociales, d’autant qu’entre les parcs et jardins officiels, s’interposent toujours ces espaces précaires et privilégiés que sont un bout de pelouse, l’ombre d’un arbre – des espaces qui sont investis en tant que jardin.Activités solitaires, entre amis ou en famille ; rencontres furtives ou rendez-vous fixes, les relations sociales du jardin public oscillent également entre l’attitude privée et la conscience d’être dans un espace public, être en contrôle, donc, autant qu’en représentation.Attentive à la théâtralité naturelle – si j’ose dire – et consciente de l’artificialité des espaces eux-mêmes, j’ai voulu être, dans un premier temps du moins, l’observatrice ; celle qui garde une certaine distance. L’espace du jardin s’est ouvert devant moi comme un théâtre où se jouent des scènes sans cesse renouvelées. D’une photographie à l’autre, nous n’avons pas tant affaire à une série qu’à un montage qui crée du mouvement entre les images. Un élément autre s’ajoute ensuite : en passant d’une photographie à l’autre l’on peut s’apercevoir la présence d’un personnage récurrent. Tantôt mêlé à un groupe, tantôt observateur aperçu au loin, il passe au premier plan, se devine ou disparaît puis réapparaît encore. Avec ou sans lui, nous sommes invités à observer ces jardins, à scruter les attitudes des uns et des autres, avec une candeur empreinte parfois d’une légère ironie. Élément de fiction dans des images d’apparence plutôt documentaire, il fait le lien entre les espaces qu’il investit et traverse – du parc citadin aux espaces paysagés en bord de mer, en passant par des lieux, tour à tour, splendides, tristes, laids, vides ou débordants de vie. » Brigitte Bauer.
- Année•s : 2010-2011
- Commune•s : Aix-en-Provence, Arles, Berre-L'Étang, Fos-sur-Mer, Istres, La Ciotat, Marignane, Martigues, Pélissanne, Port-de-Bouc, Salon-de-Provence
- Commanditaire•s : Commande publique, Conseil Général des Bouches-du-Rhône
- © Brigitte Bauer / ADAGP Paris, 2020
Documentation :
Brigitte Bauer_Aller aux jardins_Annexes_Inventaire (pdf)Brigitte Bauer
Née en Allemagne (Bavière), Brigitte Bauer vit et travaille à Arles. Après le développement d’une culture du paysage dans ses premières séries de photographies telles que Montagne Sainte-Victoire ou Ronds-Points, ses recherches s’orientent aujourd’hui davantage vers les territoires du quotidien, que ce soit dans l’espace urbain, rural ou familial ou encore à la lisière de son monde professionnel avec Vos Devenirs, un ensemble de portraits de ses anciens étudiants. Parmi ses principales publications, on trouve « Haus Hof Land » (éditions Analogues, 2017), « Aller aux Jardins » (Trans Photographic Press, 2012), « Fragments d’Intimité » (Images en Manœuvres, 2007), « Fugue » (Estuaire 2005), « D’Allemagne » (Images en Manœuvres 2003), « Montagne Sainte-Victoire » (Images en Manœuvres, 1999) et, plus récemment, les auto-éditions « Seoul Flowers and Trees, tribute to Lee Friedlander », 2018 et « akaBB – tribute to Roni Horn », 2019. Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’international et sont présentes dans des collections publiques et privées telles que le Fonds National d’Art Contemporain, la Bibliothèque Nationale de France, la Deutsche Bank, l’Union des Banques Suisses, le musée Carnavalet, le Centre de Photographie de l’Université de Salamanca…. Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 1990 et de l’Université Aix-Marseille en 1995, Brigitte Bauer enseigne la photographie à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes.
Marie-Pierre Florenson
Parvis Ouest Côté Mer
À propos de la série
Mon lien avec le quartier de la Joliette remonte à mon arrivée à Marseille en 1989. J’ai vécu à proximité de la Major, et à l’époque, la partie de l’esplanade côté mer servait de parking et de terrain de football. À partir de 2011, j’ai développé un intérêt particulier pour ce quartier qui allait subir une transformation radicale avec le projet Euroméditerranée. J’ai redécouvert la beauté du paysage, l’espace en friche et sa diversité d’occupants qui continuaient de s’approprier les lieux, transformant ainsi cet espace en une scène de théâtre surprenante. Que ce soit à travers le mouvement, l’immobilité ou la contemplation, les gens investissaient ce territoire en le traversant ou en s’y arrêtant, créant une « géographie intime dans la géographie », comme l’écrit Paul Ardenne.
Au fur et à mesure des travaux de réaménagement, j’ai souhaité conserver une mémoire de cette période de transition, depuis son état initial d’espace abandonné jusqu’à sa réhabilitation complète. Mon objectif était de rendre compte du changement progressif d’un même lieu, l’esplanade de la Major. Quelles nouvelles transformations allaient apparaître ? La série de photographies que j’ai sélectionnées provient de prises de vue réalisées entre 2011 et 2018.
C’était une sorte de rituel pour moi, un trajet depuis le Vieux-Port jusqu’au MUCEM, puis vers l’esplanade de la Tourette et la Major.
- Année•s : 2011-2018
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Marie-Pierre Florenson / SAIF
Documentation :
Marie-Pierre_Florenson_documentation (pdf)Marie-Pierre Florenson
Mes recherches artistiques explorent plusieurs axes, notamment la mise en scène du corps et l’individu dans l’espace public, en particulier lors de performances, dans les bibliothèques et en milieu urbain. Mes photographies interrogent les relations entre le corps, ses mouvements et ses récits, ainsi que la façon dont on s’inscrit dans un territoire.
J’ai débuté ma carrière au SIRP (Salon de Royan) en 1994 avec une série de photographies mettant en scène une figurine en argile représentant mon double dans différents contextes. Pendant 20 ans, j’ai ensuite développé un travail sur la danse contemporaine, présenté sous forme de diptyques. À partir de 2004, je me suis intéressée aux corps des lecteurs dans les bibliothèques, ce qui a donné lieu à plusieurs installations à Brest (2008), Aix-en-Provence (2010), Aubagne (2011), ainsi qu’à la Bibliothèque Universitaire Saint Jérôme à Marseille (2020 et 2022). Parallèlement, depuis 2006, j’ai porté une attention particulière aux transformations des territoires urbains et à leurs multiples réappropriations, ce qui a donné lieu à différentes expositions, telles qu’à la Urban Gallery à Marseille (2006), au Vol de Nuits à Marseille (2009), au Musée d’Histoire de Marseille (2016) et au MUCEM (2017).
Laurent Malone
Habiter Marseille
À propos de la série
« En novembre 2003, alors que je désire installer mon atelier au cœur du processus de transformation de la ville de Marseille, je négocie avec l’établissement d’aménagement public Euroméditerranée l’accès à un terrain situé avenue Roger Salengro, dans le troisième arrondissement. Alors en attente d’aménagement, il s’agit d’un ancien site industriel dont il ne reste qu’une dalle de béton et un hangar isolés du reste de la ville par une palissade. Au centre de ce terrain, je place une pierre, symbole de ma présence discrète sur le lieu et point de repère à partir duquel je photographie l’espace environnant. De novembre 2003 à juin 2007, je documente ainsi tous les détails de la vie sur ce territoire en sursis, des herbes qui poussent dans les anfractuosités du béton à l’évolution de la vie dans le hangar occupé par des sans-abri qui en ont fait leur domicile, leur lieu de résistance. Je partage leur quotidien, les soutiens dans leurs démarches administratives, les aide à trouver un logement. Indistinctement, je capte, pour en témoigner, les gestes de ces hommes qui dessinent un certain art d’habiter les lieux à travers de simples actions quotidiennes : manger, se vêtir, dormir, boire, laver, se protéger, jardiner, arpenter, etc. Pour affirmer cela : au-delà de l’épuisement, au-delà des apparences, des sujets ici-même ont dessiné le cours d’une vie. » Laurent Malone
- Année•s : 2003-2007
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Laurent Malone / SAIF
Laurent Malone
Laurent Malone, photographe, réalise un travail d’analyse et de documentation des mutations de l’espace urbain à partir de parcours tracés dans les villes. La marche est au centre du processus photographique développé. Les villes sont le lieu d’un rapport de force entre la rationalité incarnée par l’architecture et les usages des habitants qui inventent des ruses et des manières de faire avec pour se réapproprier l’espace. Le plus commun de ces arts de faire la marche, par l’agencement libre des éléments de l’espace géométrique des villes traversées en un parcours, transforme l’ordre imposé en un espace vécu. Véritable ouvroir de ville potentielle, le processus ainsi développé déconstruit le paysage urbain qu’il traverse et le recompose dans un montage photographique qui remet en question le point de vue surplombant de la carte et en fait apparaître la puissance critique. Aussi bien à New York que dans d’autres villes d’Europe et d’Asie, Laurent Malone poursuit une chronique obstinée des mutations urbaines avec une attention pour les usages non planifiés de l’espace public : occupation des passerelles d’autoroutes ou de la banque centrale de Hong Kong par les travailleuses philippines, traversée de New York en ligne droite en direction de l’aéroport JFK (avec Dennis Adams), occupation d’un terrain vague à Marseille, marche en direction de Corviale (Rome)… Ces observations de l’espace public qui sont autant de manières de faire avec, ramènent sans cesse l’architecture urbaine à l’échelle d’occupation humaine, permettant ainsi une nécessaire mutation du regard sur les phénomènes d’exclusion, de réappropriation des espaces et de tout ce qui est considéré comme sans valeur. Ces différents travaux organisés en corpus d’images sont mis en ligne sur www.laurentmalone.com et également publiés.
André Mérian
Standard
À propos de la série
« Standard » est un travail de constat dans le département des Bouches du Rhône, sur la question de l’intervention de l’homme à travers le paysage et ces espaces, sa mutation avec l’architecture, et d’une certaine destruction, feux de forêt, abattage des arbres, construction de nouvelles zones d’habitations, mutation du paysage et de son uniformisation… Ces photographies ont été réalisées en périphérie de Marseille, surtout dans la partie Nord, Carry le Rouet, Sausset les Pins, Vitrolles, Arles, Saint Martin de Crau, et à la limite du département près de Tarascon.
- Année•s : 2010-2011
- Commune•s : Arles, Bouc-Bel-Air, Carry-le-Rouet, Gémenos, L'Estaque, Martigues, Miramas, Parc Naturel Régional des Alpilles, Rastuen, Sausset-les-Pins, Tarascon, Vitrolles
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © André Mérian
André Mérian
« André Mérian est un artiste photographe Français, dans ses photographies documentaires ou fabriquées, la banalité, le dérisoire, le commun, voir l’invisible, nous interrogent sur la question de la représentation.Il expose régulièrement en France et à l’étranger, ses travaux font parties de collections publiques et privées, et font l’objet de différentes monographies. Il est représenté par Les Douches La Galerie à Paris. En 2009, il est nominé au prix Découverte aux Rencontres Internationales de la Photographie en Arles. Depuis un certain temps,il se consacre aux paysages périurbains en France et à l’étranger. L’œuvre photographique d’André Mérian montre un intérêt pour ce qui construit chaque jour notre paysage. Qu’il saisisse des zones périphériques, des centres commerciaux, des architectures de l’organisation humaine, des espaces habités, des chantiers ou des écrans lumineux disposés dans l’environnement public, ses photographies tentent de figer ce qui se dresse autour de chacun, comme le décor moyen, banal, du quotidien. Passée la frontière des villes, l’architecture prend une dimension nouvelle, où le factice, le provisoire et le démontable prennent le dessus. Le résultat est déroutant, et nous interroge sur ces espaces qui s’universalisent, sur le sort réservé à l’homme dans cette esthétique du chaos, ses travaux nous questionnent sur la limite de l’objectivité et de la subjectivité. » Guillaume Mansart, Documents d’artistes PACA
Gaëlle Delort
Le mont incertain
À propos de la série
Cette série a été réalisée dans le cadre de l’atelier pédagogique Fos-sur-Terre, proposé à l’ENSP d’Arles, mené par Gilles Saussier et dont l’objet est un retour sur la commande historique de la DATAR.
Le Mont Incertain recompose un récit de l’ascension fictive du point culminant du delta du Rhône, le crassier du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Inspiré par le roman inachevé de René Daumal, Le Mont Analogue (1952), ce travail prend pour point de départ l’analogie entre ce site industriel et un site naturel de montagne.
Ce travail présente des relevés à la chambre photographique 4 x 5 de la matérialité et des couleurs du crassier, tout en évoquant son ascension. L’usage de la chambre grand format permet une qualité de détails, une topographie révélant la cohabitation d’indices naturels et anthropiques qui composent ce lieu, tout en jouant avec l’image du paysage de montagne. L’usage majoritaire de la couleur donne également à voir la richesse colorimétrique en partie due à la végétation de cette « montagne » de déchets sidérurgiques.
L’image qui ouvre cette série est un tirage par contact de deux images au format 6 x 9 cm réalisées avec un vieil appareil Kodak lors de mon premier repérage. Elle opère une première vision de l’expédition en préparation.
En 2022, ce travail photographique a été présenté en dialogue avec une installation titrée « Prélèvements ». A la manière d’un inventaire de fouille archéologique, des éléments récoltés sur le crassier en mars 2020 sont présentés sur une planche placée au sol, sous les photographies.
- Année•s : 2019-2020
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Gaëlle Delort
Documentation :
Delort_documentation (pdf)Gaëlle Delort
Artiste photographe née en 1988 à Aurillac dans le Cantal, Gaëlle Delort vit et travaille en Lozère. Après ses études à l’École des beaux-arts de Lyon, elle se forme à la photographie argentique auprès de Dominique Sudre. Elle collabore plusieurs années avec des structures publiques et associatives oeuvrant dans le champ de l’art et du spectacle vivant, avant de rejoindre en 2018 l’École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles, où elle obtient en 2022 son diplôme avec les félicitations du jury. Elle présente cette même année son travail dans le cadre de l’exposition Une Attention Particulière aux Rencontres d’Arles. En 2023, elle est invitée par Adrien Bitibaly à Photosa, biennale photographique à Ouagadougou, Burkina Faso, et lauréate Jeune photographie Occitanie du Centre photographique documentaire ImageSingulières pour son projet Karst.
Mis en mouvement par les formes de l’architecture, de la géologie et de la littérature, son travail s’inscrit dans un temps long, celui de l’exploration. Par la collecte d’indices qui composent l’épaisseur d’un lieu et ses paysages, elle s’attache à capter des formes de résonances entre des temporalités humaines et géologiques, jouant de la profondeur du monde et de la surface des images.
Sébastien Normand
Fos-sur-Mer
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2001
- Commune•s : Étang de Berre, Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Sébastien Normand
Sébastien Normand
Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure Louis Lumière en photographie, où il initie une démarche personnelle qui interroge les espaces, les territoires et leurs usages. Ses recherches explorent les rapports qu’entretiennent les objets de la banalité et les personnes avec les lieux dans lesquels ils s’inscrivent. La pluralité des dispositifs plastiques qu’il met en place, lui permet de garder un regard critique sur ses sujets.Jouant d’allers retours entre l’histoire du médium et ses pratiques actuelles, les protocoles de prises de vue développés s’attachent, avec une dimension performative, à faire apparaître des images que seul l’outil photographique peut donner à voir. En 2004 lors d’une résidence à Niort, il part à la redécouverte des paysages de sa prime enfance avec la série « Des courbes de choses invisibles ». En 2005, grâce au soutien de la Fondation de France, il réalise « Un Trajecto Iberico », portraits et paysages, sur les autoroutes espagnoles, de la communauté d’origine marocaine sur le trajet de leurs vacances vers le Maroc. En 2008 durant sa résidence au 104 avec Peau proche du bâtiment, il questionne le rôle politique de l’absence de mobilier urbain dans les choix d’aménagement d’un quartier parisien dit « sensible ». En 2015 il achève un travail sur les îles du Frioul : « Périgée au Frioul ». Durant quatre ans, les nuits de pleine lune il part lourdement chargé de sa chambre 20*25 pour représenter avec l’éclairage lunaire ce territoire insulaire protégé. Il s’agit également de vivre l’expérience nocturne de ces paysages situés au «large» de Marseille, en produisant des images que seul le support photographique peut donner à voir. Depuis trois ans il travail sur un projet dans le massif pyrénéen. Il s’agit d’interroger les modalités de représentation d’un territoire de montagne en confrontant et en mixant des typologies iconographiques et photographiques variées. En explorant l’aménagement du territoire dans ses aspects historique et contemporain, les mythes constitutifs… Les travaux de commandes de Sébastien Normand documentent les réalisations d’artistes, de plasticiens, de créateurs, de chorégraphes qui questionnent la place du corps dans l’espace physique, social et politique, de collectifs d’architectes qui interrogent et expérimentent l’acte de construire et d’habiter.
Sam Phelps
Belladone
À propos de la série
Bien qu’entièrement photographié dans des espaces publics, en évitant les repères attendus et les clichés préexistants de Marseille, « Belladone » se présente comme l’anti- portrait d’une ville. Tout comme l’« anti-roman », illustré dans Le Portrait d’un inconnu de Nathalie Sarraute, « Belladone » résiste aux prémisses traditionnelles de l’intrigue et du personnage. Des représentations conventionnelles de la beauté y sont montrées, bien que les images penchent le plus souvent vers un aspect rugueux, voire trivial, dont l’authenticité ne peut être contestée. Les photographies, pour la plupart capturées dans les mouvements de va-et-vient d’une foule, effectuent un zoom sur le singulier. Les yeux du spectateur sont attirés par les détails, comme la particularité d’un vêtement que porte le sujet, souvent photographié de dos, ou avec le visage caché. Il n’y a pas de distraction dans le cadre pour laisser place à la relation du sujet avec son environnement immédiat. Marseille invite le photographe flâneur, spectateur urbain, à jouir de ce que Balzac appelle « la gastronomie de l’œil ». Tout est à prendre, et sans demi-mesure. Au fil des photos, des échos sont créés dans la posture du sujet ou par un trait physique commun. Un effet de boucle harmonieux s’opère, alors que l’œil scrute et enregistre la similitude. Le regard devient investigateur, à la recherche d’indices, de reflets à découvrir. Ce portrait est aussi celui d’une ville en transformation. La plupart du temps, les sujets sont représentés dans des espaces modernes, parfois entrecoupés de verdure ou d’architectures grandioses des siècles précédents. Alors que le renouveau et la gentrification sont en marche, « Belladone » tente de saisir l’essence de cette ville avant qu’elle ne soit nettoyée.
- Année•s : 2017-2020
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Sam Phelps
Sam Phelps
Étudier au Collège des Beaux-Arts de Sydney, travailler dans un atelier de nickelage à Oslo, monter des publicités à Jakarta et œuvrer dans l’industrie de la mode à Paris ont façonné le style et influencé la pratique artistique de Samuel Phelps. Après avoir pris la décision de déménager au Pakistan en 2011, Phelps travailla principalement comme photographe de presse pendant ses deux années en Asie du Sud. Entre 2013 et 2017, il vécut à Dakar, au Sénégal, et sillonna les régions de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, réalisant des missions pour des agences humanitaires et travaillant sur des projets personnels. Il vit aujourd’hui avec sa famille à Marseille depuis l’été 2017. Il se consacre principalement à l’exploration des rues de Marseille dans le but de créer une archive durable de la ville.
Arnaud Teicher
Sainte-Victoire
À propos de la série
Entre 2018 et 2023, j’ai photographié la montagne Sainte-Victoire depuis la ville d’Aix-en-Provence. Il s’agit d’un territoire en mutation où le développement économique, stimulé par une forte croissance démographique, entraîne une pression foncière qui contribue à modifier cet espace. Ces photographies dressent le portrait d’un paysage en transformation, révélant un nouvel environnement hybride, à l’intersection du monde naturel et du monde construit.
Les zones urbaines abritent plus de la moitié de la population mondiale et jouent un rôle essentiel en tant que moteurs de la croissance, offrant des opportunités d’emploi et d’éducation. Elles répondent à l’évolution des besoins et des aspirations de leurs habitants. Cependant, une urbanisation trop rapide et mal maîtrisée entraîne une dégradation sévère de la qualité de l’environnement urbain et des zones rurales environnantes. Ce phénomène peut notamment être attribué à l’uniformisation et à la monotonie de l’architecture, à la disparition des espaces publics et à une densité de construction excessive.
L’expansion anarchique des villes constitue une réelle menace écologique pour l’humanité, les scientifiques estiment que plus de 70 % des émissions de CO2 actuelles sont liées aux besoins des villes. Pourtant, comme l’explique la professeure Karen Seto de l’Université de Yale, « dans le monde entier, on adopte les styles d’urbanisme et d’architecture « occidentaux », qui sont gourmands en ressources et trop souvent inadaptés aux conditions climatiques locales. La banlieue nord-américaine s’est exportée dans le monde entier, avec son modèle basé sur la circulation en voiture individuelle ».
La croissance a profondément transformé l’essence même de nombreux territoires, mettant en péril la perception des lieux. Malgré la mise en place de réformes majeures à l’échelle nationale sur l’aménagement du territoire depuis les années 60, le tissu urbain n’a cessé d’évoluer, entraînant l’expansion des villes et la disparition des zones naturelles périurbaines. La montagne Sainte-Victoire, un espace emblématique chargé de sens, dont le motif pictural constitue un patrimoine commun et identifiable par tous, continue de s’effacer. C’est là, peut-être plus qu’ailleurs, que se pose la question des relations entre la ville et la campagne.
- Année•s : 2018-2023
- Commune•s : Aix-en-Provence, Le Tholonet, Les Milles, Martigues, Saint-Marc-Jaumegarde, Ventabren
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Arnaud Teicher
Documentation :
Arnaud_Teicher_documentation_Sainte_Victoire (pdf)Arnaud Teicher
Né en 1985, Arnaud Teicher est un jeune photographe français installé dans le sud de la France. Après un cursus scientifique et des études de design à Paris, il s’est progressivement rapproché d’un environnement plus familier afin d’accorder du temps à une pratique photographique. Fasciné par les éléments liés à la terre et au paysage, Arnaud explore ce territoire à la recherche de traces, qu’elles soient dessinées par le temps, façonnées par le climat ou laissées par l’homme.
Suzanne Hetzel
Faire la sieste pour chasser le noir
À propos de la série
Photographies et notes du quartier de l’Abeille à La Ciotat.
Entre mars 2012 et octobre 2013
Sur l’invitation de Martine Derain à l’Abeille, à La Ciotat, pour une durée de deux ans, Suzanne Hetzel a tenu un « Journal de résidence » dans lequel les photographies et les textes témoignent de ses rencontres et de ses découvertes pendant son temps de recherche et ses balades. Par ce biais, elle a pu rencontrer des personnes qui ont vécu l’histoire de cette cité, prises dans les mouvements politiques et les changements de notre société du fait d’habiter là. Pensant que ceux qui vivent depuis longtemps dans la cité pourraient lui livrer ; de récits en récits, ce travail s’est nourri au travers de différents champs de représentation de leur cadre de vie, de leur quotidien, sans négliger ni la souffrance personnelle quand il s’agit de parler des événements politiques, ni les joies partagées quand il s’agit d’évoquer le paysage autour de La Ciotat. À partir de ces paroles s’ajoutent des anciennes photographies venant d’archives personnelles ainsi que des nouvelles ; une certaine manière pour l’artiste de poser son regard sur leurs histoires.
- Année•s : 2012-2013
- Commune•s : La Ciotat
- Commanditaire•s : Marseille-Provence 2013
- © Suzanne Hetzel / SAIF
Documentation :
documentation_Hetzel (pdf)Suzanne Hetzel
« Je suis née en 1961 – 30 ans après Bernd Becher et 384 ans après Peter Paul Rubens – à Siegen en Westphalie. Les arts plastiques sont le plus important pilier de ma scolarité, que je décide de poursuivre par des études aux Beaux-Arts de Marseille. J’en sors en 1990 avec un DNSEP en arts visuels et un post-diplôme. La photographie devient mon médium privilégié pour des raisons de diffusion-circulation, de pratiques diversifiées et pour son ancrage dans une réalité immédiate. De projet en projet, j’explore notre façon d’habiter un lieu ou un territoire et les marques que celui-ci laisse en nous. Des documents et des objets sont apparus dans mes installations dès 2007. Aujourd’hui, pour réaliser une exposition, je compose avec les photographies (je vois mon fonds photographique comme un ensemble), les objets et l’architecture du lieu. L’écriture va de pair avec mon travail de photographie. J’apprécie sa capacité de transcrire la vitalité des conversations et des impressions, et de laisser une plus large place à la mémoire des personnes que je rencontre. Fréquemment, un livre-projet clôt un projet. » Suzanne Hetzel
Martial Verdier
Port-de-Bouc 150 ans – Archéologie d’une poétique de Port-de-Bouc
À propos de la série
À travers les espaces de la ville. Port-de-Bouc, une longue plage battue par le mistral ou chauffée par le soleil mais aussi des bateaux qui viennent du bout du monde, qui passent dans la baie ou restent amarrés la nuit en illuminant la mer, des flammes qui montent dans le ciel de Lavera, des jets de vapeur sur Arcelor ; une poétique industrielle. Photographier ce qui va disparaître ; et ce qui a disparu. Ce qui est, la gare, le port, les canaux, le foyer des marins, ce qui était, les anciens chantiers navals dont il ne reste que des traces symboliques, les anciennes usines, etc. Les 150 ans de Port-de-Bouc donnent l’occasion d’une recherche sur l’archéologie du présent. Présent, passé, limitesUne promenade dans le temps et l’espace est le guide de ce travail. Le passé industriel laisse une forte marque dans la ville, une sorte de retour du refoulé souvent, mais la ville vie, elle avance, se recrée. Comme un organisme vivant jusqu’où existe-t-elle, un ruisseau, un chenal, un tunnel, une route. Foto povera. Hors les calotypes, les techniques employées sont inspirées des discussions avec Yannick Vigouroux sur les procédés amateurs, alternatifs, parallèles et décalés. « On ne prend pas une photographie, on la fait. » Ansel Adams
- Année•s : 2014-2016
- Commune•s : Port-de-Bouc
- Commanditaire•s : Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger
- © Martial Verdier / SAIF
Documentation :
Martial Verdier_Port-de-Bouc_Annexes_Inventaire (pdf)Martial Verdier
« Je suis devenu artiste parce que il me semblait indispensable d’articuler concept et connaissance. J’ai préféré la photographie car elle me permettait de montrer le monde dans sa complexité. C’est une technique légère à mettre en œuvre et encore d’avant garde, malgré son âge. Mais je travaille aussi régulièrement en vidéo. Le calotype et les autres techniques alternatives me permettent de faire circuler mes photographies dans d’autres dimensions temporelles, dans l’image « étrange ». Elles permettent de faire passer des messages difficilement visible sinon. Ma photographie est un art de l’imparfait, elle questionne la forme et la mémoire. Comme l’image ment, qu’elle n’est qu’un faux semblant. Je montre ce qui ne se voit pas, le point de vue, le champ et le hors champ. Comment être le maitre de ses images ? Le temps de préparation et le matériel transforme la prise de vue en un dispositif. Elle met en jeu le corps du photographe autant que son projet. C’est donc une photographie expérimentale qui m’intéresse, non pas être dans un courant, mais en exploration. Chaque éléments étant un outil, la pureté du medium ne m’intéresse pas et je mélange souvent argentique, numérique, calotype, vidéo… Dans cette veine c’est plutôt des photographes comme Alfred Stieglitz ou Man Ray qui m’ont influencé ainsi que les travaux du philosophe Vilèm Flusser et son analyse de ce que cachent les appareils (à tous les sens du terme). » Martial Verdier
Denis Darzacq
Le quartier Euromed à Marseille
À propos de la série
« Cette série est une réponse à un commande publique initiée par Mme Agnès de Gouvion Saint Cyr du ministère de la Culture. Il s’agissait de documenter le nouveau quartier d’affaire Euromed, nouvellement desservi par le tramway. La ville espérait qu’après d’importantes rénovations et changements d’affectations (créations de nombreuses bureaux), le regard sur le quartier de la Joliette et de la rue de la République changerait. J’ai décidé de vivre pendant quelques semaines à Marseille et de me promener tous les jours dans ce nouveau quartier. » Denis Darzacq
- Année•s : 2006-2007
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, État français, Ville de Marseille
- © Denis Darzacq / Adagp, Paris, 2020
Documentation :
Denis Darzacq
Denis Darzacq développe un travail personnel depuis le milieu des années 1990. Il a commencé par la photographie de presse et a rejoint l’agence VU en 1998. Depuis plus de trente ans, il a développé un regard aiguisé sur la société contemporaine en développant une démarche analytique donnant lieu à des séries formellement très cohérentes. Si les gros plans de la série « Only Heaven » (1994-2001) révèlent encore l’implication personnelle de son auteur, les vues plongeante d’« Ensembles » (1997-2000) et frontales de « Bobigny centre ville » (2004) puis des « Casques de Thouars » (2007-2008) traduisent une mise à distance du sujet, voire un artiste en position de retrait. Il a acquis la conviction qu’une image construite pouvait paradoxalement servir son analyse de la société avec plus d’efficacité. Aussi recourt-il, depuis 2003, à des mises en scène. Par leur état ou leur pose, les corps mis en scène bouleversent l’ordre établi, mais sans jamais faire basculer l’image dans le spectaculaire. Des hommes et des femmes marchent nus dans des zones pavillonnaires (« Nus », 2003), d’autres semblent figés en apesanteur dans l’espace urbain (« La Chute », 2006), ou entre des rayons de supermarchés (« Hyper », 2007-2011) ; des personnes en situation de handicap reprennent avec force possession de l’espace public, (« Act », 2009-2011). Depuis dix ans maintenant, il se tourne vers des expérimentations proche de l’abstraction, essayant de dégager le médium photographique de son devoir d’informer.
Atlas Métropolitain — Aulagner / Jaumot
Les nouveaux territoires de l’habiter
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2015
- Commune•s : Aix-en-Provence, Aubagne, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Martigues, Pennes-Mirabeau, Plan-de-Campagne, Saint-Mitre-les-Remparts, Vitrolles
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Aulagner / Jaumot
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Franck Pourcel
La petite mer des oubliés – Gestes du travail
À propos de la série
Dans l’esprit des gens de passage depuis l’autoroute ou sur les routes et voies de chemin de fer qui arborent l’étang de Berre, mais aussi à l’atterrissage à Marignane, ou depuis les villes extérieures, l’homme n’existe plus sur ce territoire. Il n’est plus à sa place, il a été oublié. Les baignades ne se pratiquent plus, le chasseur prend son gibier au supermarché de la zone commerciale, les cabanons sont en ruines et ont laissé place aux puissantes cuves de pétroles, le pêcheur n’est plus dans sa barque… L’homme s’est laissé engloutir par ces kilomètres de tuyaux métalliques et la fumée qui sort des cheminées, mêlée aux douces ondulations d’une eau poussée par le vent vers la mer donnent au spectateur la nostalgie d’un passé révolu. Les machines technologiques et industrielles ont dépassé la présence humaine, par les balais incessants des avions, et tous les signes d’apocalypse renforcent ces absences. Le vide est partout. Le déséquilibre du milieu est flagrant, donnant ce fort sentiment de désorientation et cette vision de cohabitations incohérentes : salins, culture maraîchère, centres commerciaux, plages, criques, industrie… L’étang rencontre une poétique bien différente de celle d’antan peinte par Ziem, narrée par Pelletan. Pourtant, ces hommes et ces femmes vivent encore sur l’étang et les histoires voguent encore. Ainsi, il n’est pas étonnant de croiser sur les marchés ces « hommes de l’autre époque », aux épaules larges, aux mains lourdes et lacérées par les filets, ou d’apercevoir perdu dans une immensité industrielle, un nuage d’oiseaux accompagnant les derniers « bateaux ivres » dont l’ivresse est justement de se trouver sur cette « petite mer » pour « fuir » le temps et l’espace surchargés d’une époque moderne. Il n’est pas étonnant non plus d’apercevoir des dizaines de voiles de kite surf ou de planches à voile balayant la plage du Jaï entre Marignane et La Mède ou d’entendre les vrombissements des moteurs surpuissants Offshore dans le port de Saint-Chamas. La vie y est partout, aux pieds de la ville nouvelle de Vitrolles, aux pieds de la raffinerie de Total la Mède, le long du canal du Rove. On pourrait penser que l’homme n’est plus à sa place dans cet univers et pourtant, tous les univers se côtoient dans une opposition volontaire qui semblerait oppressante pour tout individu extérieur à ce monde. Il semble surprenant de constater avec quelle fascination, « l’homme est capable de faire abstraction d’un univers d’apocalypse ». Le lieu semble garder sa poétique et son enthousiasme.Tous les points de vue qu’on peut prendre sur l’étang ne suffisent pas à constituer un paysage. Ils sont réduits au statut de fragments. En permanence, le regardeur est conduit à un travail de cadrage et de recadrage.
- Année•s : 1996-2006
- Commune•s : Berre-L'Étang, Étang de Berre, Martigues, Vitrolles
- Commanditaire•s : ATD Quart Monde, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, GIPREB, Musée archéologique d'Istres, SHADYC, SISSEB
- © Franck Pourcel / SAIF
Franck Pourcel
Franck Pourcel est né en 1965. Photographe hyperactif, il porte une attention toute particulière aux failles de notre temps et aux régions qu’elles abîment – dont l’espace intime des corps. Souci et poétique documentaires définissent son regard, qui longe sans cesse les lignes de partage entre l’habitable et l’inhabitable. Territoires, objets, techniques, gestes : l’accumulation joue un rôle important dans son œuvre. Il s’agit en quelque sorte de faire l’inventaire des formes et modes de vie ayant cours dans un monde globalement ravagé par le capitalisme, pour mieux cerner ses possibilités de réinvention – dont notre survie dépend.
Pascal Grimaud
Le temps présent
À propos de la série
Travail personnel ou de commande, sujet, description du processus d’enquête photographique, évolution du travail au cours de sa réalisation.
- Année•s : 2013-2016
- Commune•s : Boulbon, Charleval, Eygalières, Puyloubier
- Commanditaire•s : Conseil Général des Bouches-du-Rhône
- © Pascal Grimaud
Pascal Grimaud
Photographe, Pascal Grimaud vit et travaille dans le sud de la France. Il se consacre à des projets d’auteur au long cours.
Son travail donne lieu à diverses publications et expositions en France et à l’étranger. En 2004, il publie « Le bateau ivre, histoires en terre malgache » chez Images en Manœuvres, suivi en 2006 de « Filles de lune – de l’archipel des Comores à Marseille », et de « Maiden Africa » en 2009.
Dans le cadre d’une commande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, il réalise de 2013 à 2016 un projet sur son village natal dans les Alpilles. Deux ouvrages rendront compte de ce travail : « Cahier 2013/2015 » et « Le temps présent » aux éditions Filigranes. Il retourne régulièrement à Madagascar, île qui ne cesse de questionner sa pratique photographique; et 10 ans après la sortie de « Filles de lune », il initie un nouveau projet dans l’archipel des Comores et sur l’île de Mayotte.
Anne Loubet
Les jardins ouvriers
À propos de la série
« En 1998, fraichement installée à Marseille, je suis allée à la rencontre de la ville imprégnée de la nostalgie de ma région natale (le Nord). Je me suis intéressée à l’existence d’ilot collectif, de lieux qui ne soient pas propriété individuelle ou familiale, des endroits pensés pour le collectif. L’utopie d’un partage de la terre entre citoyens voisins, locataires de la ville me berce. Je me suis rendue compte de l’importance des jardins partagés sur la ville et de leur répartition est – ouest. Marseille est une ville de collines et la géographie des parcelles est riche en découverte et imaginaires. Il y a celles qui épousent les limites imposées par le canal de Marseille, la voie ferrés, les routes, et qui se développent en restanques. D’autres se dessinent, tracées au cordeau, basées sur un souci d’équité parcellaire. Certains jardins sont adhérents de la Fédération des Jardins Familiaux et Collectifs, avec des terrains hérités de donateurs privés ; d’autres sont propriétés de la ville (beaucoup moins). J’ai limité mon territoire d’enquête aux jardins de la Fédération. J’ai suivi différents biais d’enquêtes :
– Contact avec la Fédération des Jardins Familiaux à Paris qui m’a donné le nom des présidents et responsables locaux. Pierre Esposito, le président local de l’époque, m’a ouvert l’accès aux jardins (notamment Le Castellas où il avait lui-même une parcelle) et guidé pour mes rencontres auprès des jardiniers. Pour l’anecdote, en juillet 1998, Jean-Claude Gaudin lui remet en personne, les insignes de l’ordre national du mérite lors d’une cérémonie officielle se déroulant au jardins de Mazargues
– Recherches aux archives municipales et départementales, au musée d’histoire de Marseille pour connaitre l’état des lieux d’une documentation historique sur la ville. Les intentions du projet photographique : Quel paysage les jardins parcellaires dessinent ils dans la ville ? Je voulais inscrire leur localisation et empreinte vitale au sein du maillage urbain. Représenter la bulle d’air qu’ils procurent aux jardiniers en mettant en valeur la présence végétale et arborée de ces îlots dans une mégapole. Jouer sur les limites entre le cultivé – le sauvage ; le bâti éphémère, les espaces communs et individuels des parcelles. J’ai souhaité bien évidement aller à la rencontre des jardiniers, locataires provisoires de ces espaces (aux vues du rythme propre aux cultures, un contrat d’un minimum de 3 ans est alloti aux jardiniers. Profils variés, famille, retraité, ancien ouvrier conservant le « bleu » pour aller au jardin, je relève les désirs multiples qui les animent. Du bain de soleil, la vie au grand air, au plaisir de soigner et distinguer son enclos. Les portraits individuels sont réalisés au 6×6 , frontaux et posés . Au jardin de la Valentine, les parcelles sont toutes alignées et de taille identique , le portillon est un signe puissant de distinction. Je choisis de développer un protocole de prise de vue identique pour photographier chacun d’eux. Attirée par cet élément de l’habitat, symbolique du passage dedans-dehors, privé-public. Il y a donc des images qui se complètent : des paysages ouverts sur l’horizon de la ville qui situent le jardin dans le maillage urbain de Marseille. Des portraits des jardiniers dans leur parcelle et des espaces intérieurs. Une série sur les portillons au jardin de La valentine. Assez peu d’images des temps communautaires (hormis un apéritif récompensant les travaux collectifs dans les allées, la cérémonie de récompense de M. Esposito). » Anne Loubet
- Année•s : 1998-1999
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Anne Loubet / SAIF
Anne Loubet
Le Nord a été le terreau de l’imaginaire d’enfance d’Anne Loubet. Elle aborde la vie avec légèreté, observe ses contemporains sans drame ni tragédie, et accorde une certaine sacralité aux gestes et aux personnes ordinaires, portée par un idéal communautaire.
Après des études de lettres et de cinéma documentaire à l’Université de Lille, Anne Loubet s’est tournée vers la photographie à l’école d’Arles. Elle puise son inspiration aussi bien dans l’audace performative de Sophie Calle que dans la frontalité de Diane Arbus, la vitalité des peintures de Goya ou de Bruegel, ainsi que les portraits grinçants de Velasquez.
Sabine Massenet
I am a seaman
À propos de la série
Images tirées du film « I am a seaman ».
« La résidence au Centre d’art Fernand Léger en février 2014 s’achevait. La veille de mon départ je mangeais dans ma cantine favorite, La Tarentelle, sur le port. Je ne devais revenir que deux mois plus tard et profitais des derniers moments face à la mer. Un couple s’installe à mes côtés. Comme de coutume, je suis toute ouïe. Au cours du repas, la femme interroge son époux : « Dis, tu sais s’il existe toujours le foyer des marins… Mais si voyons, celui qu’a ouvert un curé, dans l’ancien bordel de la ville ? » Je n’avais jamais entendu parler de ce lieu, jamais croisé de marins dans la ville, à l’exclusion des quelques pêcheurs de l’anse Aubran, qui pour la plupart vivent plus loin sur la côte. Je me renseigne, on me donne une adresse, je m’y précipite. Tout est fermé. J’interroge le patron du bar le plus proche : « C’est un foyer, oui. Tous les jours de l’année, samedi et dimanche compris, des hommes, des étrangers arrivent là vers 18 heures en minibus. Par groupe de huit, dix. Certains soirs, ils peuvent être quarante ou cinquante dans le foyer. C’est surtout des asiatiques, des indiens, des turcs, des russes… Mais c’est jamais les mêmes. D’où ils viennent ? Mais des portes conteneurs qui déchargent à Fos 2XL, des gaziers, chimiquiers, et pétroliers qui font escale à Lavera, et des minéraliers d’ArcelorMittal et de Caronte. Nous on en croise parfois. Ils viennent boire un pastis ou un whisky ici, mais c’est rare. » Je reviendrai à Port de Bouc, deux mois plus tard, pour réaliser un film « I am a seaman » que je terminerai en 2016. » Sabine Massenet
- Année•s : 2016
- Commune•s : Fos-sur-Mer, Martigues, Port-de-Bouc
- Commanditaire•s : G.R.E.C., SACEM, SCAM
- © Sabine Massenet
Sabine Massenet
Sabine Massenet est vidéaste. Elle vit et travaille à Paris. En 1997, après avoir travaillé différents médiums (terre, plâtre, photo) pour créer des installations auxquelles elle associait parfois des éléments narratifs, Sabine Massenet décide de se consacrer uniquement à la vidéo. Elle explore le portrait avec une ouverture sur le langage et sur la résonance des images dans la mémoire collective ou privée. Elle pratique également le recyclage d’images télévisuelles ou de cinéma, qu’elle remonte en se jouant des codes visuels propres à ces deux médiums. Elle obtient la bourse d’aide à l’art numérique de la SCAM 2003 pour 361° de bonheur, co-édition Incidences / Vidéochroniques. Elle crée aussi des vidéos de commande : pour le théâtre, pour la Maison Rimbaud à Charleville Mézières en 2005, pour la série « Image d’une œuvre » de l’IRCAM en 2019. Ses vidéos sont présentées régulièrement dans des festivals français et étrangers, centres d’art, musées. Des séances monographiques lui ont été consacrées en 2004 à la Cinémathèque Française, en 2005 au festival Némo et au Jeu de Paume, en 2009 au festival des Scénaristes à Bourges. Sa vidéo « Transports amoureux » est éditée dans le n°1 de la collection TALENTS. Elle réalise des séries photographiques tirées d’images de ses vidéos (« Tango », « Un peu plus loin le paradis », « Brûler la mer », « Fire », « J’entends rien »), ou des images réalisées sur le terrain (« Pentagone », « Lire la ville » et tout récemment « Covimmersive »). « Je ne me souviens plus », « Transport amoureux », « Last dance » et « Image trouvée » ont été acquises par le Fond d’Art Contemporain du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Le prix de l’œuvre d’art numérique de la SCAM lui est décerné en 2013, pour l’installation « Image trouvée ». « I am a seaman », film réalisé en 2016, a obtenu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM et le soutien du G.R.E.C. Professeur d’arts visuels de la Ville de Paris, elle a enseigné auprès d’enfants dans des écoles élémentaires puis a travaillé dans les services éducatifs du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée Zadkine et Bourdelle. Elle anime des ateliers vidéos pour Le Bal, la Terrasse, l’école du paysage de Blois…Elle crée en 2002 avec Christian et Véronique Barani l’association de diffusion de vidéos d’artistes est-ce une bonne nouvelle à laquelle elle participe jusqu’en 2007. Ses vidéos sont distribuées par Heure Exquise.
Hélène David
Gueule d’Hexagone — Seveso Football Club
À propos de la série
En 2010, après « réfugiés climatiques » et sa dimension internationale, le collectif argos, dont j’étais membre jusqu’en 2012, lance un nouveau projet collectif, en France, sur des lieux « périphériques ». Cette série dialogue avec l’oeuvre de Jacques Windenberger, photographe : les six territoires sont choisis dans son fond, dont les documents sont à même d’interroger une réalité contemporaine. Avec Donatien Garnier, auteur et poète avec qui j’ai souvent embarqué en haute mer, nous résidons à Fos-sur-Mer, à trois reprises au cours de l’année 2011, en partenariat avec la communauté Ouest Provence. Dans un dispositif documentaire « en immersion », nous suivons le quotidien de l’équipe 3 de l’étoile sportive fosséenne, le club de football. Tous amateurs, les joueurs ont trouvé un emploi dans la ville, ou dans le complexe industriels-portuaire. Leurs parcours sont autant de fragments de l’histoire de Fos.
- Année•s : 2011
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Communauté Ouest-Provence
- © Hélène David / SAIF
Hélène David
« Depuis 2005, et la co-réalisation de l’ouvrage « Réfugiés climatiques » du collectif Argos, mes travaux documentaires sont inspirés par une « écologie du sensible », selon l’expression de l’anthropologue Tim Ingold. Cette démarche cherche à questionner nos relations au vivant, plus particulièrement en Méditerranée, où j’ai choisi de m’installer en 2008. Dans un contexte de crise environnementale, je souhaite ainsi participer à la construction transdisciplinaire de nouvelles manières d’habiter, en produisant des récits avec d’autres auteurs ou institutions (comme les Archives Départementales des Bouches du Rhône avec la création d’un fond photographique à partir de « L’esprit des calanques » en 2012). Noces ou les confins sauvages, traversée intime du littoral, m’a amené à redéfinir de précédentes pratiques documentaires – des écritures aux objets – et à envisager différemment la place des publics dans le dispositif de création. Après différentes expositions, la publication de l’ouvrage aux éditions sunsun en 2018 et plusieurs acquisitions (Arthotèque Intercommunale Ouest Provence, FCAC Ville de Marseille), je prolonge cette recherche grâce au soutien du CNAP (2019). Il s’agit maintenant de suivre la piste de l’homme-animal : une expérience de la rencontre entre espèces et de la traversée des frontières, pour composer un récit choral de nos relations aux non-humains. Entamé au cours d’une résidence participative en pays de Grasse (Alpes maritimes) en 2018/2019, cette collecte de documents est désormais menée avec les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, pour une restitution à l’occasion du Congrès mondial de la nature en 2021. » Hélène David
Olivier Monge
Montagne urbaine
À propos de la série
« Le Parc National des Calanques est l’un des rare parc au monde à se situer en bordure immédiate de la ville. Cet espace partage cette caractéristique avec ceux de Nairobi, Tijuca (Rio), Table Montain (cape Town) ou encore Sanjay Gandhi (Mumbaï). Cette singularité m’a amené à réfléchir à l’impact de cette proximité de la ville sur un territoire protégé. Mes travaux antérieurs portaient sur la montagne et plus particulièrement sur les stations de ski. « Montagne Urbaine », produit spécialement pour cette exposition, s’inscrit dans la droite ligne de ce cheminement photographique. Il s’agit de faire l’expérience du territoire, notamment par des conditions de prise de vue tout à fait exceptionnelles (un temps de pose très long, un chemin chaotique pour accéder aux points de vue, un lourd dispositif photographique), et de chercher à retranscrire visuellement, la particularité de cet espace.Tout ce travail consiste en un questionnement de l’idée de frontière entre le territoire construit, imaginé par l’homme, et celui, naturel, d’un espace préservé. Dans la mesure où même le concept de nature est une construction intellectuelle, comment délimiter la fin du naturel et le début de l’artificiel, voici le fil rouge de cette démarche. » Olivier Monge
- Année•s : 2014
- Commune•s : Cassis, Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Olivier Monge
Documentation :
Olivier Monge_Montagne urbaine_Annexes_Inventaire (pdf)Olivier Monge
« Membre de l’agence MYOP, directeur Artistique de Fermé Le Lundi, mon travail s’articule autour de la notion de territoire, de patrimoine et de mémoire. Mon médium, la photographie, me permet de mettre en perspective les lieux et leur histoire au travers d’enjeux contemporains. Je parcours et enregistre des espaces géographiques où mon regard s’exprime en s’appuyant toujours au préalable sur des recherches, des études sur l’histoire, l’architecture ou la sociologie. J’ai besoin de comprendre avant de ressentir et retranscrire. Ensuite vient le temps de « l’expérience du paysage », celui de « l’investissement physique », puis enfin arrive le temps de la prise de vue. Je ne cherche pas un instant décisif, je travaille dans une durée déterminante. Celle du temps de pose, qui efface l’anecdote et scénarise le propos abordé : la fabrique réelle et imaginaire d’un lieu. Je ressens ainsi le besoin de collectionner, de décrypter et de décrire les lieux. Je témoigne également dans un souci de pérennité et je forme patiemment l’inventaire de mon regard. » Olivier Monge
Atlas Métropolitain — Castres / Daher / Mallet
Sports et loisirs
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2012
- Commune•s : Châteauneuf-les-Martigues, Marseille, Martigues, Montagne Sainte-Victoire, Parc Naturel Régional des Alpilles
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Castres / Daher / Mallet
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Atlas Métropolitain — Salles / Toucas
Périurbain
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2013
- Commune•s : Allauch, Auriol, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Cassis, Eguilles, Gardanne, La Penne-sur-Huveaune, Peypin
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Salles / Toucas
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Monique Deregibus
Hotel Europa
À propos de la série
Ce corpus d’images réalisé à partir de la Ville de Marseille (2000-2003) n’est pas une commande mais un travail engagé à titre personnel. Il a été réalisé avec un moyen format argentique Asahi Pentax 6×7. Les tirages qui en ont résulté sont des grands formats, 120×140 cm et 90×110 cm.
C’est après avoir travaillé quasi obsessionnellement pendant 10 ans en noir et blanc sur une portion de territoire enchantée du désert du Nouveau-Mexique (USA, 1989-1999), que j’ai décidé pour un temps d’une rupture radicale avec les voyages américains. Il s’agissait dès lors de regarder un « Ici et maintenant » sans détour. Je changeais de format passant du carré 6×6 cm au 6×7 cm et chargeais désormais mon appareil photographique avec des films couleur. Marseille – ville dans laquelle je vis le plus souvent – semblait être en pleine mutation à cette période du tournant des années 2000 : construction du Mucem, TGV, extension du port et de l’ offre des croisiéristes. J’ai patiemment observé alors comment la greffe touristique que l’on pressentait allait progressivement vampiriser la ville ouvrière et populaire, mondialisation oblige. » Extrait du livre éponyme qui déroule 3 travaux distincts : « Marseille » (2000-2003), « Sarajevo » (2001), « Odessa » (2003).
Une partie de ce travail a été acquis par le Fonds Communal de la ville de Marseille, l’autre partie restante est visible dans mon atelier. Ce travail a tout de même bien circulé puisqu’un livre édité chez Filigranes en a résulté. Il a été exposé en 2005 aux Ateliers d’Artistes de la Ville de Marseille, commissariat de Thierry Ollat, et également au cours d’une exposition dans le cadre du Septembre de la photographie à Lyon en 2008 au CAP de saint- Fons intitulée « Aux habitants des villes » d’après le « Manuel pour habitants des villes » de Bertolt Brecht.
- Année•s : 2000-2003
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Monique Deregibus
Monique Deregibus
Après des études de lettres modernes et de cinéma à l’université d’ Aix-en-Provence, Monique Deregibus est diplômée de l’ ENSP d’ Arles (1987).
De 1988 à 2004, elle enseigne la photographie à l’École Régionale des Beaux-Arts de Valence, de 2000 à 2004 à l’École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles, et enfin de 2004 à 2018, elle est professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
De 1990 à 2000 elle crée avec Olivier Menanteau un lieu d’art contemporain à Marseille « Les Ateliers Nadar » invitant de nombreux artistes à séjourner et à exposer dans la ville.
Par ailleurs, sa pratique de la photographie lui donne l’occasion de parcourir le monde.
Le projet « Hotel Europa » (qui s’est achevé par l’édition d’un livre chez Filigranes en 2006) tente à travers trois villes distinctes – Marseille, Sarajevo et Odessa – de mettre en relation, en équivalence, des interprétations particulières de l’Histoire « avec un grand H », entendue ici plus comme lieu de fiction poétique que comme description froide et objective. Ainsi ces photographies, évoquant la permanence d’une réalité conflictuelle sur le continent européen, tentent-elles de raviver des souvenirs d’exode et de guerre, mais aussi des brefs éclats d’utopie et de rêve qui ont parcouru tout le 20ème siècle. Nous glissons d’une ville l’autre sans bien savoir à la fin de quelle ville il s’agit.
Chacune des séries photographiques, héritière d’une histoire du paysage conceptuel, est consacrée à des territoires spécifiques, tantôt proches ou lointains, manifestant toujours un fort intérêt pour les réminiscences inconscientes contenues dans le plan ainsi que pour les notions d’architecture et de territoire urbain. Ces espaces la plupart du temps consignés dans un travail éditorial, peuvent se lire comme formant le décor abandonné des tragédies humaines.
Atlas Métropolitain — Alayo / Gauberti
Zones d’activités
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2013
- Commune•s : Marseille, Plan-de-Campagne, Vitrolles
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Alayo / Gauberti
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
André Mérian
Mutation du paysage de Saint André « Le Grand Littoral Marseille »
À propos de la série
« En 1996, le spectaculaire chantier du centre commercial Grand Littoral, accroché aux collines et aux carrières d’argile du 15ème arrondissement, a largement interpellé les Marseillais, entraînant une réaction diversifiée des artistes préoccupés de représentation du territoire. Le Fonds communal d’art contemporain de la Ville de Marseille a invité quelques créateurs, ayant à coeur dans leurs recherches la mémoire des lieux, et la mutation urbaine et sociale que les travaux engendrent , à poser un regard autre que celui d’un simple suivi de chantier. Pour ma part, mes photographies montrent la mutation du paysage, à travers le spectacle qu’offre le chantier. Bien que la représentation photographique du chantier tend à figer des formes éphémères et anecdotiques, il s’agit d’en saisir autre chose. Elle a ici l’intérêt particulier de saisir une réalité qui doit disparaître. » André Mérian
- Année•s : 1996
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Ville de Marseille
- © André Mérian
André Mérian
« André Mérian est un artiste photographe Français, dans ses photographies documentaires ou fabriquées, la banalité, le dérisoire, le commun, voir l’invisible, nous interrogent sur la question de la représentation.Il expose régulièrement en France et à l’étranger, ses travaux font parties de collections publiques et privées, et font l’objet de différentes monographies. Il est représenté par Les Douches La Galerie à Paris. En 2009, il est nominé au prix Découverte aux Rencontres Internationales de la Photographie en Arles. Depuis un certain temps,il se consacre aux paysages périurbains en France et à l’étranger. L’œuvre photographique d’André Mérian montre un intérêt pour ce qui construit chaque jour notre paysage. Qu’il saisisse des zones périphériques, des centres commerciaux, des architectures de l’organisation humaine, des espaces habités, des chantiers ou des écrans lumineux disposés dans l’environnement public, ses photographies tentent de figer ce qui se dresse autour de chacun, comme le décor moyen, banal, du quotidien. Passée la frontière des villes, l’architecture prend une dimension nouvelle, où le factice, le provisoire et le démontable prennent le dessus. Le résultat est déroutant, et nous interroge sur ces espaces qui s’universalisent, sur le sort réservé à l’homme dans cette esthétique du chaos, ses travaux nous questionnent sur la limite de l’objectivité et de la subjectivité. » Guillaume Mansart, Documents d’artistes PACA
Philippe Piron
Fos-sur-Mer : du Tonkin à Arcelor
À propos de la série
Il s’agit d’une série de photographies réalisées lors d’une marche exploratoire guidée par Denis Moreau. Le but de cette marche était de relier l’ancienne pompe à feu du Tonkin à l’aciérie Arcelor.
- Année•s : 2010
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Philippe Piron
Philippe Piron
Philippe Piron a d’abord travaillé sur des projets d’analyse et de gestion des paysages ruraux au sein de différents organismes (CAUE, Conseil général…). Cette première approche technique du paysage sera complétée par une formation en photographie dirigée par Serge Gal à l’école Image Ouverte (Gard).
Après s’être établi à Marseille, il réalise des commandes pour des architectes et des institutions (CAUE13, DRAC PACA, Euroméditerranée…). Il développe également des projets personnels et participe notamment à de nombreuses marches collectives qu’il documente photographiquement en réalisant des carnets. En 2013, au côté d’artistes marcheurs, il participe à la création du GR2013, sentier de grande randonnée périurbain. Il s’installe à Nantes en 2012. Il est né en 1974 dans le Maine et Loire.
Fabrice Ney
Soude
À propos de la série
« Soude est un travail à l’origine proposé par l’auteur à l’EPAREB à la suite d’un rendez-vous avec Messieurs Ecochard et Demouchy, intéressés une sensibilisation des habitants à l’histoire industrielle du territoire. Il a été financé par l’EPAREB, La ville de Fos-sur-Mer et la ville de Marseille. Ce travail, réalisée entre 1988 et 1993, est associée à la création de l’association SITe (Sud, Image, Territoire), dont l’objet associait la recherche et la création sur l’image des lieux et du territoire à la sensibilisation sur les enjeux de leur représentation. Les marges en déprise industrielle du territoire sont abordées à travers la question du paysage en photographie et de l’exploration de ses déclinaisons possibles. « Soude » propose la lecture photographique d’une strate historique commune aux paysages d’un territoire donné. Ce projet, réalisé entre 1988 et 1993, est l’étude photographique des vestiges, datant du XIXème siècle, des débuts de l’industrie chimique lourde dans les Bouches-du-Rhône. Sa réalisation a demandé une connaissance approfondie de cette histoire par la lecture des ouvrages alors disponibles sur le sujet, mais surtout par une consultation des archives municipales, départementales et nationales ainsi que des fonds spéciaux de la bibliothèque municipale de Marseille et de la CCIM. En effet, mon projet n’était pas de photographier quelques ruines pittoresques, ou illustratives de cette histoire. Je devais acquérir la capacité de comprendre ce que je photographiais. Je ne documentais pas cette histoire, j’actualisais ses traces en en livrant des interprétations photographiques. Au-delà de son aspect documentaire indéniable, cet ensemble d’images questionne à travers la visibilité de ses vestiges, l’histoire industrielle du territoire. Ce questionnement s’effectue sous des angles croisés, en déclinant différentes approches du paysage. Les prises de vue explorent les distances possibles aux motifs. Elles interprètent, d’abord, en plan large, l’organisation de l’espace, les configurations possibles de mises en valeur des rapports entre ses éléments constitutifs. Puis se rapprochant à mi-distance, elles affinent la vision par le choix d’objets dominants rythmant graphiquement des séries. Enfin, le regard devient insistant sur les textures et leurs occurrences. La lecture des séries échappe à une linéarité attendue par l’organisation formelle du plan de leur présentation. Ainsi, ce qui caractérise ce projet photographique, ce n’est pas tant l’exigence d’un point de vue qui se transposerait de lieu en lieu, mais plutôt le choix esthétique d’une vision multimodale. La proposition ici était de rendre perceptible la stratification du paysage en ramenant à la surface de l’image sa réalité horizontale. En effet, une strate paysagère ne s’inscrit pas dans une profondeur physique ou géologique, mais se présente plutôt comme une rémanence visible de l’action humaine qui a délaissé ou déplacé l’usage territorialisé d’un espace. Le projet présentait une forme de méditation sur la mémoire, l’oubli et le devenir, par des assemblages muraux modifiables. La plupart de ces vestiges se trouvent à l’écart des grandes implantations industrielles actuelles (celles-ci ont recouvert les précédentes) qui marquent ces paysages. Dans la continuité de mes travaux précédents, ce regard déplacé sur l’industrie interroge aussi son actualité et son devenir. Un manuscrit d’une quarantaine de pages fut rédigé sur cette histoire. Consigner les éléments du processus de réalisation intègre la perspective d’un projet global : inscrire mon travail dans une esthétique réflexive et compréhensive de la représentation des lieux et du territoire. Ces traces vont nécessairement disparaître. Une des spécificités de ma photographie est de constituer un document proposant la compréhension des modalités de sa construction. » Fabrice Ney
- Année•s : 1988-1994
- Commune•s : Callelongue, Étang de Berre, Fos-sur-Mer, Montredon, Plan d'Arenc, Rassuen, Saint-Blaise, Septèmes-les-Vallons
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Fabrice Ney
Documentation :
Fabrice Ney_Soude_Annexes_Inventaire (pdf)Fabrice Ney
Fabrice Ney est né en 1953, à Bizerte. Ses premiers travaux photographiques datent de la fin des années 1970, associés à ses études universitaires à l’EHESS: « Fos-sur-Mer » (1979), « La Seyne-sur-Mer » (1980-83), « Zup n°1 » (1981-83). Sa recherche se développe ensuite autour de la question de la représentation des lieux et du territoire: « Cap Sicié » (1984), « Km 296 » (1986). En 1989, il crée à Marseille l’association SITe (Sud, Image, Territoire), un collectif de photographes porteurs de propositions autour du thème de l’environnement et des enjeux de ses représentations photographiques (« Soude » (1993), « Quarantaine » (1993), « Résurgence », (1994), « Origine(s) », (1998)). En 1998, Il arrête son travail photographique qu’il reprend en 2013 (« Tentatives d’effleurements » (2014), « Abords et limites » (2015), « De Rerum Natura », (2018)) et revisite ses archives, après en avoir effectué des enregistrements numériques. Il regroupe l’ensemble de son œuvre sous le titre « Un regard sans personne ». Son travail photographique se caractérise par le choix de ses thèmes et la manière de les traiter: une unité territoriale à un moment choisi de son histoire saisie dans les détails révélateurs de ses enjeux. Privilégiant l’accumulation sérielle qui puise sa cohérence dans un cadrage rapproché des éléments constitutifs de l’environnement immédiat, l’accrochage au mur se présente sous des formes permettant des interprétations ouvertes, et pouvant s’articuler avec d’autres matériaux (scientifiques, sonores, poétiques…).
Hélène David
L’esprit des calanques
À propos de la série
« En 2008, au moment de mon installation à Marseille, le GIP des Calanques prépare le projet de Parc National. De nouvelles règles vont organiser le territoire sauvage qui borde la partie sud de la métropole, sa manière de l’habiter. Ce territoire m’apparait comme un laboratoire des relations avec la « nature », dans un contexte périurbain singulier en France, tout en posant plusieurs questions autour des notions de frontières. Le projet de parc soulève la polémique : un courant utilitariste du territoire affronte les partisans de la conservation. J’observe que les résidents des deux calanques habitées, Morgiou et Sormiou, et plus largement certains usagers, échappent à ces logiques. Ici, c’est une vie de peu, où l’on invite volontiers poissons, poulpes, cailloux et garrigue dans sa sociabilité. Cette approche de l’environnement comme un prolongement de soi, me rappellent l’état d’esprit des Inupiaks d’Alaska, avec qui j’ai vécu pour le projet « Réfugiés climatiques ».Je décide alors d’entamer une série documentaire photographique, sous forme de portraits in situ, sur les habitants, professionnels ou amateurs de ce territoire et les réseaux de liens inventifs qu’ils tissent avec les lieux. Au son, ma co-auteur Anna Thillet m’accompagne pour recueillir les paroles, puis monter des films courts. En plus de la série photographique, cinq portraits voient le jour : « Yolande et Néné ». Ils vivent là, dans la calanque de Morgiou, depuis 40 ans. 7 mn 30. « Des puffins et des hommes ». Une nuit de lune noire, les sentinelles de Riou sillonnent l’archipel à la recherche des oiseaux précieux. 6Mn30 « De pierre, de vent, d’eau et de lumière » : Au contact d’une nature âpre, les corps se déploient. 3mn.“La mer, mon jardin”. A l’aube,Laurent Gianettinni quitte Cassis pour « retrouver ses ancêtres » italiens, pêcheurs au petit métier. Tandis qu’Emmanuel Briquet, aquaculteur, élève avec conviction loups et dorades bios dans une calanque historique du Frioul. 6Mn30 « Le chant des pistes », ou le souffle du marcheur. Les « excursionnistes marseillais » randonnent depuis plus d’un siècle dans les Calanques, un terrain difficile et inépuisable. 4Mn J’entame le projet en auto-production, puis plusieurs commandes presse prennent le relai. Expositions, conférences et acquisitions viennent compléter le dispositif de production, notamment audiovisuel. En 2012, les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône ouvre un fond d’acquisition. » Hélène David
- Année•s : 2008-2011
- Commune•s : Cassis, La Ciotat, Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Hélène David / SAIF
Hélène David
« Depuis 2005, et la co-réalisation de l’ouvrage « Réfugiés climatiques » du collectif Argos, mes travaux documentaires sont inspirés par une « écologie du sensible », selon l’expression de l’anthropologue Tim Ingold. Cette démarche cherche à questionner nos relations au vivant, plus particulièrement en Méditerranée, où j’ai choisi de m’installer en 2008. Dans un contexte de crise environnementale, je souhaite ainsi participer à la construction transdisciplinaire de nouvelles manières d’habiter, en produisant des récits avec d’autres auteurs ou institutions (comme les Archives Départementales des Bouches du Rhône avec la création d’un fond photographique à partir de « L’esprit des calanques » en 2012). Noces ou les confins sauvages, traversée intime du littoral, m’a amené à redéfinir de précédentes pratiques documentaires – des écritures aux objets – et à envisager différemment la place des publics dans le dispositif de création. Après différentes expositions, la publication de l’ouvrage aux éditions sunsun en 2018 et plusieurs acquisitions (Arthotèque Intercommunale Ouest Provence, FCAC Ville de Marseille), je prolonge cette recherche grâce au soutien du CNAP (2019). Il s’agit maintenant de suivre la piste de l’homme-animal : une expérience de la rencontre entre espèces et de la traversée des frontières, pour composer un récit choral de nos relations aux non-humains. Entamé au cours d’une résidence participative en pays de Grasse (Alpes maritimes) en 2018/2019, cette collecte de documents est désormais menée avec les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, pour une restitution à l’occasion du Congrès mondial de la nature en 2021. » Hélène David
Sébastien Arrighi
Wasteland
À propos de la série
« Le projet Wasteland est une exploration du bassin de rétention du barrage de Bimont, près d’Aix-en-Provence, durant sa phase de restauration en 2018. Privé de sa principale source d’alimentation, la galerie artificielle de la Campane, le bassin s’est retrouvé asséché, laissant apparaître un désert fragile et isolé, curieusement semblable à d’autres espaces, à d’autres contrées. Cependant le retrait de ces eaux, nous révèle la Cause (rivière naturelle du site). Elle ruissèle depuis la face nord de la Sainte-Victoire et semble reprendre ses droits, en parcourant à nouveau ce paysage découvert et les restes qui le compose. Débris et autres reliques d’ordinaire invisibles, tels les témoins d’un autre temps. Que les eaux acheminées depuis les Gorges du Verdon, allaient sous peu dissimuler et recouvrir d’une resplendissante étendue turquoise.
Spectateur privilégié de ces différentes scènes, la proximité de mon lieu de résidence avec le site, ainsi que le soutien de la DRAC PACA m’ont permis d’entreprendre ces nombreuses reconnaissances, promenades et découvertes. À l’aide de ma chambre photographique de grand format. Matériel lourd m’obligeant à limiter mes déplacements au profit de vastes expectatives, révélatrices d’apparences inespérées. »
Sébastien Arrighi
- Année•s : 2017-2019
- Commune•s : Saint-Marc-Jaumegarde
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Sébastien Arrighi
Documentation :
Annexes_Sebastien Arrighi_Inventaire (pdf)Sébastien Arrighi
Sébastien Arrighi (né en 1992 à Ajaccio, Corse-du-Sud), est un artiste diplômé avec les félicitations du jury de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence. Ses travaux photographiques et vidéo sont régulièrement exposés et saluées par des prix français et internationaux. La Collectivité de Corse, la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que le CNAP apportent leur soutien à ses nombreuses recherches par le biais d’aides à la création, à la publication et à l’exposition. Il est également représenté par la galerie Sintitulo à Mougins depuis 2018.
Qu’il s’agisse de paysages du quotidien ou d’énigmatiques scènes, les images de Sébastien Arrighi appréhendent le réel différemment. Ainsi, la corporalité étrange qui est propre à la brume ou aux stries du dehors, fait la teneur profonde et intime de ses images. D’une tension et d’un désir en résulte des objets, des morceaux de paysages, que la pensée puisse exprimer. Ce sont des relations anonymes et opaques qui arrivent sans mot, sans nom, des relations recouvertes et masquées. Tel des univers parallèles qui communiquent et finissent par s’entrecroiser, suite à des glissements géologiques qui auraient finalement bouleversé l’ordre ou la mémoire des temps.
Sylvain Duffard
La forêt habitée, paysages de la Sainte-Baume
À propos de la série
« Les forêts, à l’image de la grande majorité des espaces naturels terrestres, ont été progressivement occupées et modelées par l’homme au cours des siècles. L’histoire de la forêt est ainsi indissociable de ses rapports avec l’homme. Après avoir au Moyen Âge projeté sur la forêt nombre de peurs et de croyances, l’homme l’a peu à peu reconsidérée puis investie pour alternativement la jardiner, l’exploiter ou la préserver. Entre approche utilitariste et élan contemplatif ou spirituel, l’homme s’efforce désormais de trouver un juste et durable équilibre entre les divers usages qu’il fait du milieu forestier et de ses ressources. Que vient faire aujourd’hui l’Homme en forêt ? Que représente l’espace forestier pour celles et ceux qui le fréquentent ? Ceux-ci s’aventurent-ils au cœur des massifs, privilégient-ils les espaces aménagés ou ceux situés en lisière ? Comment cohabitent les personnes qui résident sur ces territoires avec celles, de passage, qui viennent y pratiquer leurs loisirs et s’y ressourcer ? Ce sont quelques-unes des questions qui ont animé mon travail photographique sur le paysage forestier français.
Me rendant successivement sur dix-sept forêts domaniales, dans le cadre d’une commande photographique que l’Office National des Forêts m’a confiée entre 2009 et 2010, j’ai confronté mon regard à des territoires forestiers vivants, complexes et contrastés. J’ai observé la manière dont travailleurs, résidents ou vacanciers prennent place dans ces paysages. J’ai simultanément porté mon attention sur les marques – superficielles ou profondes – témoignant de l’action de l’homme sur la nature : celles aisément identifiables dans le paysage tels que barrières, pistes et cheminements, mais aussi celles, souvent plus ténues, lisibles dans la structure même des boisements.
La présente sélection est consacrée à la forêt domaniale de la Sainte-Baume et à ses abords. »
Sylvain Duffard
- Année•s : 2009-2010
- Commune•s : Forêt domaniale de la Sainte-Baume
- Commanditaire•s : Office National des Forêts
- © Sylvain Duffard / Office National des Forêts
Sylvain Duffard
Né en 1975, Sylvain Duffard est photographe indépendant. Il vit et travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Diplômé de l’Institut de Géographie Alpine (IGA), Université Joseph Fournier de Grenoble en 1999, c’est en autodidacte que Sylvain Duffard développe sa pratique photographique. Se confrontant à la commande dès 2006, il développe un travail portant sur le paysage quotidien, démarche rapidement sous-tendue par l’émergence de questionnements relatifs à ses modes de fabrication. Il fait ensuite l’expérience de la commande publique dans le cadre de missions photographiques consacrées à l’observation du paysage ; commandes inscrites dans le sillage de missions photographiques historiques telle que celle que la DATAR engagea au début des années 1980. Ces expériences constituent pour lui un espace d’apprentissage privilégié et le lieu d’une expérimentation riche et personnelle du paysage. De 2008 à 2010, il répond à une commande de l’Office National des Forêts ; commande qui donnera naissance à sa série « La forêt habitée ». Il réalisera ensuite successivement les séries chronophotographiques de trois Observatoires photographiques des paysages, à l’échelle du Parc Naturel Régional des Alpilles, puis du département de Haute-Savoie et enfin de l’Archipel Guadeloupe. De 2017 à 2018, l’Atelier des Places du Grand Paris lui confie une commande de paysage relative aux sites jouxtant certaines des futures gares du Grand Paris Express.
Atlas Métropolitain — Luczak / Bublot
Littoral
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2012
- Commune•s : Berre-L'Étang, Fos-sur-Mer, Marseille, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Salin-de-Giraud
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Luczak / Bublot
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Cyrille Weiner
Les longs murs
À propos de la série
La série « Les longs murs » a été réalisée en 2004, dans le cadre d’une commande publique visant à documenter les mutations urbaines liées au projet Euroméditerranée. Les commanditaires étaient l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction générale des affaires culturelles de la Ville de Marseille et la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les photographies proposent un regard lucide, inspiré des formes documentaires, et s’arrêtent sur l’espace-temps spécifique d’un projet urbain. Elles fixent des lieux que l’aménagement transforme, touchant ainsi aux relations des hommes à la ville. Les paysages et situations photographiés, ordonnés en séquences, se renvoient les uns aux autres. Ainsi s’établit un dispositif narratif qui emprunt de fiction, afin d’interpréter plus librement les problématiques géographiques, urbaines et sociales.
- Année•s : 2004
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Direction Générale des Affaires Culturelles de la Ville de Marseille, DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, Ministère de la Culture et de la Communication
- © Cyrille Weiner
Documentation :
Cyrille Weiner_Les longs murs_Annexes_Inventaire (pdf)Cyrille Weiner
À partir d’enquêtes précises menées sur les lieux, Cyrille Weiner pose de façon récurrente la question de l’espace – notamment dans ses marges et ses lieux de transformation. Se demandant obstinément comment les individus peuvent investir leurs lieux de vie, à distance des directives venues « d’en haut », l’artiste quitte peu à peu le seul registre documentaire pour proposer un univers traversé par la fiction, qu’il met en scène dans des expositions, des projets éditoriaux et des installations.
Né en 1976 et diplôme de l’ENS Louis Lumière, il est l’auteur de Presque île (éditions villa Noailles – archibooks), de Twice (éditions 19/80), et de La Fabrique du pré (éditions Filigranes). Ses travaux ont été exposés au Mucem, au Musée d’art contemporain de Lyon, à la villa Noailles et à la Bibliothèque Nationale de France.
David Giancatarina
Marseille Vertical
À propos de la série
Les éditions Le Noyer m’ont contacté pour réaliser un livre dans leur collection Vertical autour de la ville de Marseille. Suite à l’édition du livre, j’ai réaliser des expositions avec certaines images du livre, ainsi que des images « unpublished ».
- Année•s : 2013-2014
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Éditions Le Noyer
- © David Giancatarina / SAIF
David Giancatarina
Né le 16 décembre 1971 en Avignon, je suis venu m’installer à Marseille pour mes études aux Beaux-Arts de Marseille, j’ai complété ma formation par une année à l’école polytechnique d’art de Bristol en Angleterre. Mon DNSEP en poche, j’ai poursuivi ma pratique photographique conceptuelle. En parallèle, j’ai porté mon regard sur la ville avec mon projet Paysages Urbains : une étude photographique sur le territoire des villes à travers le monde. Ces images proposaient une relecture de l’évolution contemporaine de nos cités et espaces publics. La ville, véritable réservoir de couleurs, où viennent se juxtaposer masses de béton, aplats de bitume, parois minérales et éléments végétaux, était appréhendée comme une scène en mutation. Il s’agissait de saisir le visage aléatoire de la ville, résultat d’innombrables années d’évolutions et de cohabitations. Ce travail a été montré dans diverses expositions en France et en Inde. Paradoxe de cette époque, alors que mon travail personnel se portait sur tous ces petits détails qui font la ville et qui échappent aux architectes; ces derniers sont venus vers moi pour me demander de photographier leurs créations. C’est également à cette époque où Monsieur Champsaur, alors directeur du CAUE 13 m’a proposé une mission autour du territoire de l’Agglopole Provence. Cette série est présentée sur ce site.
Dans la lignée de mes intérêts portés sur la frontière art/document… le service du patrimoine du conseil général de la Drôme me passa une commande sur les dix premiers sites classés par Mérimée pour une exposition au château de Suze la rousse. J’ai porté ensuite le même type de regard sur l’abbaye de Fonfroide dans le cadre de l’édition d’n livre collectif . Lors d’un séjour au Vietnam, j’ai réalisé le Portrait d’un pays communiste à l’heure de la globalisation. C’est en fait une suite d’images de paysage où se mêlent tradition, histoire récente et consumérisme de masse… influences mêlées le long des rizières du Nord. De mon rapport à l’espace, au document, au tableaux photographique sont nées des séries autour de grands chantiers chargés de sens. La renaissance du Château Borely et sa mutation en musée; et plus récemment une mission photographique autour de la création de la nouvelle médiathèque de Pertuis, construite en partie sur le site d’une ancienne église.
C ’est en 2014 que les éditions du Noyer m’ont convié à réaliser le volet Marseillais de leur collection de livres autour des villes : Marseille Vertical. En a découlé par la suite l’exposition Marseille Vertical, Published & Unpublished, mêlant des images du livre ainsi que des choix plus personnels. Aujourd’hui, photographe professionnel travaillant essentiellement dans les domaines de la photographie d’architecture et des musées d’une part, et artiste développant un travail plastique et conceptuel d’autre part, je n’ai de cesse de revenir à la photographie documentaire autour de la ville, le paysage et la ruralité.
Chris Garvi
Mother of Muses
À propos de la série
C’est à la fois l’amour de la ville et la photographie de rue qui ont motivé ce travail. La lumière, les couleurs et l’intensité d’une ville en effervescence m’attirent. La lumière, les couleurs et la diversité d’une ville en plein bouleversement, où certains quartiers autrefois populaires soumis à la gentrification ont laissé place à une nouvelle population plus aisée. Une forme de violence émane ainsi de ces images fortement contrastées, où l’entre-deux est à peine envisageable dans cette ville. Il fut un temps où l’on disait : « Marseille, tu l’aimes ou tu la détestes ». Force est de constater que la ville fait de plus en plus l’unanimité, si l’on s’appuie notamment sur la montée du tourisme et les prix de l’immobilier en pleine hausse… Cette série est toujours en cours de réalisation. Le titre est emprunté à une chanson de Bob Dylan, « Mother of Muses ».
- Année•s : 2013-2023
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Chris Garvi
Chris Garvi
Parallèlement à ses débuts en photographie, Chris Garvi a suivi des études de littérature et de civilisation anglaise et américaine en France, puis à l’étranger. Travaillant aussi bien en noir et blanc qu’en couleur, il continue de privilégier la photographie argentique pour tous ses projets personnels. Chris Garvi est un photographe autodidacte qui a fait son apprentissage à travers des livres de photographie.
Ses premières influences sont les photographes américains de la FSA (Farm Security Administration) et l’école humaniste française. Il varie et adapte ses « outils » en fonction de ses projets et de ce qu’il cherche à raconter. Il refuse de figer sa photographie dans une seule « technique » afin de lui permettre d’évoluer en permanence. Ses travaux, qu’ils soient documentaires ou fictionnels, témoignent de son attention particulière à leur aspect narratif.
Depuis 2000, ses travaux ont fait l’objet de plusieurs expositions et ont été publiés dans plusieurs magazines. Son travail « Marseille, colors I sing » a été présenté dans le catalogue des Biennales de la photographie d’Aubagne en 2016. En 2016, il a co-édité avec sa compagne Pauline Alioua leur premier ouvrage commun intitulé « Plein Cœur ». En 2018, leur travail commun sur le Maroc, intitulé « Dans le Creux du Manque », a été publié par l’éditeur arlésien Arnaud Bizalion.
« Je fais de la photographie depuis toujours, enfin, presque. Ma mémoire fonctionne toujours par fragments ; je n’ai jamais su me souvenir des choses dans leur continuité. Même lorsque je n’ai pas l’œil dans le viseur, je continue de photographier. Je suis toujours à la recherche de ma photographie, de mon regard : qu’y a-t-il dans cet espace qui me sépare de l’objet photographié : frontière, miroir, projection, chemin, passage, barrière, théâtre, réalité… »
Chris Garvi vit et travaille à Marseille.
Valérie Jouve
Les Ponts Schulh
À propos de la série
Découvrez dans l’annexe « documentation », le texte de Thierry Durousseau publié aux Éditions Générales, 1998, dans l’annexe pour saisir la dignité des ouvrages de la plus ancienne autoroute de Marseille et la pertinence de la série de Valérie Jouve.
Deux questions se posent ici : celle de l’ouvrage d’art comme constitutif, totalement ou partiellement, de l’autoroute déjà séparée en tracé et dépendances, et celle, de l’auteur, introuvable par nature dans un corps si hiérarchisé, ce qui nous amène à (ré-) attribuer, comme en histoire de l’art, des ouvrages à André Schulh, ingénieur dirigeant le service des Ponts et Chaussée du département des Bouches du Rhône sous le Ministère des Travaux Publics du Transport et du Tourisme.
- Année•s : 2015
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Fonds communal d'art contemporain de Marseille
- © FCAC Ville de Marseille / Valérie JOUVE, ADAGP Paris, 2020
Documentation :
documentation_pont (pdf)Valérie Jouve
Pour Valérie Jouve, la question du traitement de l’espace est au cœur du sujet : il s’agit de comprendre comment la figure, humaine ou autre, confère une présence à ce qui l’entoure et de ce fait vient influencer le lieu. Ces dernières années Valérie Jouve aime à voir des villes ou des villages nourris de multitude d’éléments du vivant. Après un travail exclusivement sur les villes, elle travaille depuis cinq ans entre la ville et la campagne pour questionner ces liens qui les nourrissent mutuellement. Comment ré-inventer leurs relations ? En effet, si la dimension utopique existe dans ce travail, la photographie peut nourrir nos imaginaires d’autres possibles. En exemple, on peut retrouver le travail de reconstruction d’un imaginaire de la Palestine qu’elle a mené́ en dehors de son conflit avec son voisin israélien.
En lien et parallèlement à son activité́ artistique, elle enseigne à l’École National d’Art Supérieure de Paris. Elle a collaboré avec des architectes sur différentes commandes photographiques concernant l’architecture et la ville. Depuis 2017, elle collabore au sein d’un laboratoire de recherche en anthropologie urbaine, le LAA, LAVUE (UMR 7218 CNRS).
Ses expositions sont souvent conçues comme des compositions visuelles, le temps d’un lieu. Les images sont construites indépendamment pour être utilisées dans les montages lors des différentes expositions. Comme ce fut le cas dans sa dernière exposition rétrospective au Jeu de Paume en 2015.
Elle commence une pratique cinématographique dès 2001 avec le film « Grand Littoral », et poursuit une pratique mêlant photographie et séquences filmées depuis ce jour, considérant que ces deux outils d’enregistrement pouvaient travailler ensemble plutôt que de se tourner le dos.
Xavier Lours
Rodéo
À propos de la série
«Plan-de-Campagne est un monde en soi. Avec ses 520 enseignes disposées sur plus de 250 hectares, elle est communément présentée comme la plus grande zone d’activités commerciales de France et la seconde d’Europe. Créée en 1960 en périphérie de Marseille, sur un modèle importé des malls américains, son paysage compose avec un mélange d’architecture industrielle, de nappes de béton et d’immenses publicités lumineuses.
J’ai toujours trouvé cette zone extrêmement photogénique de nuit. De nombreux projets photographiques ont documenté son évolution, à l’instar de celui d’André Mérian (série « The Statement », 2002) ou des missions photographiques de la DATAR. J’ai pour ma part commencé à m’intéresser à ces décors en y expérimentant une méthode déambulatoire inspirée des dérives situationnistes.
La nuit, à la fermeture des magasins, l’ambiance change. Beaucoup de jeunes viennent profiter des quelques bars, des fast-food, du cinéma ou du bowling. Plan-de-Campagne devient un plateau libre sur lequel, à l’écart de la ville et des habitations, des usages s’inventent. Les meetings de la série « Rodéo » en sont un exemple. Suite à quelques recherches sur les réseaux sociaux, j’ai pu me rendre à certains d’entre eux durant l’été 2018. Ils ont toujours lieu le même jour et durent parfois jusque très tard. L’organisation spatiale de ces rassemblements m’a d’abord étonné. Les participants se regroupent par modèles de voitures : les allemandes sur le parking de Kiabi, les italiennes sur le parking de But, etc. La plupart du temps, il ne s’agit que de rassemblements statiques entre amateurs de voitures trafiquées. Mais parfois, l’atmosphère s’électrise. Alors, les parkings se transforment en arène pour rodéos urbains. Il s’agit pour les participants d’enchaîner, à tour de rôle, des drifts devant des spectateurs ravis filmant au smartphone. » Xavier Lours
- Année•s : 2018
- Commune•s : Cabriès, Pennes-Mirabeau
- Commanditaire•s : Collectif Point-Virgule
- © Xavier Lours
Xavier Lours
Xavier Lours est urbaniste-photographe à Marseille. Amoureux de street-photography, il utilise le médium photographique avant tout comme un motif à la dérive. Son travail se situe principalement dans des décors très urbains, au cœur d’ambiances populaires, chaotiques et festives. Les villes sont des protagonistes à part entière de ses images. Il réalise, par ailleurs, des reportages pour la presse et aime collaborer, au gré des rencontres, avec des musiciens, des architectes, des artisans, etc.
Brigitte Bauer
Le territoire du bord
À propos de la série
Résidence au Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger, Port-de-Bouc, avril 2016, à l’occasion des 150 ans de la ville. Exposition à l’ancienne Halle à Marée, du 9 juillet au 9 septembre 2016. La ville m’est d’abord apparue par ses coupures et séparations : autoroute, canal, chemin de fer. Et puis une continuité s’est déployée. Ici, la mer semble border la ville comme on dit d’un lit qu’il est bordé. Traverser le centre et inévitablement retrouver l’eau au bout du chemin : le canal, la mer, le chenal. Lors de ces journées de printemps, le temps de la résidence, la présence humaine se faisait encore très discrète. Sur les plages, davantage de silhouettes traversantes que de corps allongés, sur les chemins du bord, seulement les allers et retours à heure fixe des promeneurs de chiens. Même sur le grand terrain de jeu, les rares enfants semblaient en retrait, comme en attente d’un signal de départ qui ne venait pas. C’est alors l’architecture qui s’est imposée au premier plan : la copie d’un célèbre pont, des blocs d’immeubles tout en blanc comme pour signaler la présence de la ville aux pétroliers ancrés au large, une cabane prise dans ses filets, et ailleurs, dans le chenal, ces architectures industrielles un peu ou beaucoup sur le déclin, reliées entre elles par un chapelet de pêcheurs alignés au bord de l’eau.
- Année•s : 2016
- Commune•s : Port-de-Bouc
- Commanditaire•s : Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger
- © Brigitte Bauer / Adagp, Paris, 2020
Documentation :
Brigitte Bauer_Le Territoire du Bord_Annexes_Inventaire (pdf)Brigitte Bauer
Née en Allemagne (Bavière), Brigitte Bauer vit et travaille à Arles. Après le développement d’une culture du paysage dans ses premières séries de photographies telles que Montagne Sainte-Victoire ou Ronds-Points, ses recherches s’orientent aujourd’hui davantage vers les territoires du quotidien, que ce soit dans l’espace urbain, rural ou familial ou encore à la lisière de son monde professionnel avec Vos Devenirs, un ensemble de portraits de ses anciens étudiants. Parmi ses principales publications, on trouve « Haus Hof Land » (éditions Analogues, 2017), « Aller aux Jardins » (Trans Photographic Press, 2012), « Fragments d’Intimité » (Images en Manœuvres, 2007), « Fugue » (Estuaire 2005), « D’Allemagne » (Images en Manœuvres 2003), « Montagne Sainte-Victoire » (Images en Manœuvres, 1999) et, plus récemment, les auto-éditions « Seoul Flowers and Trees, tribute to Lee Friedlander », 2018 et « akaBB – tribute to Roni Horn », 2019. Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’international et sont présentes dans des collections publiques et privées telles que le Fonds National d’Art Contemporain, la Bibliothèque Nationale de France, la Deutsche Bank, l’Union des Banques Suisses, le musée Carnavalet, le Centre de Photographie de l’Université de Salamanca…. Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 1990 et de l’Université Aix-Marseille en 1995, Brigitte Bauer enseigne la photographie à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes.
Anne Loubet
Marseille les collines
À propos de la série
« Marseille est un ensemble de noyaux villageois reliés et contraints par le relief particulier de ce vaste territoire. Une ville de mer et de collines. Je suis particulièrement émue par les ouvrages d’art comme les ponts ou les aqueducs à la Eiffel qui jalonnent la France rurale. À Marseille ce n’est pas la prouesse ou la technique des ouvrages qui a retenu mon attention, mais cette ténacité de l’être humain à bâtir son habitat dans la nature si revêche soit elle. En sillonnant la ville à la recherche des résurgences de la roche, des pans de colline brute, je cale mes trajectoires à la topographie, aux collines qui font la particularité de Marseille. Cette approche documentaire du paysage urbain permet de souligner les différences d’habitat, les poches de respiration octroyée aux espaces naturels, la densité du bâti, selon les quartiers traversés. Cette déambulation s’opère sous des lumières tamisées et des heures choisies, cadrages à hauteur d’œil pour incarner ce parcours pédestre et inviter à une lecture sensible de la ville. » Anne Loubet
- Année•s : 2006-2020
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Anne Loubet / SAIF
Anne Loubet
Le Nord a été le terreau de l’imaginaire d’enfance d’Anne Loubet. Elle aborde la vie avec légèreté, observe ses contemporains sans drame ni tragédie, et accorde une certaine sacralité aux gestes et aux personnes ordinaires, portée par un idéal communautaire.
Après des études de lettres et de cinéma documentaire à l’Université de Lille, Anne Loubet s’est tournée vers la photographie à l’école d’Arles. Elle puise son inspiration aussi bien dans l’audace performative de Sophie Calle que dans la frontalité de Diane Arbus, la vitalité des peintures de Goya ou de Bruegel, ainsi que les portraits grinçants de Velasquez.
Atlas Métropolitain — Freychet / Martin
Patrimoine touristique
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2013
- Commune•s : [Non renseigné]
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Freychet / Martin A
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Morgane Guiard
Les murs montent
À propos de la série
« Je suis retournée dans la ville où j’ai grandi, et où mes parents continuent de vivre. Sur place j’ai constaté qu’un grand nombre des villas de lotissement avaient rehaussé leurs murs d’enceinte. Pour la plupart, il n’y avait auparavant qu’un muret mesurant 1m à 1m50. Depuis quelques années, les habitants de ces maisons individuelles modestes entamaient des travaux pour ajouter des rangées de parpaings et créer un refuge d’aspect impénétrable.
Parce que le travail de maçonnerie est généralement réalisé à la va vite et avec peu de budget la trace de l’élévation se charge d’une paranoïa sécuritaire qui semble devenir indispensable. Il ne doit y avoir aucunes intrusions, que cela soit celle d’une personne malhonnête ou que cela soit les regards de passants curieux. Les individus se tournent sur eux même et limitent le contact avec le voisinage et l’espace public.
Après avoir constaté ce phénomène, j’ai ressenti le besoin d’inventorier ces murs marqués par des strates de béton et d’enduit. J’ai réalisé des photographies numériques, en gardant une ligne de conduite précise. Le mur est frontal et la maison devient une sorte de bloc de béton coupé par la ligne horizontale. L’habitation devient alors un coffrage vide de présence humaine et perd son aspect de lieu de vie.
Les photographies imprégnées d’un style documentaire cherchent à garder une esthétique plastique. Présentées côte à côte ou projetées les unes à la suite des autres, elles permettent de constater l’enfermement des habitants dans leur espace intime.
« Les murs montent » est une série de photographies numériques réalisée entre 2012 et 2013 sur la commune de Marignane. » Morgane Guiard
- Année•s : 2012-2013
- Commune•s : Marignane, Saint-Victoret
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Morgane Guiard
Morgane Guiard
Née en 1989 à Martigues. En 2013, elle obtient un DNSEP avec les félicitations du jury à l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence.
Karine Maussière
Littoralités, Marseille
À propos de la série
« Tramé dans la lumière, le littoral méditerranéen a une relation particulière avec le ciel. Se perdre sur son bord, c’est être disponible aux abondances visuelles et sonores qui s’offrent et découvrir de nouveaux contours de son territoire mouvant. Les photographies ont une dominante et répondent à une approche sensible par le pas de l’errance. Mon geste est un instant vécu sur le chemin. Il s’agit de voir ce qui fait sens au bord, d’écrire l’image qui est en train de se faire. » Karine Maussière
- Année•s : 2012
- Commune•s : Marseille, Martigues
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Karine Maussière / SAIF
Karine Maussière
« Je vis sous le soleil, exactement, au milieu d’un jardin, dans le sud de la France. Née en 1971 d’un père passionné de haute montagne, je me familiarise très tôt à la marche. De cette enfance baladée, il me reste des paysages arpentés, écoutés, contemplés, humés, aimés. Traces durables qui me font aujourd’hui encore m’émerveiller face à la beauté du monde. C’est dans cet élan que je positionne mon esprit dans un mouvement d’ouverture. Les paysages me procurent un sentiment d’être au monde en favorisant une appartenance commune à la terre. Diplômée des Beaux Arts, j’utilise la photographie dans ma relation au monde tout en interrogeant ma place dans la pensée écologique à l’ère de l’anthropocène. « Ensemble, nous décidons que la Terre est un seul et petit jardin. » Cette proposition de Gilles Clément, initiateur du jardin planétaire, bouleverse la réflexion sur l’homme et son environnement. La Terre est, comme le jardin, un espace clos, fini et arpentable que l’Homme doit ménager. A partir de ces idées, je choisis de mettre le paysage au coeur de mes préoccupations et décide de développer des axes de recherches sur les paysages. Paysages à la nature changeante mais aux qualités esthétiques indéniables, le paysage devient sujet d’étude et de représentation. La quête de son appropriation habite ma recherche artistique. Cette appropriation se fait par l’image et par le mouvement du corps. Depuis, la notion du mouvement est comme un leitmotiv. » Karine Maussière
David Giancatarina
Agglopole Provence
À propos de la série
À l’aube du XXI siècle, ni à Aix ni à Arles, ni à Marseille ni à Avignon, entre la Durance et la mer de Berre, 515 km2, 17 communes et 127 000 habitants se découvrent dans une gouvernance nouvelle, partagée et balbutiante : la Communauté de Commune Agglopôle Provence.
Entre juin et septembre 2003, le photographe David Giancatarina partit en mission à la demande du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-Rhône (CAUE13), en quête d’une identité paysagère, d’un patrimoine commun, aussi fugace que prégnant, une résilience du territoire.
De cette pérégrination automobile, avec son 6×6 Hasselblad, ses objectifs de 60, 80 et 100 mm, le photographe impressionna quelques 5000 vues sur films négatifs couleurs Kodak Portra.
10 ans plus tard, alors que la photographie numérique, Internet, les réseaux nous inondent tous d’un flots continu et homogène d’images géo-référencées, datées, taguées, « likées », dupliquées à l’infini, le CAUE13 a jugé nécessaire de faire exister ce travail non pas en le figeant dans une taxinomie mais en renforçant sa démarche impressionniste.
L’aventure iconique est alors complétée par le déplacement littéral du poète Arno Calleja.
Son texte, sans majuscule ni ponctuation, en 127 chapitres indépendants des 127 clichés finalement retenus participe à la constitution d’un point de vue, plus intuitif que scientifique, plus porteur de sens que d’exhaustivité. Un Flux pour porter et transporter dialogues et débats.Aujourd’hui, ce travail espère toujours trouver l’opportunité d’être publié. En attendant, il participe à cet « état des lieux du paysage dans la photographie » et témoigne ainsi de l’attachement du CAUE13 à l’apport des auteurs pour la compréhension de nos paysages.
Nicolas de Barbarin, CAUE 13.
- Année•s : 2003
- Commune•s : Alleins, Aurons, Berre-L'Étang, Charleval, Eyguières, La Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues
- Commanditaire•s : CAUE 13
- © David Giancatarina / SAIF
Documentation :
David Giancatarina_Agglopole Provence_Annexes_Inventaire (pdf)David Giancatarina
Né le 16 décembre 1971 en Avignon, je suis venu m’installer à Marseille pour mes études aux Beaux-Arts de Marseille, j’ai complété ma formation par une année à l’école polytechnique d’art de Bristol en Angleterre. Mon DNSEP en poche, j’ai poursuivi ma pratique photographique conceptuelle. En parallèle, j’ai porté mon regard sur la ville avec mon projet Paysages Urbains : une étude photographique sur le territoire des villes à travers le monde. Ces images proposaient une relecture de l’évolution contemporaine de nos cités et espaces publics. La ville, véritable réservoir de couleurs, où viennent se juxtaposer masses de béton, aplats de bitume, parois minérales et éléments végétaux, était appréhendée comme une scène en mutation. Il s’agissait de saisir le visage aléatoire de la ville, résultat d’innombrables années d’évolutions et de cohabitations. Ce travail a été montré dans diverses expositions en France et en Inde. Paradoxe de cette époque, alors que mon travail personnel se portait sur tous ces petits détails qui font la ville et qui échappent aux architectes; ces derniers sont venus vers moi pour me demander de photographier leurs créations. C’est également à cette époque où Monsieur Champsaur, alors directeur du CAUE 13 m’a proposé une mission autour du territoire de l’Agglopole Provence. Cette série est présentée sur ce site.
Dans la lignée de mes intérêts portés sur la frontière art/document… le service du patrimoine du conseil général de la Drôme me passa une commande sur les dix premiers sites classés par Mérimée pour une exposition au château de Suze la rousse. J’ai porté ensuite le même type de regard sur l’abbaye de Fonfroide dans le cadre de l’édition d’n livre collectif . Lors d’un séjour au Vietnam, j’ai réalisé le Portrait d’un pays communiste à l’heure de la globalisation. C’est en fait une suite d’images de paysage où se mêlent tradition, histoire récente et consumérisme de masse… influences mêlées le long des rizières du Nord. De mon rapport à l’espace, au document, au tableaux photographique sont nées des séries autour de grands chantiers chargés de sens. La renaissance du Château Borely et sa mutation en musée; et plus récemment une mission photographique autour de la création de la nouvelle médiathèque de Pertuis, construite en partie sur le site d’une ancienne église.
C ’est en 2014 que les éditions du Noyer m’ont convié à réaliser le volet Marseillais de leur collection de livres autour des villes : Marseille Vertical. En a découlé par la suite l’exposition Marseille Vertical, Published & Unpublished, mêlant des images du livre ainsi que des choix plus personnels. Aujourd’hui, photographe professionnel travaillant essentiellement dans les domaines de la photographie d’architecture et des musées d’une part, et artiste développant un travail plastique et conceptuel d’autre part, je n’ai de cesse de revenir à la photographie documentaire autour de la ville, le paysage et la ruralité.
Sylvain Maestraggi
Autour d’Aix-en-Provence
À propos de la série
« Cette série est une exploration des territoires et des paysages des environs d’Aix-en-Provence. Elle est guidée par la volonté de revoir les lieux où j’ai passé mon enfance et dont je m’étais éloigné. Ayant grandi dans les lotissements de la périphérie d’Aix-en-Provence, j’ai évolué parmi des paysages de campagne (champs de blé, maïs, vignes du plateau de Puyricard) et certains sites naturels (le massif de la Sainte-Victoire) tout en menant une vie urbaine, rythmée par les déplacements en bus, en voiture et à vélo. Si les souvenirs d’enfance ont servi d’amorce à cette série, il ne s’agit pas d’une simple « autobiographie photographique », mais plutôt de la relecture d’un paysage connu, ou que je crois connaître, une sorte de re-connaissance qui intègre des éléments dont je n’avais pas conscience autrefois, qu’ils fussent inaccessibles, occultés ou diffus. Le paysage d’Aix-en-Provence est dominé par l’horizon de la montagne Sainte-Victoire, peinte par Paul Cézanne. Ce paysage a d’emblée une dimension pittoresque, soutenue par les signes distinctifs de la campagne provençale (paysages agraires, pins, cyprès, collines). Lors de mes explorations, j’ai cherché à intégrer à ce décor certains aspects concrets de son occupation ainsi que les mutations qu’il subit malgré son allure immémoriale. Il s’agit de questionner l’unité et l’identité de ce territoire que semble garantir l’horizon de la Sainte-Victoire. Cette série est en cours, la sélection présentée a été faite pour l’Inventaire. » Sylvain Maestraggi
- Année•s : 2012-2020
- Commune•s : Aix-en-Provence
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Sylvain Maestraggi
Sylvain Maestraggi
Philosophe de formation, Sylvain Maestraggi pratique la photographie depuis la fin des années 1990. Cette pratique s’est progressivement orientée vers une expérience du paysage traversée par des références historiques, biographiques et littéraires. Au début des années 2000, il collabore avec le photographe Laurent Malone et la conservatrice du patrimoine Christine Breton à l’organisation de marches publiques dans les quartiers Nord de Marseille. De ces explorations naîtra son premier livre de photographies : « Marseille, fragments d’une ville » (2013) ainsi que le film « Histoire nées de la solitude » (2009). En 2014, il publie un deuxième livre de photographies construit autour de la figure de Lenz, personnage errant de Georg Büchner : « Waldersbach ». Jean-Christophe Bailly signe la postface de ce livre, qui sera présenté au Fotobook Festival de Kassel. En 2013, il renoue avec l’exploration urbaine en participant au projet Caravan sur le GR2013 (Bureau des Guides, Radio Grenouille), puis il collabore régulièrement avec le Voyage métropolitain en Île-de-France. En 2017-2018, il participe aux repérages du Sentier métropolitain du Grand Paris. Ces dernières années, il s’est intéressé aux paysages d’Aix-en-Provence et du nord de l’étang de Berre, où il a passé son enfance, ainsi qu’aux villes d’Athènes et Thessalonique. Il est également l’auteur, avec Christine Breton, d’un essai sur les voyages de Walter Benjamin à Marseille.
Franck Pourcel
La petite mer des oubliés – Habitat et modes de vie
À propos de la série
Dans l’esprit des gens de passage depuis l’autoroute ou sur les routes et voies de chemin de fer qui arborent l’étang de Berre, mais aussi à l’atterrissage à Marignane, ou depuis les villes extérieures, l’homme n’existe plus sur ce territoire. Il n’est plus à sa place, il a été oublié. Les baignades ne se pratiquent plus, le chasseur prend son gibier au supermarché de la zone commerciale, les cabanons sont en ruines et ont laissé place aux puissantes cuves de pétroles, le pêcheur n’est plus dans sa barque… L’homme s’est laissé engloutir par ces kilomètres de tuyaux métalliques et la fumée qui sort des cheminées, mêlée aux douces ondulations d’une eau poussée par le vent vers la mer donnent au spectateur la nostalgie d’un passé révolu. Les machines technologiques et industrielles ont dépassé la présence humaine, par les balais incessants des avions, et tous les signes d’apocalypse renforcent ces absences. Le vide est partout. Le déséquilibre du milieu est flagrant, donnant ce fort sentiment de désorientation et cette vision de cohabitations incohérentes : salins, culture maraîchère, centres commerciaux, plages, criques, industrie… L’étang rencontre une poétique bien différente de celle d’antan peinte par Ziem, narrée par Pelletan. Pourtant, ces hommes et ces femmes vivent encore sur l’étang et les histoires voguent encore. Ainsi, il n’est pas étonnant de croiser sur les marchés ces « hommes de l’autre époque », aux épaules larges, aux mains lourdes et lacérées par les filets, ou d’apercevoir perdu dans une immensité industrielle, un nuage d’oiseaux accompagnant les derniers « bateaux ivres » dont l’ivresse est justement de se trouver sur cette « petite mer » pour « fuir » le temps et l’espace surchargés d’une époque moderne. Il n’est pas étonnant non plus d’apercevoir des dizaines de voiles de kite surf ou de planches à voile balayant la plage du Jaï entre Marignane et La Mède ou d’entendre les vrombissements des moteurs surpuissants Offshore dans le port de Saint-Chamas. La vie y est partout, aux pieds de la ville nouvelle de Vitrolles, aux pieds de la raffinerie de Total la Mède, le long du canal du Rove. On pourrait penser que l’homme n’est plus à sa place dans cet univers et pourtant, tous les univers se côtoient dans une opposition volontaire qui semblerait oppressante pour tout individu extérieur à ce monde. Il semble surprenant de constater avec quelle fascination, « l’homme est capable de faire abstraction d’un univers d’apocalypse ». Le lieu semble garder sa poétique et son enthousiasme.Tous les points de vue qu’on peut prendre sur l’étang ne suffisent pas à constituer un paysage. Ils sont réduits au statut de fragments. En permanence, le regardeur est conduit à un travail de cadrage et de recadrage.
- Année•s : 1996-2006
- Commune•s : Berre-L'Étang, Étang de Berre, Martigues, Vitrolles
- Commanditaire•s : ATD Quart Monde, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, GIPREB, Musée archéologique d'Istres, SHADYC, SISSEB
- © Franck Pourcel / SAIF
Franck Pourcel
Franck Pourcel est né en 1965. Photographe hyperactif, il porte une attention toute particulière aux failles de notre temps et aux régions qu’elles abîment – dont l’espace intime des corps. Souci et poétique documentaires définissent son regard, qui longe sans cesse les lignes de partage entre l’habitable et l’inhabitable. Territoires, objets, techniques, gestes : l’accumulation joue un rôle important dans son œuvre. Il s’agit en quelque sorte de faire l’inventaire des formes et modes de vie ayant cours dans un monde globalement ravagé par le capitalisme, pour mieux cerner ses possibilités de réinvention – dont notre survie dépend.
Franck Pourcel
La petite mer des oubliés – Luttes
À propos de la série
Dans l’esprit des gens de passage depuis l’autoroute ou sur les routes et voies de chemin de fer qui arborent l’étang de Berre, mais aussi à l’atterrissage à Marignane, ou depuis les villes extérieures, l’homme n’existe plus sur ce territoire. Il n’est plus à sa place, il a été oublié. Les baignades ne se pratiquent plus, le chasseur prend son gibier au supermarché de la zone commerciale, les cabanons sont en ruines et ont laissé place aux puissantes cuves de pétroles, le pêcheur n’est plus dans sa barque… L’homme s’est laissé engloutir par ces kilomètres de tuyaux métalliques et la fumée qui sort des cheminées, mêlée aux douces ondulations d’une eau poussée par le vent vers la mer donnent au spectateur la nostalgie d’un passé révolu. Les machines technologiques et industrielles ont dépassé la présence humaine, par les balais incessants des avions, et tous les signes d’apocalypse renforcent ces absences. Le vide est partout. Le déséquilibre du milieu est flagrant, donnant ce fort sentiment de désorientation et cette vision de cohabitations incohérentes : salins, culture maraîchère, centres commerciaux, plages, criques, industrie… L’étang rencontre une poétique bien différente de celle d’antan peinte par Ziem, narrée par Pelletan. Pourtant, ces hommes et ces femmes vivent encore sur l’étang et les histoires voguent encore. Ainsi, il n’est pas étonnant de croiser sur les marchés ces « hommes de l’autre époque », aux épaules larges, aux mains lourdes et lacérées par les filets, ou d’apercevoir perdu dans une immensité industrielle, un nuage d’oiseaux accompagnant les derniers « bateaux ivres » dont l’ivresse est justement de se trouver sur cette « petite mer » pour « fuir » le temps et l’espace surchargés d’une époque moderne. Il n’est pas étonnant non plus d’apercevoir des dizaines de voiles de kite surf ou de planches à voile balayant la plage du Jaï entre Marignane et La Mède ou d’entendre les vrombissements des moteurs surpuissants Offshore dans le port de Saint-Chamas. La vie y est partout, aux pieds de la ville nouvelle de Vitrolles, aux pieds de la raffinerie de Total la Mède, le long du canal du Rove. On pourrait penser que l’homme n’est plus à sa place dans cet univers et pourtant, tous les univers se côtoient dans une opposition volontaire qui semblerait oppressante pour tout individu extérieur à ce monde. Il semble surprenant de constater avec quelle fascination, « l’homme est capable de faire abstraction d’un univers d’apocalypse ». Le lieu semble garder sa poétique et son enthousiasme.Tous les points de vue qu’on peut prendre sur l’étang ne suffisent pas à constituer un paysage. Ils sont réduits au statut de fragments. En permanence, le regardeur est conduit à un travail de cadrage et de recadrage.
- Année•s : 1996-2006
- Commune•s : Berre-L'Étang, Étang de Berre, Martigues, Vitrolles
- Commanditaire•s : ATD Quart Monde, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, GIPREB, Musée archéologique d'Istres, SHADYC, SISSEB
- © Franck Pourcel / SAIF
Franck Pourcel
Franck Pourcel est né en 1965. Photographe hyperactif, il porte une attention toute particulière aux failles de notre temps et aux régions qu’elles abîment – dont l’espace intime des corps. Souci et poétique documentaires définissent son regard, qui longe sans cesse les lignes de partage entre l’habitable et l’inhabitable. Territoires, objets, techniques, gestes : l’accumulation joue un rôle important dans son œuvre. Il s’agit en quelque sorte de faire l’inventaire des formes et modes de vie ayant cours dans un monde globalement ravagé par le capitalisme, pour mieux cerner ses possibilités de réinvention – dont notre survie dépend.
Atlas Métropolitain — Doroftei / Pennisi
Le territoire du risque
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2014
- Commune•s : Martigues
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Doroftei / Pennisi
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Anne Loubet
Les Éphémères
À propos de la série
« Ici, on vit dehors » m’avait-on prévenue quand je suis arrivée dans le sud de la France.
Un curieux mode d’occupation du territoire qui devient un prolongement de son chez-soi. Sausset-les-Pins, commune de la côte bleue, surprend par l’étendue de son bord de mer. Ses 8 km de rochers et de galets pas franchement hospitaliers sont pourtant le théâtre de multiples rendez-vous. Cette aptitude à partager des espaces communs et à les investir de rituels intimes est précieuse et pourtant menacée. L’été 2020, les saussetois ont fait face à un incendie ravageur et aux consignes sanitaires de la distanciation.
Comment vivre avec légèreté en intégrant la fragilité de nos existences, la vulnérabilité de nos territoires ?
Mon approche documentaire s’est nourrie de cette tension. La fugacité du mois d’août, l’âge charnière de l’adolescence incarnent cet état paradoxal de nos existences. Les instantanés s’entremêlent, états de grâce et danger sourd composent le récit. Les jeunes en sont les passeurs.
Remerciements
Aux initiateurs de la commande le Conseil départemental et le Centre Photographique Marseille, aux élus municipaux.
À Hélène Forget pour son accueil, Carla et l’école de voile, Denis et Jacky, Maxime et les Marins Pompiers, Thyphaine et les services techniques municipaux, Marjorie et le Parc marin de Carry, Cécile et l’association des Perles de la côte bleue, Carine du camp de scouts de St Julien, les jeunes du skate parc.
Le travail n’aurait pu exister sans la confiance et la complicité des habitants et usagers du territoire ; qu’ils en soient remerciés.
- Année•s : 2021
- Commune•s : Sausset-les-Pins
- Commanditaire•s : Centre photographique de Marseille, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Patrimoine Commun
- © Anne Loubet / SAIF
Documentation :
Anne_Loubet_documentation (pdf)Anne Loubet
Le Nord a été le terreau de l’imaginaire d’enfance d’Anne Loubet. Elle aborde la vie avec légèreté, observe ses contemporains sans drame ni tragédie, et accorde une certaine sacralité aux gestes et aux personnes ordinaires, portée par un idéal communautaire.
Après des études de lettres et de cinéma documentaire à l’Université de Lille, Anne Loubet s’est tournée vers la photographie à l’école d’Arles. Elle puise son inspiration aussi bien dans l’audace performative de Sophie Calle que dans la frontalité de Diane Arbus, la vitalité des peintures de Goya ou de Bruegel, ainsi que les portraits grinçants de Velasquez.
Arnaud Teicher
Wildfire
À propos de la série
Le 28 août 1989 la montagne Sainte-Victoire, chère à Paul Cézanne, s’embrasait. Le feu qui dura 3 jours et 3 nuits dévasta plus de 5 000 hectares et est devenu un des plus gros désastres écologiques dans le sud de la France depuis le siècle dernier. Dès le lendemain, suite aux premières diffusions d’images montrant un massif calciné et méconnaissable, une véritable prise de conscience des pouvoirs publics et des collectivités va être à l’origine de la mise en place d’une profonde organisation pour prévenir, entretenir, équiper et aménager les massifs forestiers du département.
Avec 148820 hectares de forêt, 29 % du département des Bouches-du-Rhône est couvert par des espaces forestiers. À la forêt sʼajoute une forte présence de landes ligneuses occupant 15 % du département. Plus de 40 % de ce territoire est donc fortement exposé aux risques dʼincendie. Par ailleurs, lʼannée 2016, avec 355 départs de feu et 4 974 hectares brûlés, dresse le bilan le plus élevé de cette dernière décennie. Le feu est un élément naturel et fondamental dans le fonctionnement de nombreux écosystèmes forestiers ; pourtant, cet événement reste imprévisible et difficilement contrôlable. Il faut souvent plusieurs jours pour parvenir à maîtriser sa progression. Des recherches de l’Inra montrent que chaque espèce a développé sa propre stratégie pour résister aux flammes et renaître de ses cendres.
Alors que je découvrais avec stupeur et curiosité ces territoires incendiés, l’idée d’un projet photographique s’imposa. L’émerveillement initial me questionnait. Je suis retourné souvent sur ces lieux pour observer et essayer de comprendre pourquoi je restais sous le charme malgré la désolation qui régnait partout. Après chaque incendie, la nature nous offre des paysages violents qui nous bousculent. Cependant, comme un signe d’espoir, la végétation reprend progressivement son chemin malgré la puissance du souffle et la chaleur étouffante. La forêt résiste, lutte et finit par évoluer et survivre. Cette fascination pour les territoires incendiés trouverait-elle sa source dans le fait qu’ils représentent un exemple de persévérance et de courage ? La capacité d’adaptation de la nature face à ces événements ne devrait-elle pas nous inciter à comprendre et à appréhender notre environnement avec davantage de bienveillance ?
- Année•s : 2017-2020
- Commune•s : Aix-en-Provence, Aubagne, Carry-le-Rouet, Eguilles, Marseille, Martigues, Montagne Sainte-Victoire, Rognac, Roquefavour, Saint-Cannat, Velaux, Ventabren, Vitrolles
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Arnaud Teicher
Documentation :
Arnaud_Teicher_wildfire_documentation (pdf)Arnaud Teicher
Né en 1985, Arnaud Teicher est un jeune photographe français installé dans le sud de la France. Après un cursus scientifique et des études de design à Paris, il s’est progressivement rapproché d’un environnement plus familier afin d’accorder du temps à une pratique photographique. Fasciné par les éléments liés à la terre et au paysage, Arnaud explore ce territoire à la recherche de traces, qu’elles soient dessinées par le temps, façonnées par le climat ou laissées par l’homme.
Teddy Seguin
L’île Castellane
À propos de la série
Envisager la cité de La Castellane à Marseille telle une insula romaine, une « île urbaine », voici le postulat de la résidence photographique réalisée dans ce quartier par Teddy Seguin entre 2014 à 2018. L’implantation de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille et son architecture à l’image d’une citadelle imprenable participent de cette insularité urbaine. Une cité autour de laquelle on tourne sans pouvoir vraiment y pénétrer. A l’origine, son projet utopique consistait à recréer des cœurs villageois à la périphérie des quartiers du centre ville, mettant à disposition des habitants commerces, services et écoles. Si l’isolement social des habitants de la cité est l’expression de cette métaphore géographique, peut-on comparer le tempérament paradoxal de la Castellane à celui d’une île entourée d’eau ? Avec ses cinq points d’entrée et de sortie, la cité de la Castellane est un village dans lequel tout le monde se connaît. L’attachement des habitants à leur cité peut être considéré comme une des réussites principales du projet urbain des années 70’. L’ostracisme dont souffrent ces derniers, la solidarité, la méfiance face à celui qui est étranger à la Castellane, le refus de l’autorité et des lois régaliennes sont autant de paradoxes qui participent à un sentiment fort d’appartenance à la cité. Pour aborder cette insula, telle une île au milieu de la tempête, prudence et lenteur furent nécessaires.
L’exposition est accompagné par des textes de Youssouf Djibaba, écrivain qui a grandi dans le quartier de la Castellene. La série proposée fait partie du cycle INSULAE mené depuis une dizaine d’années par Teddy Seguin. A la manière des Insulaires de la Renaissance composés de cartes représentant exclusivement des îles du monde inconnu, le projet INSULAE propose un atlas photographique sur le thème de l’insularité. A l’origine, INSULAE met au défi l’objectivité supposée de la géographie par la proposition aléatoire et fantaisiste d’un archipel personnel d’îles éparses réelles et imaginaires, chacune d’elles devenant prétexte à un voyage. Le repérage de ces territoires insulaires, ne relève pas davantage d’une méthode rigoureuse qui présupposerait d’identifier sa situation, son éloignement d’un continent, sa forme ou son appartenance à un état. Les photographies qui composent INSULAE ne prétendent pas décrire une île en particulier mais davantage effleurer, à force de répétition, une idée d’île, son dedans et son dehors, la difficulté d’accoster, l’immersion dans un monde clos jusqu’à la tentative d’y assumer son altérité. D’une série à l’autre, un objet abandonné, l’expression d’un visage, l’embrasure d’une fenêtre, une perspective sont autant de signes qui fabriquent par leur récurrence, une matérialité du paysage insulaire. L’expérience intime de ces voyages, la rencontre et la découverte d’un territoire a priori hostile forment le terreau de la série INSULAE. Dans cette recherche, l’insularité retient la métaphore cartographique comme fil rouge du projet. Oasis, ghettos urbains ou villages isolés ne reproduisent-ils pas partiellement un modèle insulaire ? Ces environnements ont-ils comme socle commun une tentative d’échapper à l’emprise de la société, de créer un rapport différent à l’espace et à l’autre ? De façon assez surprenante, l’étymologie de l’île, du latin insula qui définit une terre entourée d’eau est semblable à l’insula qui apparait au 1er siècle dans l’urbanisme de Rome et qui désigne un immeuble d’habitation collectif en opposition à la domus, la demeure du maître. Entité dynamique et paradoxale, espace à la fois immuable et fluctuant, image de l’Eden, terre de l’utopie ou de l’isolement, de la solitude et de la mort, l’île est une image mentale créée par le langage. Cette expérience visuelle nous transporte dans des territoires insulaires aussi contrastés que les outport à Terre-Neuve, la cité de la Castellane à Marseille ou la région montagneuse de Castagniccia en Corse.
- Année•s : 2014-2018
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Teddy Seguin
Documentation :
Teddy Seguin_L’île Castellane_Annexes_Inventaire (pdf)Teddy Seguin
Teddy Seguin est sorti de L’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles en 2002. Il se consacre dans un premier temps à la photographie de reportage dans laquelle il explore les univers clos. Ses reportages sont régulièrement publiés dans la presse nationale et internationale. Les microcosmes d’une mine dans les steppes Kazakh, d’un navire de pêche en mer de Barents ou d’un campement de chasseurs cueilleurs dans une forêt équatoriale constituent la base de son travail actuel. A partir de 2010, il commence à développer un travail d’auteur autour de l’insularité. La mondialisation a beau réduire les frontières qui séparent encore les « insulaires » du reste du monde, l’isolement, qu’il soit géographique, social ou culturel façonne encore des caractères forts et singuliers sur lesquels Teddy Seguin s’attarde dans ses dernières séries comme « Outport », « la Natividad » ou « L’île Castellane ». Ces différents travaux sont regroupés dans un cycle encore en cours intitulé INSULAE. Le deuxième chapitre de cette série, « L’île Castellane », vient d’être publié au Editions Zoème.
Chris Garvi
Je marcherai le long de l’Huveaune
À propos de la série
Cela n’échappe à personne, Marseille est une ville tournée vers la mer Méditerranée. Cependant, peu de gens le savent, Marseille est traversée par une rivière : l’Huveaune. Elle s’étend sur une cinquantaine de kilomètres et prend sa source dans le Massif de la Sainte-Baume. À la fin de son parcours, elle traverse les quartiers de Marseille d’est en ouest sur 7,5 kilomètres avant de se jeter dans la Méditerranée. L’Huveaune, aujourd’hui méconnue, a été essentielle à la vie pendant des siècles. Son eau était consommée, elle irriguait les terres cultivées et surtout, elle fournissait l’énergie indispensable à l’artisanat local et aux manufactures.
En 2014, j’ai entendu parler d’un projet délirant qui visait à recouvrir l’Huveaune sur toute sa longueur dès son entrée dans Marseille. Mon projet « Je marcherai le long de l’Huveaune » est une réaction à cette rumeur. Si selon la légende, la rivière est née des larmes d’une sainte, Marie-Madeleine, c’est la promesse d’un parcours poétique qui a éveillé ma curiosité et déclenché ce travail photographique. Très vite, après quelques clichés, j’ai compris que la rivière dissimulait une réalité plus sombre et moins onirique que celle que j’imaginais : victime de la négligence humaine, de la pollution et du manque d’engagement politique ou écologique, elle semblait s’éteindre dans l’indifférence générale. Pourtant, l’eau continue de couler dans son lit et des gens continuent de vivre et de se promener le long de ses rives.
Je m’intéresse au passage de l’homme le long de la rivière, à la relation qu’il entretient avec elle – certains y vivent, d’autres s’y promènent simplement ou y travaillent. Au fil des rencontres, j’ai exploré la mémoire des habitants qui vivent le long de l’eau. Chacun m’a partagé des souvenirs, des anecdotes passées, du bonheur d’avoir pu se baigner dans la rivière à la douleur intime de la voir se mourir.
Ce projet a été réalisé entre 2014 et 2017 avec un appareil moyen format, un Mamiya 7, et sur du film couleur 120 de Kodak.
Chris Garvi
« Et à la fin, en contrepoint de cette défiguration programmée du lieu, pour damer le pion à l’oubli et donner un peu de répit au désespoir et la désolation, il restera le meilleur. Et le meilleur, ce sont ces inconnus croisés, gênés d’avoir été un peu surpris, ces anonymes avec des vraies gueules d’anonymes et leur banalité « supérieure ». Le meilleur ce sont ces rictus à demi consentis et non négociables, ces sourires faiblement esquissés, ces regards sans fioritures, droits et pleins, qui livrent l’âme et charrient la vie parmi les blessures. La vie malgré tout. Chacun de nous à dans ses yeux une petite rivière et un éclat du bleu de la mer… »
Bernard Cantié
- Année•s : 2013-2017
- Commune•s : Aubagne, Auriol, La Penne-sur-Huveaune, Marseille, Roquevaire
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Chris Garvi
Chris Garvi
Parallèlement à ses débuts en photographie, Chris Garvi a suivi des études de littérature et de civilisation anglaise et américaine en France, puis à l’étranger. Travaillant aussi bien en noir et blanc qu’en couleur, il continue de privilégier la photographie argentique pour tous ses projets personnels. Chris Garvi est un photographe autodidacte qui a fait son apprentissage à travers des livres de photographie.
Ses premières influences sont les photographes américains de la FSA (Farm Security Administration) et l’école humaniste française. Il varie et adapte ses « outils » en fonction de ses projets et de ce qu’il cherche à raconter. Il refuse de figer sa photographie dans une seule « technique » afin de lui permettre d’évoluer en permanence. Ses travaux, qu’ils soient documentaires ou fictionnels, témoignent de son attention particulière à leur aspect narratif.
Depuis 2000, ses travaux ont fait l’objet de plusieurs expositions et ont été publiés dans plusieurs magazines. Son travail « Marseille, colors I sing » a été présenté dans le catalogue des Biennales de la photographie d’Aubagne en 2016. En 2016, il a co-édité avec sa compagne Pauline Alioua leur premier ouvrage commun intitulé « Plein Cœur ». En 2018, leur travail commun sur le Maroc, intitulé « Dans le Creux du Manque », a été publié par l’éditeur arlésien Arnaud Bizalion.
« Je fais de la photographie depuis toujours, enfin, presque. Ma mémoire fonctionne toujours par fragments ; je n’ai jamais su me souvenir des choses dans leur continuité. Même lorsque je n’ai pas l’œil dans le viseur, je continue de photographier. Je suis toujours à la recherche de ma photographie, de mon regard : qu’y a-t-il dans cet espace qui me sépare de l’objet photographié : frontière, miroir, projection, chemin, passage, barrière, théâtre, réalité… »
Chris Garvi vit et travaille à Marseille.
André Mérian
La Crau
À propos de la série
« L’enjeu de cette commande, était la représentation de ce territoire complètement hostile. Hostile dans le sens où ce territoire est complètement sec, recouvert de cailloux, une végétation pratiquement inexistante, seul l’espace était omniprésent, c’est cela qui m’a motivé, c’était pratiquement « inphotographiable », après repérages, j’ai arpenté cette « planitude » caillouteuse avec une échelle pour réaliser certaines prises de vue en hauteur, et les autres sont pratiquement faites à raz du sol. J’ai photographié que des choses banales, communes, antennes téléphoniques, traces, objets pris à même le sol, résidus de pied de vigne, structures métalliques, abandonnés par l’homme, qui nous renvoient à la détérioration de cet espace dit naturel. » André Mérian
- Année•s : 1997
- Commune•s : Plaine de la Crau
- Commanditaire•s : Fonds communal d'art contemporain de Marseille
- © André Mérian
André Mérian
« André Mérian est un artiste photographe Français, dans ses photographies documentaires ou fabriquées, la banalité, le dérisoire, le commun, voir l’invisible, nous interrogent sur la question de la représentation.Il expose régulièrement en France et à l’étranger, ses travaux font parties de collections publiques et privées, et font l’objet de différentes monographies. Il est représenté par Les Douches La Galerie à Paris. En 2009, il est nominé au prix Découverte aux Rencontres Internationales de la Photographie en Arles. Depuis un certain temps,il se consacre aux paysages périurbains en France et à l’étranger. L’œuvre photographique d’André Mérian montre un intérêt pour ce qui construit chaque jour notre paysage. Qu’il saisisse des zones périphériques, des centres commerciaux, des architectures de l’organisation humaine, des espaces habités, des chantiers ou des écrans lumineux disposés dans l’environnement public, ses photographies tentent de figer ce qui se dresse autour de chacun, comme le décor moyen, banal, du quotidien. Passée la frontière des villes, l’architecture prend une dimension nouvelle, où le factice, le provisoire et le démontable prennent le dessus. Le résultat est déroutant, et nous interroge sur ces espaces qui s’universalisent, sur le sort réservé à l’homme dans cette esthétique du chaos, ses travaux nous questionnent sur la limite de l’objectivité et de la subjectivité. » Guillaume Mansart, Documents d’artistes PACA
Iris Winckler
Sud
À propos de la série
« J’ai réalisé cette série après m’être installée à Arles pour mes études, en 2014. C’est l’époque à laquelle j’ai découvert Marseille, lieu que je connaissais pas, et que je ne m’étais même jamais imaginé. Ces images sont le fruit de longues marches solitaires au hasard des rues, entre 2015 et 2016. J’ai été frappée par la lumière du sud, qui est comme un voile blanc, ainsi que les couleurs, les textures et les détails urbains d’une ville encore « dans son jus », par endroits délabrée, ailleurs sublime et cossue – partout bordélique. J’ai travaillé avec un tout petit appareil photo argentique afin d’être très mobile. Le rendu modeste des images correspond à mes sensations du moment. On aurait dit que la ville des années 1970 cohabitait avec les quatre décennies suivantes. Impossible pour moi de dépouiller Marseille de son charme, qui provient justement de ce dépouillement sans pareil, de ce feuilleté d’époques qui refusent de partir. » Iris Winckler
- Année•s : 2015-2016
- Commune•s : Arles, Marseille, Saintes-Maries-de-la-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Iris Winckler
Iris Winckler
« Née en 1990, je vis et travaille entre Marseille et Paris. Je suis diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg en graphisme, ainsi que de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles. Depuis 2017, je partage mon activité entre ma pratique personnelle, la photographie d’architecture et autres commandes. En parallèle, j’ai travaillé en tant que guide pour les Rencontres d’Arles ou encore l’exposition « Picasso, voyages imaginaire » (Vieille Charité/Mucem), et comme commissaire de trois expositions de photographie à Avignon, Arles puis Marseille pour le compte de la Région PACA. » Iris Winckler
Sylvain Maestraggi
Suite départementale
À propos de la série
« Cette série est née du désir de sortir des limites de Marseille pour explorer un nouveau terrain photographique à l’issue de mon livre « Marseille, fragments d’une ville » (L’Astrée rugueuse, 2013). Il s’agit d’une exploration des abords de la route de Berre (la départementale 10) qui relie Aix-en-Provence à Saint-Chamas, au nord de l’étang de Berre. Cet itinéraire, je l’ai régulièrement emprunté durant mon enfance pour me rendre chez mes grands-parents. À force de passages, les paysages observés depuis l’arrière de la voiture se sont inscrits dans ma mémoire en un long rêve éveillé. À la manière de l’artiste américain Robert Smithson, dans son récit « Une visite des monuments de Passaic » (Artforum, 1967), j’ai voulu revoir ces lieux pour en éclaircir la signification. Je me suis intéressé à la dimension de décor des sites traversés, à l’ambivalence de la dimension « classique » du grand paysage et de la dimension fonctionnelle, voire dysfonctionnelle, des abords immédiats de la route : zones naturelles, talus, mise en scène autoroutière, zones résidentielles, zones agricoles, monuments de l’Antiquité et des Trente Glorieuses. Une première série d’images a été présentée dans l’exposition « Le paysage dans la photographie, un état des lieux » (commissariat : Camille Fallet) à l’Artothèque de Miramas en 2014, accompagnée de textes écrits à l’issue des explorations. Cette série a été revue pour l’Inventaire. Les communes traversées sont successivement : Ventabren, Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Lançon-de-Provence et Saint-Chamas. Restée sous forme d’esquisse, « Suite départementale » a évolué vers une exploration plus large du nord de l’étang de Berre et de la plaine de l’Arc, détachée de la référence biographique. » Sylvain Maestraggi
- Année•s : 2012-2014
- Commune•s : Coudoux, Étang de Berre, La Fare-les-Oliviers, Lançon-Provence, Saint-Chamas, Ventabren
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Sylvain Maestraggi
Sylvain Maestraggi
Philosophe de formation, Sylvain Maestraggi pratique la photographie depuis la fin des années 1990. Cette pratique s’est progressivement orientée vers une expérience du paysage traversée par des références historiques, biographiques et littéraires. Au début des années 2000, il collabore avec le photographe Laurent Malone et la conservatrice du patrimoine Christine Breton à l’organisation de marches publiques dans les quartiers Nord de Marseille. De ces explorations naîtra son premier livre de photographies : « Marseille, fragments d’une ville » (2013) ainsi que le film « Histoire nées de la solitude » (2009). En 2014, il publie un deuxième livre de photographies construit autour de la figure de Lenz, personnage errant de Georg Büchner : « Waldersbach ». Jean-Christophe Bailly signe la postface de ce livre, qui sera présenté au Fotobook Festival de Kassel. En 2013, il renoue avec l’exploration urbaine en participant au projet Caravan sur le GR2013 (Bureau des Guides, Radio Grenouille), puis il collabore régulièrement avec le Voyage métropolitain en Île-de-France. En 2017-2018, il participe aux repérages du Sentier métropolitain du Grand Paris. Ces dernières années, il s’est intéressé aux paysages d’Aix-en-Provence et du nord de l’étang de Berre, où il a passé son enfance, ainsi qu’aux villes d’Athènes et Thessalonique. Il est également l’auteur, avec Christine Breton, d’un essai sur les voyages de Walter Benjamin à Marseille.
Bertrand Stofleth
Rhodanie
À propos de la série
Rhodanie est une série photographique de Bertrand Stofleth. Il a suivi le cours du Rhône sur plus de 850 km, depuis sa source, un glacier dans le Valais, jusqu’à ses embouchures en mer Méditerranée. L’artiste travaille sur les paysages et les modes de domestication des espaces naturel, afin d’observer les usages et les différentes formes de résiliences à l’œuvre auprès des habitants et des territoires traversés. Il construit ainsi un dialogue entre le paysage fluvial et l’espace frontière qui le borde, interrogeant ce qui se joue entre le fantasme d’une nature encore sauvage et son caractère profondément domestiqué.
- Année•s : 2007-2015
- Commune•s : Arles, Fos-sur-Mer, Salin-de-Giraud, Tarascon
- Commanditaire•s : État français, Ministère de la Culture et de la Communication, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Travail personnel
- © Bertrand Stofleth / SAIF
Documentation :
Bertrand Stofleth_Rhodanie_Annexes_Inventaire (pdf)Bertrand Stofleth
Bertrand Stofleth Artiste et photographe né en 1978 de nationalité française. Diplômé de l’École nationale supérieure de photographie d’Arles en 2002. Ses recherches artistiques portent sur les modes d’habitation des territoires et interrogent les paysages dans leurs usages et leurs représentations. Il documente les lieux intermédiaires : rives d’un fleuve (« Rhodanie », éditions Actes Sud et « Paysages déclassés », éditions 205), chemins de randonnée (« Paysages Usagés OPP-GR2013 », commande CNAP-MP2013, éditions Wild Project), ou abords de métropoles (« Transplantations et Déplacements »). Il construit différents projets d’observatoire photographique du paysage avec le photographe Geoffroy Mathieu auprès de Parc Naturel Régionaux (Monts d’Ardèche, Gorges du Verdon, Narbonnaise en Méditerranée). Depuis 2013, en collaboration avec l’artiste Nicolas Giraud il réalise un projet documentaire des paysages issus de la révolution industrielle (« La Vallée », éditions Spector Books, 2021). Il poursuit le projet Aeropolis explorant les relations entre les imaginaires aéroportuaires et leurs connexions aux territoires urbains (Commande publique nationale de photographie CNAP et Atelier Médicis 2017, Résidence Diaphane 2015). Il travaille actuellement sur trois différents projets interrogeant les changements paysagés liés au réchauffement climatique à différentes échelles de territoires et de paysages : « Recoller la montagne » (Résidence de création Archipel Art Contemporain, 2019-20), « Mission Photographique Grand Est » (La Chambre, Le Cri et Région Grand-Est, 2019-2020), « Observatoire métropolitain de l’Anthropocène » (Ecole Urbaine de Lyon 2020-2023). Il enseigne la photographie en écoles d’art et à l’université. Son travail est présent dans différentes collections publiques et privées en France et à l’étranger.
Emmanuel Pinard
Marseille
À propos de la série
En 2001, l’établissement public Euroméditerranée initiait, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Marseille, une commande photographique destinée à rendre compte des mutations du territoire dont il a la charge. Le secteur concerné, situé au nord du Vieux port, représente une superficie de 300 hectares dont le réaménagement est prétexte à repenser toute la relation que Marseille entretient avec son port. Emmanuel Pinard photographie généralement la substance urbaine des périphéries métropolitaines : le grand espace ouvert, qualifié par les seuls usages dont il est le support, et dénué de toute ambition symbolique. On a coutume d’opposer ce type d’environnement – considéré comme étant dénué de valeur, et chaotique – à l’espace urbain traditionnel du centre – regardé, au contraire, comme porteur de valeurs d’ordre, de hiérarchie et, symboliquement, de représentation de la communauté. Chacune des images produites par Emmanuel Pinard dans le cadre de la commande Euroméditerranée est comme une goutte d’acide déposée sur le vieux consensus de la supériorité du centre sur la périphérie : elle le dissout et donne à voir, en-dessous, l’image d’une ville dans laquelle les éléments d’échelle métropolitaine, tels que les viaducs autoroutiers ou les installations portuaires, cohabitent avec évidence et légèreté avec les éléments d’échelle locale et quotidienne. Dans cet environnement hétérogène, les buvettes s’abritent à l’ombre des piles d’autoroutes, une végétation à demi sauvage s’immisce entre les constructions, les bateaux blancs, plus grands que les bâtiments des quais, font la navette entre les deux rives de la Méditerranée, au-delà de la Digue du Large. La Digue du Large, à partir de laquelle Emmanuel Pinard a photographié la façade de Marseille sous la forme d’un fascinant polyptique de sept pièces et de plus de 8 mètres de long, installation monumentale, à l’image de ce front de mer portuaire et urbain, et qui oblige le spectateur désireux de voir l’ensemble à reproduire le mouvement du photographe marchant sur la digue. Digue du Large d’où, se retournant vers la mer, Emmanuel Pinard a photographié l’horizon, comme il l’a si souvent fait dans ses paysages périphériques. Cet horizon marin n’est pas une simple ligne séparant le ciel de la mer : il est comme incurvé – et, par là même construit – par la présence, à chacune de ses extrémité, de lambeaux de terres émergées. Au premier plan, des blocs de béton signifient l’artificialité de ce paysage habité et, en conséquence, sa dimension culturelle. Un horizon construit, un premier plan de matière, et un propos sur le territoire photographié : là comme à Chelles, à Créteil, à Montesson ou à Brasilia, un même regard, une même capacité d’analyse et un même mystère, pour dire que la photographie documentaire est un engagement artistique qui se situe bien au-delà de l’objectivité.
- Année•s : 2002-2003
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, Ministère de la Culture et de la Communication, Ville de Marseille
- © Emmanuel Pinard / Adagp, Paris, 2020
Documentation :
Emmanuel Pinard_Marseille_Annexes_Inventaire (pdf)Emmanuel Pinard
Emmanuel Pinard est né le 17 octobre 1962 à Ham (60), et décédé le 6 septembre 2014 à Aulnay-sous-Bois (93).
Autodidacte, il s’oriente vers la photographie à l’âge de 18 ans. Son travail vise avant tout à donner à lire la structure profonde des paysages qu’il photographie.
« J’ai tenté de représenter ces espaces ordinaires en me concentrant sur l’épaisseur naturelle des choses, afin d’éviter toute échappée dans une représentation poétique du merveilleux de la vie quotidienne, sans association inconsciente même si ce qui motive le choix de cette photographie plutôt qu’une autre reste mystérieux. L’image n’est pas composée, elle s’impose comme un tout, comme une évidence. Elle s’impose par la force de sa généralité, au risque d’un certain formalisme. » Emmanuel Pinard
Son œuvre est jalonnée de nombreuses expositions personnelles et collectives, de bourses et d’éditions. L’enseignement occupe une place importante dans son parcours. Sa première expérience d’enseignement a lieu lors de son séjour à Brasilia dans le cadre de la Villa Médicis hors-les-murs. Il intervient ensuite à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marne-La-Vallée, de Normandie et de Marseille. A partir de 2010, il est Maître assistant titulaire en Arts Plastiques et Visuels à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais.
Suzanne Hetzel
7 saisons en Camargue
À propos de la série
« Pour donner forme aux impressions, aux images et aux récits que j’ai collectés en Camargue pendant deux ans, je me suis remémorée les Denkbilder (images de pensée) de Walter Benjamin. Ces textes écrits entre 1925 et 1935 nous amènent au cœur des éléments de sa pensée philosophique : le proche et le lointain, le geste qui prélève des fragments chargés d’histoire et d’expériences, le devoir qui nous incombe de les actualiser, sa fascination pour les collectionneurs et les collections, l’importance des gens sans nom dans l’écriture de l’histoire et sa conviction que « les choses anciennes nous regardent ». Il souligne notre responsabilité quant au maintien d’une relation entre le passé, notre présent et un futur. Indéniablement, mon travail artistique porte l’héritage des images de pensée : il se construit à partir d’observations, de rencontres, de documents d’archives, de récits tout comme d’objets trouvés ou collectés, et de photographies, bien sûr ! Il s’agissait ici de trouver une forme d’attention à la Camargue : marcher, parler avec les personnes qui l’habitent et qui la connaissent, m’exposer au vent, observer les animaux, cuisiner son riz, glaner ses histoires. Mais aussi garder consciencieusement une place pour l’inconnu, pour l’impensable, pour les présences par lesquelles les lieux viennent à nous. J’ai préféré envisager la Camargue comme un pays plutôt que comme un paysage. Ne pas succomber à l’étendue que l’image est venue assimiler à un décor. Cette manière de faire m’a permis d’explorer le delta dans ses épaisseurs, et de ne pas le voir à partir de ma personne posée comme centre face à l’horizon. Par son absence de monumentalité, cet espace possède la puissance de mouvoir quelque chose en nous. Songeant aux efforts phénoménaux des hommes pour comprendre un territoire et le rendre fécond et accessible, je prends conscience que mon désir d’aller en Camargue relève d’une forme d’attrait pour la part d’ombre de notre personne. Comme s’il y avait une expérience du bonheur particulière en des lieux où l’homme a conclu un pacte entre ses besoins et ses rêves et des éléments qu’il ne contrôlera jamais pleinement : l’ombre contenue dans les terres. Et c’est peut-être ce que nous regardons quand nous sommes songeurs devant le paysage : loin de nous séparer de lui, nous nous ouvrons. » Suzanne Hetzel
- Année•s : 2013-2016
- Commune•s : Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Suzanne Hetzel / SAIF
Documentation :
Suzanne Hetzel_7 saisons en Camargue_Annexes_Inventaire (pdf)Suzanne Hetzel
« Je suis née en 1961 – 30 ans après Bernd Becher et 384 ans après Peter Paul Rubens – à Siegen en Westphalie. Les arts plastiques sont le plus important pilier de ma scolarité, que je décide de poursuivre par des études aux Beaux-Arts de Marseille. J’en sors en 1990 avec un DNSEP en arts visuels et un post-diplôme. La photographie devient mon médium privilégié pour des raisons de diffusion-circulation, de pratiques diversifiées et pour son ancrage dans une réalité immédiate. De projet en projet, j’explore notre façon d’habiter un lieu ou un territoire et les marques que celui-ci laisse en nous. Des documents et des objets sont apparus dans mes installations dès 2007. Aujourd’hui, pour réaliser une exposition, je compose avec les photographies (je vois mon fonds photographique comme un ensemble), les objets et l’architecture du lieu. L’écriture va de pair avec mon travail de photographie. J’apprécie sa capacité de transcrire la vitalité des conversations et des impressions, et de laisser une plus large place à la mémoire des personnes que je rencontre. Fréquemment, un livre-projet clôt un projet. » Suzanne Hetzel
Atlas Métropolitain — Buti / Dubail / Laurent
Lotissements
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2015
- Commune•s : Aix-en-Provence, Calas, Istres, Marignane, Plan-de-Campagne, Vitrolles
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Buti / Dubail / Laurent
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Stéphanie Lacombe
Notre-Dame des Marins
À propos de la série
Stéphanie Lacombe nous emmène dans l’intimité familiale des habitants de Notre-Dame des Marins, une cité HLM, construite tout en béton dans les années 1970 en périphérie de Martigues, mais néanmoins bien située au milieu de la nature et surplombant la ville telle un oppidum. L’architecte de l’époque s’étant inspiré de la Cité Radieuse du Corbusier, il se dit que c’est une réplique ratée. Les appartements sont identiques d’un étage à l’autre, d’une porte à l’autre. Mais les habitants n’ont pas la même histoire. La photographe a placé son appareil photo au même endroit dans chaque appartement. Ainsi photographiés, les appartements de par leur aménagement, révèlent l’identité des habitants.
- Année•s : 2013
- Commune•s : Martigues
- Commanditaire•s : Bouches-du-Rhône Tourisme
- © Stéphanie Lacombe / SAIF
Stéphanie Lacombe
Stéphanie Lacombe est née en 1976 à Figeac, dans le Lot. Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris (ENSAD). Ses travaux documentaires sont exposés en France, en Argentine, en Finlande, à Hong Kong et ont été publiés par de nombreux magazines et quotidiens, parmi lesquels la Revue XXI, l’Obs, Courrier International, Le Monde. Elle transmet son expérience de femme photographe à l’occasion de workshops menés auprès d’institutions publiques et privées : la Fondation Cartier, les Ateliers du Carrousel, le pôle photographique Diaphane, La maison Robert Doisneau, les Rencontres d’Arles. Elle est lauréate du Prix l’Obs (2020), de la Fondation Lagardère (2006), et a reçu le Grand Prix de la photographie documentaire et sociale de Sarcelles (2008), ainsi que le Prix Niepce (2009). En 2001, Sebastião Salgado lui remettait le prix spécial du jury Agfa.
Julien Marchand
From the wasteland
À propos de la série
« Travail personnel, poursuivi sur la même zone pendant plusieurs années. Je me suis intéressé aux marges de la route départementale D3 que j’ai commencé à prendre lorsque mes parents ont déménagé près de Rians. Depuis, à chaque voyage pour les voir, je photographie l’évolution des marges d’un tronçon de route. L’idée est de creuser par l’image une partie de ce paysage laissé à l’abandon. Les ruines côtoient les véhicules abandonnés, il y règne une ambiance d’enquête très particulière que seul Giono a su mettre en avant. C’est un territoire ambigu, sensible et dérangeant de par son immobilité. » Julien Marchand
- Année•s : 2015-2019
- Commune•s : Ginasservis, La Verdière, Rians, Saint-Julien-le-Montagnier, Saint-Paul-lès-Durance, Vinon-sur-Verdon
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Julien Marchand
Julien Marchand
Né en 1980, vit et travaille à Marseille.
Jacques Filiu
Marseille précisement
À propos de la série
« Vers les années 2008-2009, j’ai pris conscience tout d’abord de la possibilité de témoigner, avec un point de vue (harmonie des images, composition, colorimétrie), de la manière le plus neutre possible de la vie quotidienne, banale, de la ville et de ses habitants. Sachant que ce témoignage ne pourra qu’être partiel et subjectif car lié aux contraintes matérielles. J’ai également vu la possibilité d’ouvrir mes images à l’imaginaire des regardeurs, en recherchant des personnages en relation avec les décors les entourant (attitude des silhouettes, ambiance des décors). Au cours des années, j’essaye d’élargir le champ de mes promenades à l’ensemble de la ville, de trouver un point d’équilibre entre la photo de reportage et la photo plus poétique. Je voudrais arriver à faire sentir les différences d’ambiance entre grands quartiers de la ville. »
Jacques Filiu
- Année•s : 2008-2020
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Jacques Filiu
Documentation :
Jacques Filiu_Marseille précisément_Annexes_Inventaire (pdf)Jacques Filiu
Né à Alger en 1947, Jacques Filiu réside à Marseille depuis 1961. Il mène sa vie professionnelle dans les métiers de l’assurance, tandis qu’il pratique la photographie en amateur. En 1999, il adhère à l’association Phocal. Suite à trois stages photo à Arles entre 2003 et 2005, avec Jérôme Brezillon, Lise Sarfati et Jean-Christophe Béchet, il rencontre Bernard Plossu en 2008. Après l’arrêt de son activité professionnelle en 2009, il profite de son temps libre pour parcourir Marseille et créer un témoignage sur sa vie de tous les jours. En 2013, il a été commissaire de l’exposition collective « Marseille en scènes, 29 regards, 29 histoires » (coproduction avec l’association Phocal et Marseille Provence 2013). Actuellement, il poursuit l’exploration de cette ville.
Christophe Galatry
Objets, répertoires et signes : Fos et Vitrolles
À propos de la série
Série construite à partir d’éléments photographiques tirés de différents moments d’investigations de paysages dans la Métropole marseillaise. Ces éléments représentent des prélèvements de matières de différents sols plus ou moins impactés.
- Année•s : 2013
- Commune•s : Fos-sur-Mer, Plateau de l'Arbois, Vitrolles
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Christophe Galatry / ADAGP Paris, 2020
Christophe Galatry
« Une approche sur la représentation photographique de territoires et la notion de paysages dans et autour de Marseille. Cette interprétation couvre différents spectres d’échelles, du plus intime et microscopique des points de vues au plus large et partagé par le plus grand nombre comme la représentation d’images satellites. A travers des lieux parfois très localisés, je questionne l’image photographique dans différentes situations spatiales, les matières et objets composants ces espaces ainsi que le statut de ceux-ci et leur forclusion par des barrières visuelles : le délaissé, l’oublie, l’abandon, mais aussi contraintes : oubli/révélation, semblable/différent, passage/infranchissement. » Christophe Galatry
Michel Peraldi
Les temps de Berre
À propos de la série
Il y a longtemps… L’objectif était un inventaire ethnographique et photographique des rives de l’Etang de Berre, parcouru, à pied, pendant une année. Ce parcours était assorti de rencontres et d’entretiens avec des pratiquants « discrets » (sportifs, promeneurs, chasseurs, pêcheurs clandestins, etc) et de photographies insistant sur les « grammaires urbaines ». L’intention centrale était de mettre en évidence la logique de production des interstices urbains que mettait en place l’aménagement industriel et urbanistique très brutaliste de cette zone : l’aménagement y était si rapide, si brutal, qu’il dégrammaticalisait l’espace (de loisirs, agricole, artisanal, villageois) en laissant des interstices réappropriées par des pratiquants que les aménagements rendaient toujours plus discrets et illégitimes.
- Année•s : 1985
- Commune•s : Étang de Berre, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Michel Peraldi
Documentation :
Michel Peraldi_Les temps de Berre_Annexes_Inventaire (pdf)Michel Peraldi
Anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, Michel Peraldi travaille depuis de nombreuses années sur les dynamiques sociales, politiques et paysagères, qui forment (et déforment) les espaces métropolitains méditerranéens. Il a souvent associé la photographie à sa démarche anthropologique.
Karine Maussière
Le temps en friches
À propos de la série
« Dans la cadre de Marseille Capitale de la Culture 2013, lors d’une résidence à Istres, j’ai sillonné le GR2013 sur le territoire ouest de la mer de Berre. Avec une attention particulière aux processus d’héritage et de résilience à l’œuvre, j’ai porté un regard sur le patrimoine architectural, en friche, trouvé sur le chemin: usine, bastide, bergerie, aire de loisir… ponctuent ce chemin de grande randonnée. A chaque découverte, un voyage dans le temps s’effectue, l’histoire se réécrit, la mémoire fait acte, la photographie apparaît, l’image reconstruit l’oeuvre architecturale. Utilisant le petit format de l’Instax, l’image instantanée accentue l’aura de ces architectures fantomatiques. Collées en triptyques, les images ainsi construites renforce le déséquilibre des architectures. La déconstruction du cliché s’ajuste au motif de la friche. Les imperfections du procédé corrobore cette idée de disparition. La friche contemporaine questionne notre propre civilisation. » Karine Maussière
- Année•s : 2013-2015
- Commune•s : Étang de Berre, Plateau de l'Arbois
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Karine Maussière / SAIF
Karine Maussière
« Je vis sous le soleil, exactement, au milieu d’un jardin, dans le sud de la France. Née en 1971 d’un père passionné de haute montagne, je me familiarise très tôt à la marche. De cette enfance baladée, il me reste des paysages arpentés, écoutés, contemplés, humés, aimés. Traces durables qui me font aujourd’hui encore m’émerveiller face à la beauté du monde. C’est dans cet élan que je positionne mon esprit dans un mouvement d’ouverture. Les paysages me procurent un sentiment d’être au monde en favorisant une appartenance commune à la terre. Diplômée des Beaux Arts, j’utilise la photographie dans ma relation au monde tout en interrogeant ma place dans la pensée écologique à l’ère de l’anthropocène. « Ensemble, nous décidons que la Terre est un seul et petit jardin. » Cette proposition de Gilles Clément, initiateur du jardin planétaire, bouleverse la réflexion sur l’homme et son environnement. La Terre est, comme le jardin, un espace clos, fini et arpentable que l’Homme doit ménager. A partir de ces idées, je choisis de mettre le paysage au coeur de mes préoccupations et décide de développer des axes de recherches sur les paysages. Paysages à la nature changeante mais aux qualités esthétiques indéniables, le paysage devient sujet d’étude et de représentation. La quête de son appropriation habite ma recherche artistique. Cette appropriation se fait par l’image et par le mouvement du corps. Depuis, la notion du mouvement est comme un leitmotiv. » Karine Maussière
Naïma Lecomte
Au bout de la route
À propos de la série
Dans les zones naturelles de Port-Saint-Louis-du-Rhône, situées entre la Camargue sauvage et la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, se trouve une centaine de cabanons. À l’origine, ces cabanons ont été construits pour assurer la sécurité des marins, mais à la fin du XIXe siècle, ils ont évolué pour devenir des espaces de stockage et de rangement. Au début du XXe siècle, ils ont acquis une nouvelle fonction et se sont agrandis pour se transformer en lieux de villégiature.
Nichés entre terre et mer, les cabanons ont évolué en fonction des changements du cours du Rhône. Aujourd’hui, cette centaine de cabanons est dispersée dans les marais du delta. Ils témoignent d’une approche architecturale en harmonie avec leur environnement, leurs utilisateurs et leur communauté. Symboles d’une population ouvrière, les cabanons de la Camargue tendent malheureusement à disparaître. Leur situation fragile et leur interaction avec l’environnement en font des vestiges d’un mode de vie qu’il est encore possible de documenter, mais qu’il est peut-être important de sauvegarder.
- Année•s : 2019-2021
- Commune•s : Port-Saint-Louis-du-Rhône, Salin-de-Giraud
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Naïma Lecomte / ADAGP, Paris
Documentation :
LECOMTE_documentation (pdf)Naïma Lecomte
Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 2021, Naïma Lecomte est une photographe française née en 1996. Son travail explore les relations complexes entre l’être humain et le territoire. Sa pratique photographique est motivée par le désir de découvrir, de comprendre et de partager différentes perspectives de vie.
Son projet le plus récent, intitulé Au bout de la route, est un projet photographique mené sur le long cours (2019-2022) à partir duquel elle a documenté, au rythme des saisons, les centaines de cabanons situés à l’embouchure du Rhône. Actuellement, elle travaille sur un nouveau projet intitulé Au loin, les faucons, où elle documente le quotidien de sept jeunes placés par l’Aide Sociale à l’Enfance à la Bergerie de Faucon.
Olivier Monge
Marseille, topologie d’un péril imminent
À propos de la série
« Après l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne le 5 novembre 2018 à Marseille, il m’a semblé nécessaire de me pencher, à froid, sur l’état du parc immobilier de la ville afin de comprendre les mécanismes qui ont menés à cette catastrophe, en décrire aussi l’impact humain. L’idée principale est de produire une mémoire, un état des lieux, un témoignage durable, une démarche artistique et patrimoniale exploitable et analysable dans le temps. La liste des arrêtés de péril imminent délivrés par la mairie m’a servi de base pour construire un inventaire des bâtiments évacués qui constitue un corpus de plus de 200 immeubles et 2100 personnes déplacées à ce jour. C’est aussi le portrait d’une ville abîmée, pas seulement autour de la rue d’Aubagne. Ce corpus est un patrimoine bâtit remarquable dans le sens où il est la résultante de l’histoire politique et sociale de la ville de Marseille. Ainsi cet ensemble de bâtiments est traité à la manière d’un cyanotype altéré faisant ainsi écho à un patrimoine ancien et dégradé. Le point de départ de ce projet est encré dans l’histoire de la photographie. En 1851, la Commission aux Monuments Historiques commande à cinq photographes une série d’images documentant les bâtiments endommagés par la révolution française, c’est la Mission Héliographique. Le but est alors de produire des dossiers documentaires visant à la restauration de ces bâtiments. La photographie servant à la fois de preuve et de document fait l’inventaire des biens à restaurer. De la même manière, ma collection d’immeubles et de personnes constitue un corpus sujet à la restauration. Cette démarche utilise deux caractéristiques apparues dès la naissance de la photographie, une croyance et un fait, la preuve et la mémoire. » Olivier Monge
- Année•s : 2018-2019
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Olivier Monge
Olivier Monge
« Membre de l’agence MYOP, directeur Artistique de Fermé Le Lundi, mon travail s’articule autour de la notion de territoire, de patrimoine et de mémoire. Mon médium, la photographie, me permet de mettre en perspective les lieux et leur histoire au travers d’enjeux contemporains. Je parcours et enregistre des espaces géographiques où mon regard s’exprime en s’appuyant toujours au préalable sur des recherches, des études sur l’histoire, l’architecture ou la sociologie. J’ai besoin de comprendre avant de ressentir et retranscrire. Ensuite vient le temps de « l’expérience du paysage », celui de « l’investissement physique », puis enfin arrive le temps de la prise de vue. Je ne cherche pas un instant décisif, je travaille dans une durée déterminante. Celle du temps de pose, qui efface l’anecdote et scénarise le propos abordé : la fabrique réelle et imaginaire d’un lieu. Je ressens ainsi le besoin de collectionner, de décrypter et de décrire les lieux. Je témoigne également dans un souci de pérennité et je forme patiemment l’inventaire de mon regard. » Olivier Monge
Suzanne Hetzel
J’aime ce que je vois
À propos de la série
« Ce travail fait suite à une proposition du MuCEM, il a été accompagné par le Centre Social de Frais Vallon. Pour la composition montrée lors de l’exposition « J’aime les panorama », nous nous sommes basés sur les images réalisées il y a 23 ans, que nous avons souhaité ré-activer avec un groupe de six jeunes personnes habitant à Frais Vallon. Chaque participant de l’atelier, qui a duré sept mois, a photographié la cité selon ses connaissances intimes, ses souvenirs d’enfance ou des points de vue à partager avec le futur visiteur de musée. Aux vues larges du panorama de jadis s’ajoutent des vues serrées de détails et des intérieurs sont inclus dans la notion de panorama. Pour souligner que la notion de regard prend la place du point de vue, nous avons opté pour le format carré. Chaque image carrée vient tel un drapeau sur les images longues. » Suzanne Hetzel
Photographies : Suzanne Hetzel et Ouly Soumare, Kévin Abou Halid, Fally N’Diaye, Sabri Zouaghi, Camélia Traïkia, Abou Mroimana
Porté par le Centre Social de Frais Vallon, Marseille. Avec le soutien du MuCEM, Marseille.
- Année•s : 1992-2015
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Suzanne Hetzel / SAIF
Documentation :
Suzanne Hetzel_J’aime ce que je vois_Annexes_Inventaire (pdf)Suzanne Hetzel
« Je suis née en 1961 – 30 ans après Bernd Becher et 384 ans après Peter Paul Rubens – à Siegen en Westphalie. Les arts plastiques sont le plus important pilier de ma scolarité, que je décide de poursuivre par des études aux Beaux-Arts de Marseille. J’en sors en 1990 avec un DNSEP en arts visuels et un post-diplôme. La photographie devient mon médium privilégié pour des raisons de diffusion-circulation, de pratiques diversifiées et pour son ancrage dans une réalité immédiate. De projet en projet, j’explore notre façon d’habiter un lieu ou un territoire et les marques que celui-ci laisse en nous. Des documents et des objets sont apparus dans mes installations dès 2007. Aujourd’hui, pour réaliser une exposition, je compose avec les photographies (je vois mon fonds photographique comme un ensemble), les objets et l’architecture du lieu. L’écriture va de pair avec mon travail de photographie. J’apprécie sa capacité de transcrire la vitalité des conversations et des impressions, et de laisser une plus large place à la mémoire des personnes que je rencontre. Fréquemment, un livre-projet clôt un projet. » Suzanne Hetzel
Valérie Jouve
Marseille, ville en Résistance
À propos de la série
Plutôt que de « Modèles », Valérie Jouve parle de « Personnages » car il s’agit d’acteurs/actrices qui incarnent une idée. Les actions des corps questionnent les lieux, l’espace et portent le désir de faire dialoguer physiquement les corps avec les bâtiments. Les « Personnages » ne sont jamais montrés comme une galerie de portraits car ces images se travaillent dans le montage et les espaces d’exposition, avec celles des Façades, Paysages, Arbres et autres figures qui font notre monde des hommes.
Certaines photographies ont été réalisées à Marseille et sont présentes sur ce site. Marseille, pensée en tant que ville qui résiste, a aidé à la création de ce travail en ce qu’elle est une vraie rencontre de terrain.
Pour en savoir plus, visionner l’entrevue avec Pascal Beausse.
- Année•s : 1992-2009
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Valérie JOUVE / ADAGP Paris, 2020
Valérie Jouve
Pour Valérie Jouve, la question du traitement de l’espace est au cœur du sujet : il s’agit de comprendre comment la figure, humaine ou autre, confère une présence à ce qui l’entoure et de ce fait vient influencer le lieu. Ces dernières années Valérie Jouve aime à voir des villes ou des villages nourris de multitude d’éléments du vivant. Après un travail exclusivement sur les villes, elle travaille depuis cinq ans entre la ville et la campagne pour questionner ces liens qui les nourrissent mutuellement. Comment ré-inventer leurs relations ? En effet, si la dimension utopique existe dans ce travail, la photographie peut nourrir nos imaginaires d’autres possibles. En exemple, on peut retrouver le travail de reconstruction d’un imaginaire de la Palestine qu’elle a mené́ en dehors de son conflit avec son voisin israélien.
En lien et parallèlement à son activité́ artistique, elle enseigne à l’École National d’Art Supérieure de Paris. Elle a collaboré avec des architectes sur différentes commandes photographiques concernant l’architecture et la ville. Depuis 2017, elle collabore au sein d’un laboratoire de recherche en anthropologie urbaine, le LAA, LAVUE (UMR 7218 CNRS).
Ses expositions sont souvent conçues comme des compositions visuelles, le temps d’un lieu. Les images sont construites indépendamment pour être utilisées dans les montages lors des différentes expositions. Comme ce fut le cas dans sa dernière exposition rétrospective au Jeu de Paume en 2015.
Elle commence une pratique cinématographique dès 2001 avec le film « Grand Littoral », et poursuit une pratique mêlant photographie et séquences filmées depuis ce jour, considérant que ces deux outils d’enregistrement pouvaient travailler ensemble plutôt que de se tourner le dos.
Christophe Galatry
Euroméditerranée
À propos de la série
Un inventaire des chantiers en cours dans la zone Euroméditerranée entre janvier 2006 et décembre 2007. Chaque chantier était photographié une à deux fois de suite suivant un calendrier répartit sur chacun des 12 mois de l’année. Chaque un à deux tirages étaient réalisé.
- Année•s : 2006-2007
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée
- © Christophe Galatry / ADAGP Paris, 2020
Documentation :
Christophe Galatry_Euroméditérrannée_Annexes_Inventaire (pdf)Christophe Galatry
« Une approche sur la représentation photographique de territoires et la notion de paysages dans et autour de Marseille. Cette interprétation couvre différents spectres d’échelles, du plus intime et microscopique des points de vues au plus large et partagé par le plus grand nombre comme la représentation d’images satellites. A travers des lieux parfois très localisés, je questionne l’image photographique dans différentes situations spatiales, les matières et objets composants ces espaces ainsi que le statut de ceux-ci et leur forclusion par des barrières visuelles : le délaissé, l’oublie, l’abandon, mais aussi contraintes : oubli/révélation, semblable/différent, passage/infranchissement. » Christophe Galatry
Geoffroy Mathieu
Marseille, ville sauvage
À propos de la série
« Ici, on ne sait jamais trop où s’arrête la ville et où commence la nature. A la fois industrielle et rurale, en friche et bétonnée, Marseille est un laboratoire à ciel ouvert où se réinvente la relation entre ville et nature, entre sauvage et civilisé, entre nord et sud. Le génie de la ville bouscule et interroge l’écologie urbaine – ce champ de recherche émergent qui, entre écologie et sociologie, propose de nouveaux modèles pour les villes de demain. Lorsque s’écroulent les modèles dominants, c’est souvent à la marge qu’on voit se dessiner l’avenir. » Baptiste Lanaspeze
- Année•s : 2007-2010
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Actes Sud
- © Geoffroy Mathieu
Documentation :
Geoffroy Mathieu_Ville sauvage_Annexes_Inventaire (pdf)Geoffroy Mathieu
Geoffroy Mathieu, né en 1972, diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, vit et travaille à Marseille. Ses travaux travaux interrogent la manière dont certaines questions écologiques ou politiques se concrétisent dans le paysage. À travers des protocoles de parcours, il documente les territoires en mutation, les frottements ville-nature ou les « résistances poétiques » dans les usages des lieux.
Sébastien Normand
Périgée au Frioul
À propos de la série
« Lunaire », l’adjectif qui est le plus fréquemment utilisé pour qualifier le « paysage » des îles du Frioul, est le point de départ d’un travail sur la représentation de ce territoire insulaire. Le dispositif est simple il s’agit de photographier la nuit en utilisant la lumière de la pleine lune. Cela implique de faire l’expérience nocturne de ce paysage minéral situé au large de Marseille. Une nuit de temps de pose, l’éclairage ponctuel de la lune balayant les roches, produisent des images que seul l’appareil photographique peut donner à voir. Ces « images invisibles » révélées par la photographie sont striées des faisceaux lumineux des activités humaines. C’est la confrontation aujourd’hui des temps géologiques avec un moment photographique, sur un territoire qui concentre les traces de trois siècles d’histoire. Monochromatiques, contemplatives, à une extrémité du procédé d’enregistrement photo-mécanique, ces photographies interrogent notre présence à notre monde contemporain.
- Année•s : 2012-2016
- Commune•s : Frioul
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Sébastien Normand
Documentation :
Sébastien Normand_Périgée au Frioul_Annexes_Inventaire (pdf)Sébastien Normand
Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure Louis Lumière en photographie, où il initie une démarche personnelle qui interroge les espaces, les territoires et leurs usages. Ses recherches explorent les rapports qu’entretiennent les objets de la banalité et les personnes avec les lieux dans lesquels ils s’inscrivent. La pluralité des dispositifs plastiques qu’il met en place, lui permet de garder un regard critique sur ses sujets.Jouant d’allers retours entre l’histoire du médium et ses pratiques actuelles, les protocoles de prises de vue développés s’attachent, avec une dimension performative, à faire apparaître des images que seul l’outil photographique peut donner à voir. En 2004 lors d’une résidence à Niort, il part à la redécouverte des paysages de sa prime enfance avec la série « Des courbes de choses invisibles ». En 2005, grâce au soutien de la Fondation de France, il réalise « Un Trajecto Iberico », portraits et paysages, sur les autoroutes espagnoles, de la communauté d’origine marocaine sur le trajet de leurs vacances vers le Maroc. En 2008 durant sa résidence au 104 avec Peau proche du bâtiment, il questionne le rôle politique de l’absence de mobilier urbain dans les choix d’aménagement d’un quartier parisien dit « sensible ». En 2015 il achève un travail sur les îles du Frioul : « Périgée au Frioul ». Durant quatre ans, les nuits de pleine lune il part lourdement chargé de sa chambre 20*25 pour représenter avec l’éclairage lunaire ce territoire insulaire protégé. Il s’agit également de vivre l’expérience nocturne de ces paysages situés au «large» de Marseille, en produisant des images que seul le support photographique peut donner à voir. Depuis trois ans il travail sur un projet dans le massif pyrénéen. Il s’agit d’interroger les modalités de représentation d’un territoire de montagne en confrontant et en mixant des typologies iconographiques et photographiques variées. En explorant l’aménagement du territoire dans ses aspects historique et contemporain, les mythes constitutifs… Les travaux de commandes de Sébastien Normand documentent les réalisations d’artistes, de plasticiens, de créateurs, de chorégraphes qui questionnent la place du corps dans l’espace physique, social et politique, de collectifs d’architectes qui interrogent et expérimentent l’acte de construire et d’habiter.
Iris Winckler
Sud II
À propos de la série
« Je me suis installée à Marseille en 2017. J’ai depuis continué à photographier la ville, et mon regard sur celle-ci a évolué en même temps que ma familiarité avec les lieux. Si je photographie à peu près toujours les mêmes choses, la lumière, elle, n’est plus la même. J’ai photographié essentiellement à la tombée du jour, quand le doré du soir semble enluminer la ville et la couvrir d’un voile de crasse noire en même temps. » Iris Winckler
- Année•s : 2017-2020
- Commune•s : Fos-sur-Mer, Frioul, L'Estaque, Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Iris Winckler
Iris Winckler
« Née en 1990, je vis et travaille entre Marseille et Paris. Je suis diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg en graphisme, ainsi que de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles. Depuis 2017, je partage mon activité entre ma pratique personnelle, la photographie d’architecture et autres commandes. En parallèle, j’ai travaillé en tant que guide pour les Rencontres d’Arles ou encore l’exposition « Picasso, voyages imaginaire » (Vieille Charité/Mucem), et comme commissaire de trois expositions de photographie à Avignon, Arles puis Marseille pour le compte de la Région PACA. » Iris Winckler
Christophe Negrel
Au cœur des dockers
À propos de la série
Christophe Negrel, photographe autodidacte, s’est armé de son appareil argentique pour s’attaquer au monde fermé des dockers. « C’est une histoire de famille, rappelle-t-il, où se mélangent les différences de culture, de religion, de milieu social. » Docker lui-même, Christophe Negrel est bien placé pour s’immiscer dans le quotidien de ses collègues à qui il fait oublier sa présence. « J’essaie, à travers ces photos, d’avoir une vision intérieure du travail dans cet univers des docks et de la relation qu’entretiennent ces hommes entre eux. Face aux chaînes, face aux machines qu’ils semblent défier comme on affronte les éléments. Leur élément. »
- Année•s : 2007
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Christophe Negrel
Christophe Negrel
Photographe de l’instant, Christophe Negrel parvient à capturer ces images, les expressions et les émotions qui s’en dégagent. Son parcours dans le sport de haut niveau lui permet d’avoir un regard différent sur le monde. Ses tumultes, ses voyages ainsi que ses rencontres lui ont permis de transcender le quotidien et ses soucis. Le cœur sur la main, l’âme apaisée, il ne cesse d’évoluer dans une œuvre qui se veut toujours plus riche.
Éric Bourret
No Limit
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2017-2020
- Commune•s : Méditerranée
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Éric Bourret
Éric Bourret
Né en 1964 à Paris, Éric Bourret vit et travaille dans le Sud de la France et en Himalaya. Son oeuvre d’« artiste marcheur », s’inscrit dans la lignée des Land Artists anglais et des photographes-arpenteurs de paysages. Depuis le début des années 1990, Il parcourt le monde à pied, traversant tout horizon à toute altitude, effectuant des prises de vues photographiques qu’il nomme « expérience de la marche, expérience du visible ». Dans ces images, Éric Bourret exprime les transformations sensorielles et physiques profondes que provoque la marche. L’expérience du trajet parcouru exacerbe la perception et la réceptivité au paysage. Au cours de ses marches, de quelques jours à plusieurs mois, selon un protocole conceptuel précis qui détermine le nombre et les espacements des prises de vue, l’artiste superpose différentes vues du même paysage sur un seul négatif. Ces séquences intensifient et accélèrent l’imperceptible mouvement des strates géologiques et fige l’éphémère temporalité de l’homme. L’accident, l’imprévu sont assumés dans ce concept de saisies photographiques aléatoires. Elles témoignent d’une expérience subjective, ainsi qu’il le confie lui-même : « Je suis constitué des paysages que je traverse et qui me traversent. Pour moi, l’image photographique est un réceptacle de formes, d’énergie et de sens. » Cet éphéméride photographique désintègre la structure de l’image initiale et crée une autre réalité mouvante, sensible. L’image, née de ce « feuilleté temporel », est vibrante, oscillante, presque animée. Des séries plus factuelles insèrent date, lieu, durée, distance parcourue et transmettent ainsi le rythme et l’espace de ce carnet de marche. Depuis 1990, son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et acquisitions dans les musées et Centres d’art, en Europe, aux États-Unis et en Afrique, notamment the Finnish Museum of Photography à Helsinki ; the Museum of Contemporary Art of Tamaulipas au Mexique ; le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice ; le Musée Picasso à Antibes ; la Maison Européenne de la Photographie de Paris.En 2015-19, il a participé à plusieurs expositions : la 56e Biennale de Venise ; Joburg Contemporary African Art ; AKAA à Paris ; Start à la Saatchi Gallery de Londres ; Shenzhen Art Museum, Chine ; l’Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux ; Sapar Contemporary, New-York ; Xie Zilong Art Museum, Chine.
Brigitte Bauer
Euroméditerranée
À propos de la série
« Une commande publique carte blanche, pour témoigner d’un état intermédiaire dans la ville, pour en saisir les mutations engagées dans un secteur géographique précis, entre le rond-point de la porte d’Aix, la gare Saint-Charles et la zone portuaire. Mon choix s’est porté sur les places emblématiques à l’intérieur de ce périmètre donné, des endroits précis où se conjuguent passé et présent. Des rues et des places animées, afin de souligner la permanence de la vie pendant cette période précaire et fragile entre démolition et renouveau. » Extrait de la note d’intention, Brigitte Bauer.
« De facture plus documentaire que certains travaux antérieurs, cette série semble radicaliser l’apparente neutralité du point de vue. Brigitte Bauer-artiste s’y révèle toutefois à travers des choix qui participent d’une stratégie concertée : le format carré, le cadrage, la distance, la couleur, la luminosité, l’ouverture du diaphragme, tout concourt ici à créer les conditions d’une expérience visuelle qui ne soit pas une échappée dans la profondeur mais une circulation du regard à la surface de l’image. De la sorte, nous sommes invités à détailler, à scruter ce dont une perception in situ nous prive, c’est-à-dire à voir véritablement l’organisation formelle d’un quartier, faite de strates, d’ajouts, d’amputations, de raccords, de sutures, dans ce temps où l’ancien cède du terrain au nouveau. Ce travail photographique sur la métamorphose est elle-même une œuvre de transition. Confrontée à la complexité urbaine, Brigitte Bauer a pour la première fois recours à la forme triptyque. La série introduit l’idée du montage cinématographique, du champ / contre-champ, que l’artiste développera de façon plus explicite dans ses pièces vidéos ultérieures. » Texte de Christophe Berthoud.
- Année•s : 2002-2003
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Direction Générale des Affaires Culturelles de la Ville de Marseille, Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, Ministère de la Culture et de la Communication
- © Brigitte Bauer / Adagp, Paris, 2020
Documentation :
Brigitte Bauer_Euroméditérrannée_Annexes_Inventaire (pdf)Brigitte Bauer
Née en Allemagne (Bavière), Brigitte Bauer vit et travaille à Arles. Après le développement d’une culture du paysage dans ses premières séries de photographies telles que Montagne Sainte-Victoire ou Ronds-Points, ses recherches s’orientent aujourd’hui davantage vers les territoires du quotidien, que ce soit dans l’espace urbain, rural ou familial ou encore à la lisière de son monde professionnel avec Vos Devenirs, un ensemble de portraits de ses anciens étudiants. Parmi ses principales publications, on trouve « Haus Hof Land » (éditions Analogues, 2017), « Aller aux Jardins » (Trans Photographic Press, 2012), « Fragments d’Intimité » (Images en Manœuvres, 2007), « Fugue » (Estuaire 2005), « D’Allemagne » (Images en Manœuvres 2003), « Montagne Sainte-Victoire » (Images en Manœuvres, 1999) et, plus récemment, les auto-éditions « Seoul Flowers and Trees, tribute to Lee Friedlander », 2018 et « akaBB – tribute to Roni Horn », 2019. Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’international et sont présentes dans des collections publiques et privées telles que le Fonds National d’Art Contemporain, la Bibliothèque Nationale de France, la Deutsche Bank, l’Union des Banques Suisses, le musée Carnavalet, le Centre de Photographie de l’Université de Salamanca…. Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 1990 et de l’Université Aix-Marseille en 1995, Brigitte Bauer enseigne la photographie à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes.
Gabriele Basilico
Fos
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 1996
- Commune•s : Fos-sur-Mer
- Commanditaire•s : Ville de Fos-sur-mer
- © Gabriele Basilico / Archivio Gabriele Basilico
Documentation :
Gabriele Basilico_Annexes_Inventaire (pdf)Gabriele Basilico
Gabriele Basilico est né en 1944 à Milan en Italie, où il mourut en 2013.
Au début des années 1970, après avoir fini ses études à la faculté d’architecture, il commence à photographier le paysage urbain. Son premier projet « Milano. Rittratte di fabbriche » (1978-1980) montrait les zones industrielles milanaises. En 1984, il participe à l’immense projet de la mission photographique de la DATAR, financé par le gouvernement français, dont l’objet est de photographier le paysage français contemporain. En 1991, avec un groupe de photographes internationaux, il participe à la mission ayant pour but de photographier la ville de Beyrouth à la fin de la guerre.
Depuis lors, Gabriele Basilico a exécuté de nombreux projets en solo ou en groupe dans différentes villes du monde (par exemple en 1996, il a travaillé à Fos-sur-Mer). Les transformations du paysage contemporain, la forme et l’identité des villes et métropoles, demeurèrent les domaines clés de la recherche de Gabriele Basilico.
Son œuvre a été publiée dans de nombreuses expositions, livres et catalogues. Les derniers projets photographiques qu’il ait réalisés sont : « Silicon Valley » commandé par le MOMA de San Francisco, « Roma 2007 », Moscou Vertical » une étude photographique du paysage urbain de Moscou par des clichés pris du haut des sept gratte-ciels de Staline en 2008, « Istanbul 05.010 », « Shanghai » 2010, « Beyrouth » 2011, « Rio de Janeiro » 2011.
Atlas Métropolitain — Gabreau / Mocrette
Polarités
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2011
- Commune•s : Aix-en-Provence, Ensuès-la-Redonne, Fos-sur-Mer, Marignane, Miramas, Pennes-Mirabeau, Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Gabreau / Mocrette
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Patrick Rimond
Hudros, d’eau et de béton
À propos de la série
La série Hudros, d’eau et de béton est un travail photographique réalisé dans les Bouches-du-Rhône, mettant en scène des surfaces d’eau contraintes par l’homme. Mon attention a été attirée par la rencontre insolite entre l’eau et le béton. Les images ont été principalement prises le long des canaux et des retenues d’eau qui alimentent la région, en particulier le canal de Marseille.
Hudros est né d’une fascination pour l’opposition entre l’aspect cristallin de l’eau en mouvement et la rudesse d’un béton brut et inerte. D’un côté, il y a la vie, avec la fraîcheur de l’eau en mouvement perpétuel, et de l’autre, l’inanimé, avec un béton statique altéré par le temps. Ces éléments sont interdépendants pour assurer le bon fonctionnement d’un ensemble, illustrant ainsi la dualité du yin et du yang.
Ce qui a également retenu mon attention, c’est l’accès physique à ce flux précieux qui s’écoule sur des centaines de kilomètres sans contrainte ni surveillance. Cela distille un étrange sentiment de liberté dans une société où le contrôle est devenu la norme.
J’envisage le paysage de manière directe et subjective. Les photographies captent l’existence sans mise en scène ni utilisation de procédés pictorialistes. C’est la relation ou la distance entre moi et ce paysage que j’éprouve. Je me projette sur la partie du paysage que j’ai choisie et je cadre pour rechercher une sensation d’harmonie. Je la trouve dans l’équilibre de la composition. Mon regard sur le lieu est tout d’abord abstrait, à la manière de l’approche de Toshio Shibata sur les ouvrages en béton au Japon. J’y vois un ensemble de formes, de couleurs, de matières, d’ombres et de lumières que j’agence. Je pars à la rencontre du monde avec la volonté de révéler l’ordinaire, en pleine conscience.
- Année•s : 2010-2014
- Commune•s : Coudoux, Mallemort, Marignane, Marseille, Peyrolles-en-Provence, Ventabren
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Patrick Rimond / SAIF
Documentation :
Rimond_documentation (pdf)Patrick Rimond
Patrick Rimond est un artiste photographe français dont le travail explore différentes formes d’expression et relève toujours d’un désir d’éprouver son rapport au réel. Dans le paysage, il recherche un point d’harmonie entre lui et le monde. Avec le portrait, il tente une rencontre véritable. Le collage numérique l’amène à travailler le réel, essayant d’en extraire sa part invisible.
Sa démarche artistique, sobre et sensible, est également marquée par une quête discrète de spiritualité. Son travail vise à capturer la vibration du monde. En partageant ses images, il propose une manière alternative de regarder le monde, révélant sans jugement l’inaperçu et le banal.
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur à Paris en 1995, Patrick Rimond a passé une année de formation auprès du photographe français Jack Burlot, puis s’est installé au Japon à Osaka pendant neuf ans. En parallèle de commandes pour des agences et des journaux, il a développé un premier ensemble de paysages urbains et de portraits.
De retour en Europe en 2006, il a ouvert sa pratique artistique à des collaborations avec d’autres artistes et s’est intéressé aux techniques de post-photographie. Il a participé à la création de deux projets d’espaces artistiques collectifs et a coorganisé le festival des nouvelles pratiques photographiques, la Biennale de l’Image Tangible. En 2020, il a rejoint la résidence Organoïde, Art et Sciences, initiée par Fabrice Hyber à l’Institut Pasteur.
En 2021, en collaboration avec l’artiste graveuse Jolanta Anton, il a ouvert une galerie-atelier à Auxerre, intitulée L’Escalier.
Jean-Christophe Béchet
Port-de-Bouc : la mémoire et la mer
À propos de la série
« Pendant des années, j’ai pris l’autoroute du Littoral, de Marseille à Arles. J’apercevrai furtivement le nom de « Port de Bouc » ; ce drôle de nom avait retenu mon attention, mais je ne m’étais jamais arrêté. Quand pour le 150ème anniversaire de la cité, le Centre des Arts Plastiques Fernand Léger m’a proposé de photographier la ville, j’ai aussitôt aussitôt accepté et quinze jours plus tard, je m’engageai dans l’avenue Maurice Thorez, direction le Centre-Ville. Je crois beaucoup aux premières impressions, à la pertinence des regards qui passent, car ils voient les flux, les correspondances, les fluidités, autant de signes qui ne sont plus perceptibles à ceux qui résident sur place. Sur place, on m’a pris pour un policier de la BAC ou pour un touriste, moi qui suis né à quarante kilomètres de là… Rapidement je décrypte certains indices, tels ces noms qui rappellent le passé (et le présent) communiste de la ville : Maurice Thorez, Gagarine, Elsa Triolet, Max Dormoy, Rol Tanguy… autant de fantômes d’un passé qui marque l’identité des lieux. L’architecture est tout aussi signifiante, avec ce mélange de « vieille » modernité héritée des « années 70 ». Je suis venu à la fin de l’hiver, le soleil est là, le mistral dégage les nuages. Les rues sont calmes, souvent désertes. On est loin d’un Sud où chacun discute sur le pas de sa porte avec son voisin. Port-de-Bouc est assoupi, comme engourdi sous une lumière dure et contrastée. Ici, tout est franc, direct, excessif, volubile. Mes photos doivent l’être aussi, avec cette sensation de géométrie, de vide et d’ennui qui va vite m’assaillir. Heureusement, il y a la mer et une corniche étonnante qui donne une vraie personnalité à la cité. Comme le dit l’Office du Tourisme, ici, tout est tourné vers la mer. Ce front de mer aussi beau que mélancolique fut mon lieu de pèlerinage quotidien. Du port, je gagne la capitainerie en passant par la Lèque, puis je longe cet impressionnant ensemble d’immeubles des Aigues Douces, avant d’atteindre les petites plages et le centre d’art. Partout des terrains de jeux, des espaces aménagés et cette méditerranée souvent secouée par le vent. Magnifique espace dont on ressort groggy et ébloui… Je pense alors à la chanson de Léo Ferré, la Mémoire et la Mer… Pierre et Amandine m’ont servi de guide dans les rues de Port-de-Bouc. Ils m’ont permis, d’entrer dans la géographie intime des relations personnelles. Selon son caractère, sa famille, sa provenance, sa religion, son métier. Autant de coins et de recoins qui m’ont passionné et que j’ai essayé de traduire avec mes photos. Car je photographie pour comprendre la complexité du monde… Le défi de la photographie urbaine est d’éviter d’illustrer une réalité que chacun connaît, d’éviter le piège du pittoresque ; mais il faut aussi se méfier, à l’inverse, de l’esthétique du misérabilisme. Il s’agit de trouver une voie personnelle où l’esprit documentaire et la sensibilité poétique se rejoignent. Nous sommes tous des voyageurs, et ici, à Port-de-Bouc, j’ai fait une belle escale… » Jean-Christophe Béchet
- Année•s : 2016
- Commune•s : Port-de-Bouc
- Commanditaire•s : Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger
- © Jean-Christophe Béchet / SAIF
Jean-Christophe Béchet
Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet vit et travaille depuis 1990 à Paris. Mêlant noir et blanc et couleur, argentique et numérique, 24×36 et moyen format, polaroids et « accidents » photographiques, Jean-Christophe Béchet cherche pour chaque projet le « bon outil », celui qui lui permettra de faire dialoguer de façon pertinente une interprétation du réel et une matière photographique. Son travail photographique se développe dans deux directions qui se croisent et se répondent en permanence. Ainsi d’un côté son approche du réel le rend proche d’une forme de « documentaire poétique » avec un intérêt permanent pour la « photo de rue » et les architectures urbaines. Il parle alors de ses photographies comme de PAYSAGES HABITÉS. En parallèle, il développe depuis plus de quinze ans, une recherche sur la matière photographique et la spécificité du médium, en argentique comme en numérique. Depuis 20 ans, ce double regard sur le monde se construit livre par livre, l’espace de la page imprimée étant son terrain d’expression « naturel ». Il est ainsi l’auteur de plus de 20 livres monographiques. Ses photographies sont aussi présentes dans plusieurs collections privées et publiques et elles ont été montrées dans plus de soixante expositions, notamment aux Rencontres d’Arles 2006 (série « Politiques Urbaines ») et 2012 (série « Accidents ») et aux Mois de la Photo à Paris, en 2006, 2008 et 2017.
Geoffroy Mathieu, Bertrand Stofleth
Paysages usagés, observatoire photographique du paysage depuis le GR2013
À propos de la série
L’Observatoire Photographique du Paysage (OPP) depuis le GR2013 est un observatoire photographique du paysage créé à l’initiative de Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth.Projet artistique de représentation de la Métropole Aix-Marseille Provence en construction, il documente ses usages, les frottements ville-nature et la grande richesse de ses paysages.Les 100 photographies sont réalisées en 2012 le long des 365 km du GR2013 encore non balisé et intègrent son tracé par un trait blanc parcourant l’image. Chaque année jusqu’en 2022, les artistes re-photographient 30 images et en confient 70 à des adoptants. Ce projet interroge le protocole institutionnel de la démarche des OPP et revisite les principes de sa méthodologie en inversant les rôles du commanditaire et du commandité, en considérant les images comme propositions d’analyse des enjeux territoriaux et paysagers de la métropole, et en intégrant un volet participatif dès la création du projet en invitant les usagers de la métropole à travailler avec les artistes.
- Année•s : 2013
- Commune•s : Aix-en-Provence, Marseille, Métropole Aix-Marseille-Provence
- Commanditaire•s : CNAP, MP2013
- © Geoffroy Mathieu & Bertrand Stofleth
Documentation :
Geffroy Mathieu & Bertrand Stofleth _Annexes_Inventaire (pdf)Geoffroy Mathieu, Bertrand Stofleth
Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth, en parallèle de leur parcours artistique indépendant, travaillent ensemble à des projets de représentation des territoires sous la forme d’observatoire photographique du paysage (OPP). Depuis 2005, ils ont participé à la création de l’OPP du PNR des monts d’Ardèche (2005-2020) de l’OPP de la Communauté de commune de la Vallée de l’Hérault (2010-2013) et du PNR du Verdon (2018-2020). En 2012, de leur propre initiative et grâce au soutien d’une commande publique de photographie du CNAP et de Marseille Provence 13 Capitale Européenne de la culture, ils mettent en place le projet « Paysages usagés, Observatoire photographique du paysage depuis le GR2013 », projet artistique et collaboratif de représentation des paysages de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le projet a participé à la mission FTL (France territoire Liquide) et reçu le soutien du FRAC par le biais d’une acquisition en 2017.
Sylvain Duffard
Marseille, face B
À propos de la série
J’ai réalisé la série « Marseille, face b » à Marseille en avril 2006 dans le cadre d’un Workshop au sein de l’Atelier de Visu / Soraya Amrane. Dans le cadre de ce travail, je porte un regard sur le secteur urbain de la Corniche, espace résidentiel situé en front de mer, « calme et très côté » comme aiment à le vanter les agences immobilières phocéennes. Si Marseille est bien souvent dépeinte comme une « ville mosaïque, métropole multiculturelle, bouillonnante… », c’est à rebours que j’ai souhaité m’attacher à ce secteur urbain privilégié, à sa structure et à ses modes d’habiter.
- Année•s : 2006
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Sylvain Duffard
Sylvain Duffard
Né en 1975, Sylvain Duffard est photographe indépendant. Il vit et travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Diplômé de l’Institut de Géographie Alpine (IGA), Université Joseph Fournier de Grenoble en 1999, c’est en autodidacte que Sylvain Duffard développe sa pratique photographique. Se confrontant à la commande dès 2006, il développe un travail portant sur le paysage quotidien, démarche rapidement sous-tendue par l’émergence de questionnements relatifs à ses modes de fabrication. Il fait ensuite l’expérience de la commande publique dans le cadre de missions photographiques consacrées à l’observation du paysage ; commandes inscrites dans le sillage de missions photographiques historiques telle que celle que la DATAR engagea au début des années 1980. Ces expériences constituent pour lui un espace d’apprentissage privilégié et le lieu d’une expérimentation riche et personnelle du paysage. De 2008 à 2010, il répond à une commande de l’Office National des Forêts ; commande qui donnera naissance à sa série « La forêt habitée ». Il réalisera ensuite successivement les séries chronophotographiques de trois Observatoires photographiques des paysages, à l’échelle du Parc Naturel Régional des Alpilles, puis du département de Haute-Savoie et enfin de l’Archipel Guadeloupe. De 2017 à 2018, l’Atelier des Places du Grand Paris lui confie une commande de paysage relative aux sites jouxtant certaines des futures gares du Grand Paris Express.
Atlas Métropolitain — Durand / Gendre / Llenas / Navarro
Monuments
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2012
- Commune•s : Aix-en-Provence, Berre-L'Étang, Fos-sur-Mer, Gardanne, Marseille, Martigues
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Durand / Gendre / Llenas / Navarro
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Atlas Métropolitain — Bertet / Castelli / Pinard
Archipel de reliefs
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2011
- Commune•s : Allauch, Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, Marseille, Massif de la Sainte-Baume, Montmorin, Saint-Antonin-sur-Bayon, Trets
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Bertet / Castelli / Pinard
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Éric Bourret
Sainte-Victoire, la montagne de cristal
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2013-2015
- Commune•s : Massif de la Sainte-Baume, Montagne Sainte-Victoire, Parc Naturel Régional des Alpilles
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Éric Bourret
Éric Bourret
Né en 1964 à Paris, Éric Bourret vit et travaille dans le Sud de la France et en Himalaya. Son oeuvre d’« artiste marcheur », s’inscrit dans la lignée des Land Artists anglais et des photographes-arpenteurs de paysages. Depuis le début des années 1990, Il parcourt le monde à pied, traversant tout horizon à toute altitude, effectuant des prises de vues photographiques qu’il nomme « expérience de la marche, expérience du visible ». Dans ces images, Éric Bourret exprime les transformations sensorielles et physiques profondes que provoque la marche. L’expérience du trajet parcouru exacerbe la perception et la réceptivité au paysage. Au cours de ses marches, de quelques jours à plusieurs mois, selon un protocole conceptuel précis qui détermine le nombre et les espacements des prises de vue, l’artiste superpose différentes vues du même paysage sur un seul négatif. Ces séquences intensifient et accélèrent l’imperceptible mouvement des strates géologiques et fige l’éphémère temporalité de l’homme. L’accident, l’imprévu sont assumés dans ce concept de saisies photographiques aléatoires. Elles témoignent d’une expérience subjective, ainsi qu’il le confie lui-même : « Je suis constitué des paysages que je traverse et qui me traversent. Pour moi, l’image photographique est un réceptacle de formes, d’énergie et de sens. » Cet éphéméride photographique désintègre la structure de l’image initiale et crée une autre réalité mouvante, sensible. L’image, née de ce « feuilleté temporel », est vibrante, oscillante, presque animée. Des séries plus factuelles insèrent date, lieu, durée, distance parcourue et transmettent ainsi le rythme et l’espace de ce carnet de marche. Depuis 1990, son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et acquisitions dans les musées et Centres d’art, en Europe, aux États-Unis et en Afrique, notamment the Finnish Museum of Photography à Helsinki ; the Museum of Contemporary Art of Tamaulipas au Mexique ; le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice ; le Musée Picasso à Antibes ; la Maison Européenne de la Photographie de Paris.En 2015-19, il a participé à plusieurs expositions : la 56e Biennale de Venise ; Joburg Contemporary African Art ; AKAA à Paris ; Start à la Saatchi Gallery de Londres ; Shenzhen Art Museum, Chine ; l’Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux ; Sapar Contemporary, New-York ; Xie Zilong Art Museum, Chine.
Giacomo Furlanetto
Caravan
À propos de la série
« Invité pendant le printemps 2013 à participer au voyage CARAVAN et marcher sur le GR2013, je me suis retrouvé à faire une collection d’images d’un territoire très riche et multi-couches qui, exploré de l’intérieur, n’arrête pas de se dévoiler. Un projet déroulé à la vitesse de la marche à pied en traversant plus de 350 km. Un speed shooting pour faire un état des lieux et un instantané du paysage au moment du passage. » Giacomo Furlanetto
- Année•s : 2013
- Commune•s : Aix-en-Provence, Marseille, Métropole Aix-Marseille-Provence
- Commanditaire•s : CAUE 13, Le Cercle des Marcheurs
- © Giacomo Furlanetto
Documentation :
Giacomo Furlanetto_Caravan_Annexes_Inventaire (pdf)Giacomo Furlanetto
« J’ai commencé à m’intéresser à la photographie pendant les années 2000 avec une pratique d’autodidacte. J’ai ensuite eu la chance de travailler pendant une decennie dans le milieu de la photo en tant qu’assistant photographe, puis dans la partie production d’une agence, iconographe, éditeur photo, photographe. C’est vers les années 2008-2009,que je commence à m’intéresser à l’esthétique des choses, puis des lieux et de leur composition surtout, à la manière dont l’homme est capable de façonner son environnement. Je considère le paysage en tant que représentation (historique, social, économique, culturelle, naturelle) de l’évolution/cohabitation d’un territoire avec ses habitants. Avec beaucoup de lenteur (beaucoup!), je continue à observer le paysage, les lieux qui m’entourent et que je découvre. De plus, c’est la faute peut être de l’âge, je m’intéresse en parallèle aux lieux, vécus et ensuite quittés, qui m’ont vu en partie grandir. » Giacomo Furlanetto
Fabrice Ney
ZUP n°1
À propos de la série
« Ces photographies ont été réalisées à Marseille dans les quartiers Nord, entre 1981 et 1983. Le titre donné à ce corpus photographique « ZUP n°1 », correspond à la politique urbaine qui avait conduit, à partir du milieu des années soixante, à la construction des cités du Grand Saint Barthélémy dont celles de Picon, La Busserine, Saint Barthélémy III et Font-Vert. Dans la continuité de mes deux travaux précédents, j’ai choisi délibérément de ne pas photographier les habitants: je me concentrais sur l’environnement urbain immédiat et je cherchais en quoi cet environnement pouvait être révélateur des relations sociales qui s’y nouaient. Il s’agissait d’éprouver un outil d’observation dont l’utilisation nécessitait l’expression d’un point de vue en accord avec ce projet documentaire. Une approche radicale et systématique : décadrer l’habitant, c’est le remettre à sa place en tant qu’acteur de ce qui est représenté et non plus en tant qu’objet de représentation. Pour cela, j’ai parcouru ces cités plutôt au lever du jour, sous des lumières souvent grisâtres, effectuant des relevés, des prélèvements, notant des cheminements, interrogeant les lieux et la manière dont ils étaient habités. Les prises de vue ont été réalisées sur le mode de la prise de notes, de la saisie rapide, de la fluidité du regard plus attentif à l’enchaînement de ses impressions qu’à la fabrication d’une image synthétique. Les cadrages ont été le résultat de cette liberté du mouvement guidé par un projet sociologique. Ils se sont ensuite progressivement accordés avec le plan vertical des façades, influencé, sans doute, par la réalisation de la série des 68 portes qui a invité mon regard à se déplacer sur des rythmes graphiquement plus prononcés. Un boîtier petit format, chargé d’une pellicule rapide, a servi d’outil à cette mobilité. J’ai donné à voir les lieux dans le mouvement de leur découverte, en étant sensible à l’organisation des détails. Chacun des éléments, du bâti jusqu’aux traces de passages, possède une importance relative aux autres.Travailler sur des séries est une manière de déborder l’aspect anecdotique de la prise de vue, en évitant de recourir à une composition trop arbitraire et bavarde. Le cadrage implique un « point de vue » physique et narratif. Cadrer au plus proche des liens entre les choses maintient la cohérence du projet et consolide le sentiment d’unité de l’espace et du temps du parcours. Mais cette unité reste toujours une construction. En 1983, la réalisation de « 68 portes » suivait un protocole de prise de vue systématique qui incluait le traitement informatique (Logiciel EURISTA, EHESS) permettant une méthode de classement et de regroupement de la série, dont le propos était de tester un processus d’interprétation des données fournies par les images photographiques. » Présentation extraite de l’ouvrage « ZUP n°1 », Arnaud Bizalion Editeur, 2019
- Année•s : 1980-1983
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Fabrice Ney
Documentation :
Fabrice Ney_Zup n°1_Annexes_Inventaire (pdf)Fabrice Ney
Fabrice Ney est né en 1953, à Bizerte. Ses premiers travaux photographiques datent de la fin des années 1970, associés à ses études universitaires à l’EHESS: « Fos-sur-Mer » (1979), « La Seyne-sur-Mer » (1980-83), « Zup n°1 » (1981-83). Sa recherche se développe ensuite autour de la question de la représentation des lieux et du territoire: « Cap Sicié » (1984), « Km 296 » (1986). En 1989, il crée à Marseille l’association SITe (Sud, Image, Territoire), un collectif de photographes porteurs de propositions autour du thème de l’environnement et des enjeux de ses représentations photographiques (« Soude » (1993), « Quarantaine » (1993), « Résurgence », (1994), « Origine(s) », (1998)). En 1998, Il arrête son travail photographique qu’il reprend en 2013 (« Tentatives d’effleurements » (2014), « Abords et limites » (2015), « De Rerum Natura », (2018)) et revisite ses archives, après en avoir effectué des enregistrements numériques. Il regroupe l’ensemble de son œuvre sous le titre « Un regard sans personne ». Son travail photographique se caractérise par le choix de ses thèmes et la manière de les traiter: une unité territoriale à un moment choisi de son histoire saisie dans les détails révélateurs de ses enjeux. Privilégiant l’accumulation sérielle qui puise sa cohérence dans un cadrage rapproché des éléments constitutifs de l’environnement immédiat, l’accrochage au mur se présente sous des formes permettant des interprétations ouvertes, et pouvant s’articuler avec d’autres matériaux (scientifiques, sonores, poétiques…).
Vivien Ayroles
Aygalades
À propos de la série
« Ce travail a été réalisé dans le cadre de la Conversation photographique Olympus avec Valérie Jouve. Je venais de m’installer à Marseille et cette série est ma première exploration de l’aire métropolitaine. Je devais travailler avec un appareil numérique de marque Olympus conformément au contrat encadrant cette carte blanche. En écho à ce travail sur Marseille, Valérie Jouve réalisait elle une série à Jéricho. Nos deux travaux s’alimentaient dans un va-et-vient continuel de deux mois entre janvier et mars 2018. Le fleuve ruisseau des Aygalades était pour moi cette porte d’entrée dans la ville de Marseille, prenant sa source juste au nord de la Ville et se jetant dans le port traversant les quartiers en reconversion du secteur Euroméditerranée. Avec Valérie Jouve, nous échangions nos photos et nous répondions au moyen de l’image poussant nos perspectives et nos intérêts vers des champs de l’image qui ne sont pas ceux que nous explorons habituellement ou vers une esthétique parfois en décalage avec notre travail personnel. » Vivien Ayroles
- Année•s : 2017-2018
- Commune•s : Marseille, Septèmes-les-Vallons
- Commanditaire•s : Olympus
- © Vivien Ayroles, avec le soutien d'Olympus France
Documentation :
Vivien Ayroles_Annexes_Inventaire (pdf)Vivien Ayroles
Né en 1986 à Mâcon, France, Vivien Ayroles vit et travaille à Marseille. Diplômé en 2017 de l’École nationale supérieure de la photographie et en 2010 de l’IEP d’Aix-en-Provence, il a travaillé en tant qu’attaché de presse pour des expositions d’art contemporain et ensuite au développement d’un festival de vidéo à Paris et Berlin. Son travail photographique s’intéresse à l’action de l’homme sur le paysage et à la redéfinition des usages et de la notion de territoires, notamment dans l’espace méditerranéen. Il a, entre autres, exposé à Paris, Arles, New York et publié dans des magazines internationaux.
Stéphanie Lacombe
Usine de Martigues
À propos de la série
« Choc. Au-delà du village de Martigues s’étend un paysage industriel ininterrompu d’usines et de raffineries. Les cheminées de l’ancien site EDF ont provoqué chez moi une véritable obsession visuelle. Surplombant l’extrême bord de la côte, elles sont d’une beauté surréaliste. Fiction. Instinctivement, j’ai eu besoin de ramener l’usine dans un cadre plus intime. J’ai intégré son image dans des tableaux que j’avais chinés, puis photographiés dans des intérieurs supposés être ceux des maisons martégales. Le décor est vieillot, les couleurs délavées. En creux, cette mise en scène pose la question du temps qui passe et de l’avenir d’une usine qui se dégradera un jour. Emotions. J’ai eu la chance paradoxale de parcourir la Côte bleue lors d’une tempête. Un spectacle inoubliable. Je suis aussi tombée sous le charme de la route du Rove. Elle domine les calanques de Vesse et Niolon et offre des points de vue exceptionnels sur Marseille. » Stéphanie Lacombe
- Année•s : 2013
- Commune•s : Martigues
- Commanditaire•s : Bouches-du-Rhône Tourisme
- © Stéphanie Lacombe / SAIF
Stéphanie Lacombe
Stéphanie Lacombe est née en 1976 à Figeac, dans le Lot. Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris (ENSAD). Ses travaux documentaires sont exposés en France, en Argentine, en Finlande, à Hong Kong et ont été publiés par de nombreux magazines et quotidiens, parmi lesquels la Revue XXI, l’Obs, Courrier International, Le Monde. Elle transmet son expérience de femme photographe à l’occasion de workshops menés auprès d’institutions publiques et privées : la Fondation Cartier, les Ateliers du Carrousel, le pôle photographique Diaphane, La maison Robert Doisneau, les Rencontres d’Arles. Elle est lauréate du Prix l’Obs (2020), de la Fondation Lagardère (2006), et a reçu le Grand Prix de la photographie documentaire et sociale de Sarcelles (2008), ainsi que le Prix Niepce (2009). En 2001, Sebastião Salgado lui remettait le prix spécial du jury Agfa.
Atlas Métropolitain — Ayavou / Chaillan / Peyrard
Voies ferrées
À propos de la série
Cette série n'a pas encore de descriptif.
- Année•s : 2011
- Commune•s : Arles, Châteauneuf-les-Martigues, Fos-sur-Mer, Gardanne, Istres, La Fare-les-Oliviers, Lavéra, Les Pennes-Mirabeau, Marseille, Martigues, Miramas, Peypin, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Roquevaire, Simiane-Collongue, Vitrolles
- Commanditaire•s : ENSA-Marseille
- © Ayavou / Chaillan / Peyrard
Documentation :
Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain
Biographie à venir.
Emma Grosbois
10 vues de Marseille, photographies véritables
À propos de la série
« L’idée de ces images est née lors de mes premiers temps à Marseille, de balades dans la ville en compagnie et en connivence avec mon amie architecte Delphine Mondon. Nous habitions auparavant en Italie, nous avons été amusées par le caractère insolite, dissonant parfois grotesque du décor urbain dans lequel apparaissait certains monuments et sculptures présents aussi dans l’espace urbain italien (David, arc de triomphe…). Leur présence m’intriguait, particulièrement à Marseille où, la plupart d’entre eux, sont peu visibles et ne compte pas parmi les « sujets de carte postale » ayant pour rôle de représenter la ville aujourd’hui. Je découvre également en arrivant à Marseille le projet Euroméditerrannée ambitionnant de doter la ville d’un nouveau coeur, d’un nouveau centre. Une question se pose alors : quel serait l’ancien centre ? J’avais commencé une collection de mini pochettes qui étaient édités au cours du XX siècle. Elles contenaient 10 à 20 vues miniaturisées de villes qui résumaient en quelques vues les caractéristiques ou les points de vue remarquables de sites fréquentés par les touristes. Objets industriels de consommation ils avaient pour fonction de donner aux touristes des supports visuels de souvenir. Souvent y figurait la mention « véritables photographies », ces pochettes étaient composées en effet de véritables tirages photographiques. Plusieurs techniques d’impression furent utilisées depuis l’origine de la carte postale jusqu’à nos jours. Il faut noter la qualité exceptionnelle de la plupart des clichés des cartes postales anciennes (CPA) du début du XXème siècle, et malgré l’amélioration des procédés d’impression, on assistera à une diminution de cette qualité au début des années 30. Qualité que l’on retrouvera avec les cartes postales semi-modernes (CPSM) puis modernes (CPM). Le graphisme et les typographies des pochettes sont également très soignés. Ce qui au regard de l’offre de carte postale commercialisée actuellement en fait des objets précieux. En prenant inspiration de cette imagerie touristique, j’ai photographié dix éléments de la statuaire publique du centre ville marseillais en suivant les codes de la carte postale. Au moment où le projet Euroméditerranée prétend doter la ville d’un nouveau centre, il s’agissait de poser le regard sur ces monuments esseulés et de questionner les interventions du pouvoir dans la ville. J’ai ensuite rassemblé dix de ces photographies imprimées sur papier baryté dans une pochette de 10,5 x 7,5cm imprimée en 200 exemplaires sur les presses typographiques de l’Annexe à Marseille sur papier Fedrigoni (blu intense 300g). La couverture de la pochette est ajourée en œil de bœuf. » Emma Grosbois
- Année•s : 2018
- Commune•s : Marseille
- Commanditaire•s : Travail personnel
- © Emma Grosbois
Documentation :
Annexes (pdf)Emma Grosbois
Emma Grosbois est née en 1985 à Rennes. Elle a étudié la photographie à la Fondation Marangoni à Florence. Son travail avant tout photographique se concentre sur les rapports entre images, lieux et mémoires. Il a été exposé et publié en France et à l’étranger. Lors d’une résidence au centre d’art contemporain Luigi Peci à Prato en Italie, elle ouvre son champ d’expérimentation à la construction dans l’espace public d’installations de dispositifs optiques inspirés de la camera obscura de la Renaissance. Elle privilégie les expériences collectives et les échanges avec d’autres pratiques de recherche. Elle vit à Marseille.











































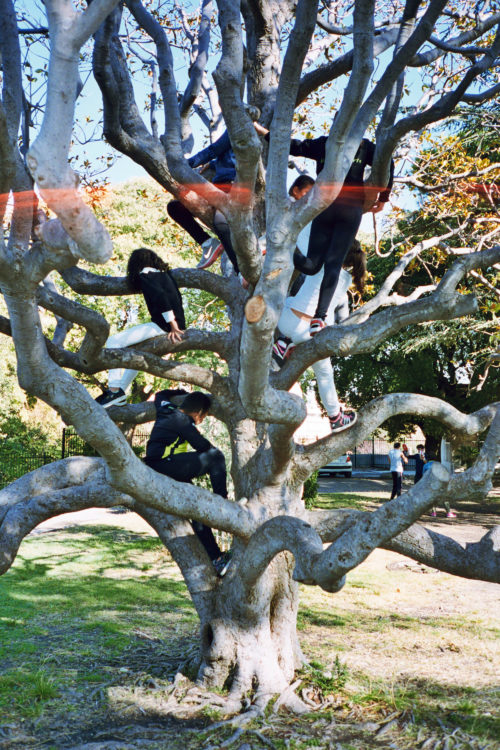
































































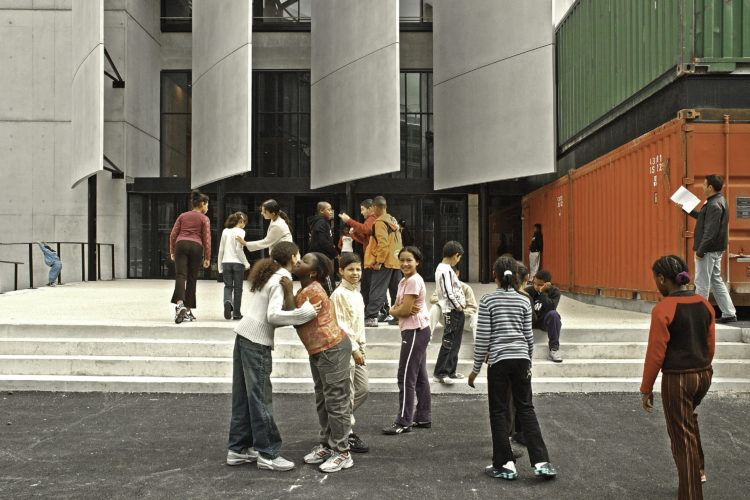

























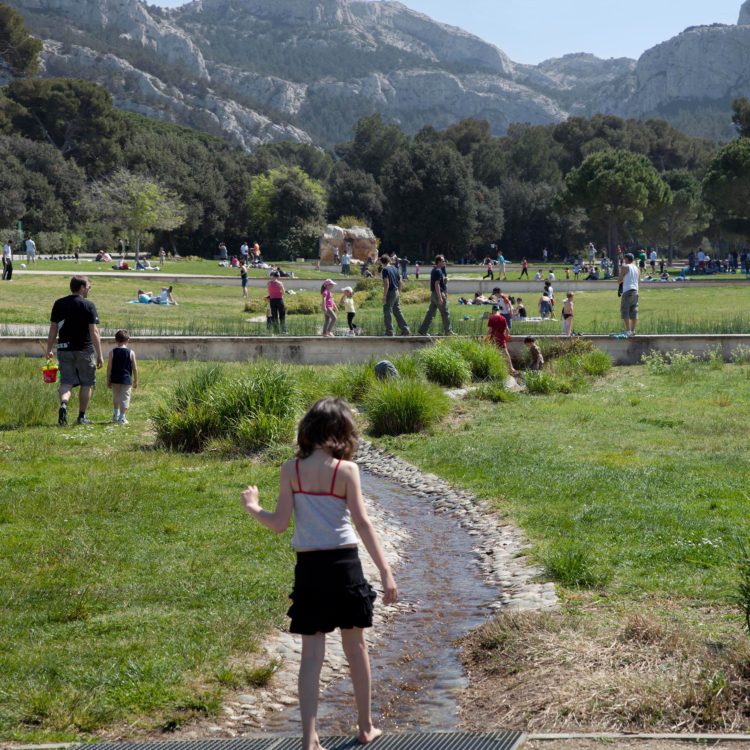




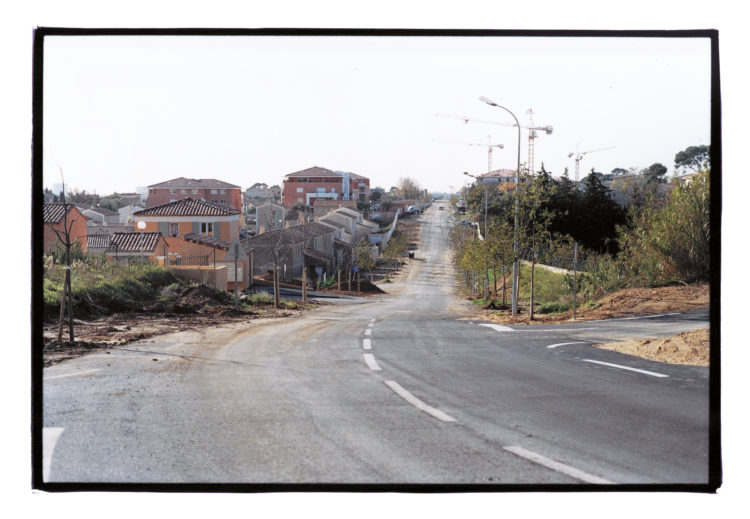





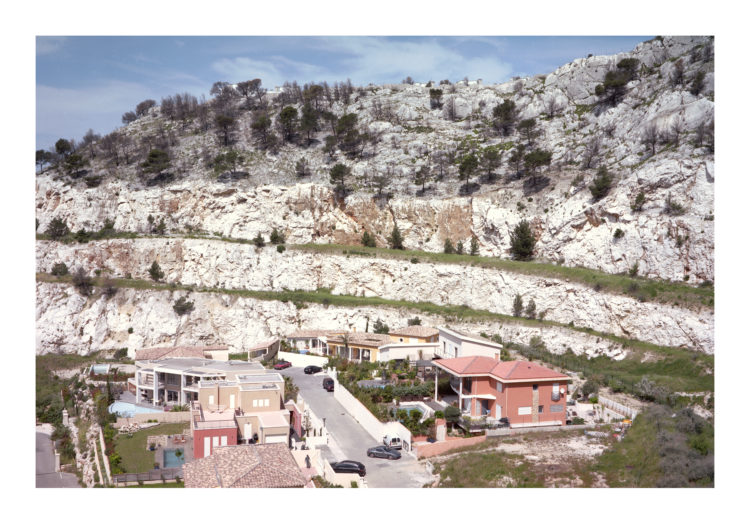























































































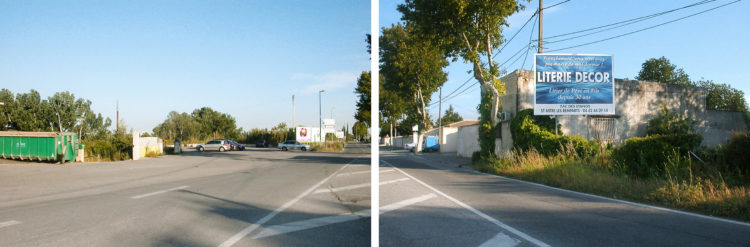

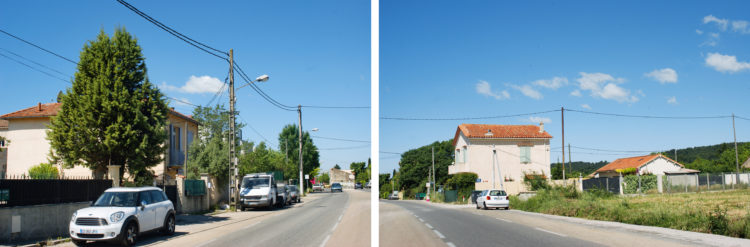
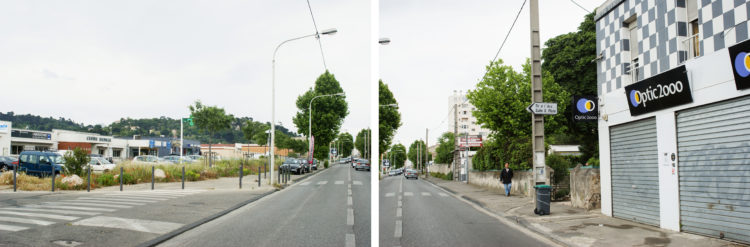






























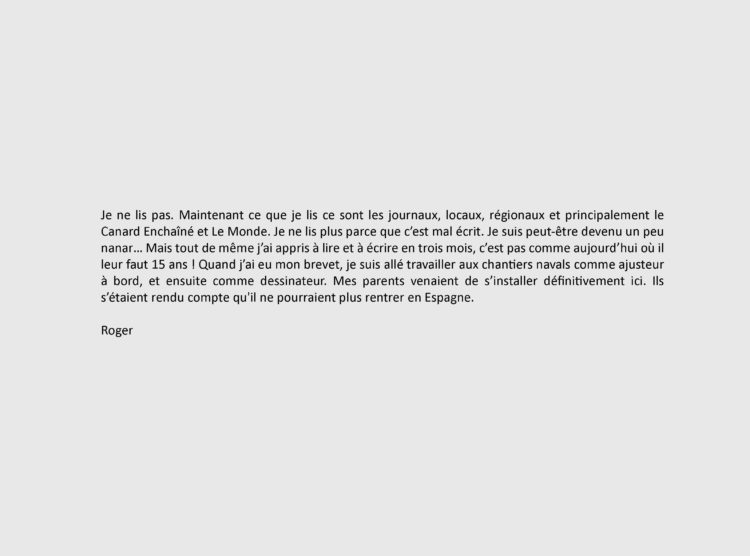


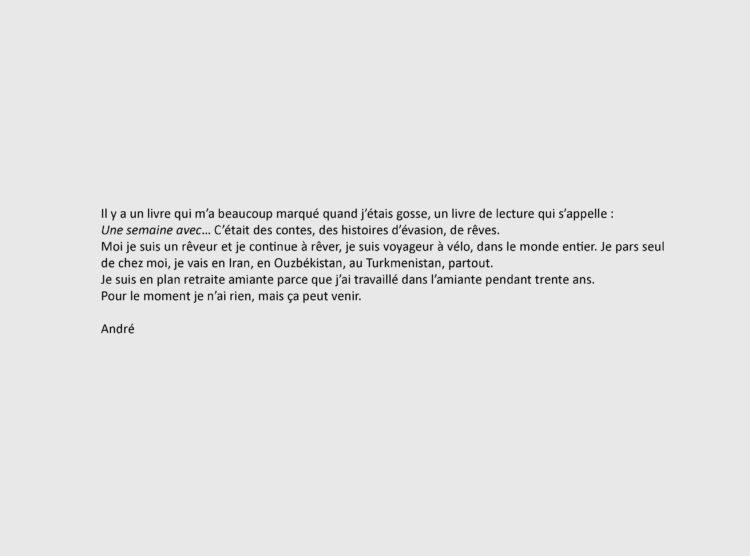

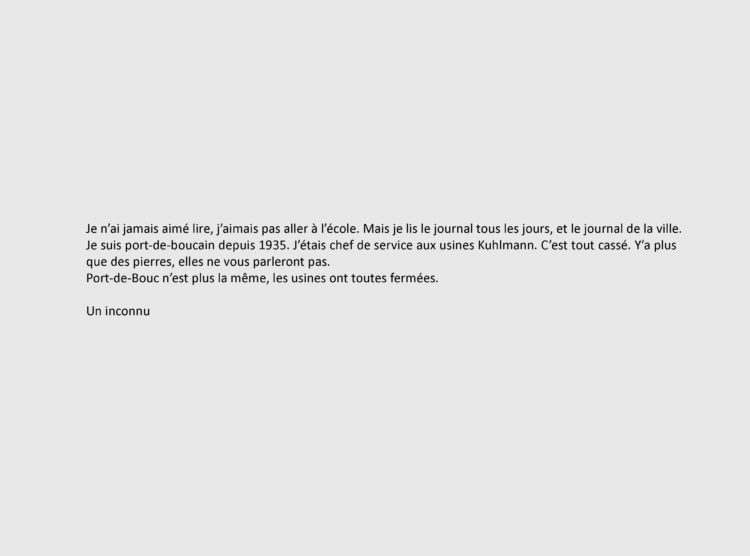








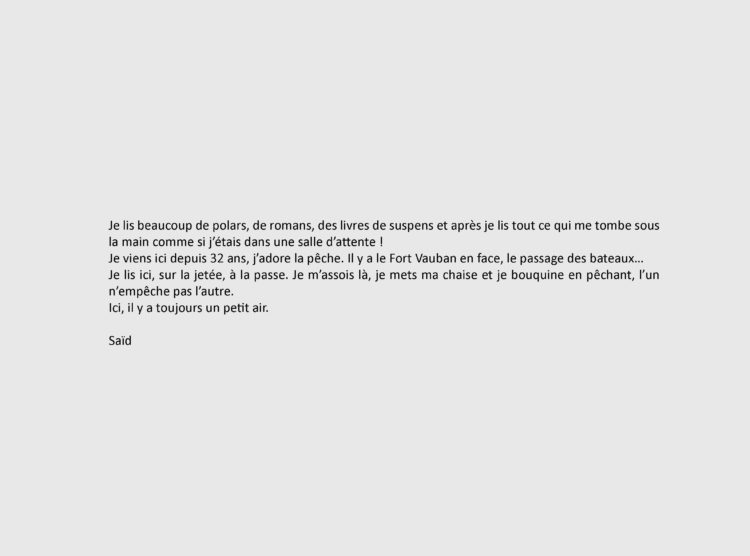












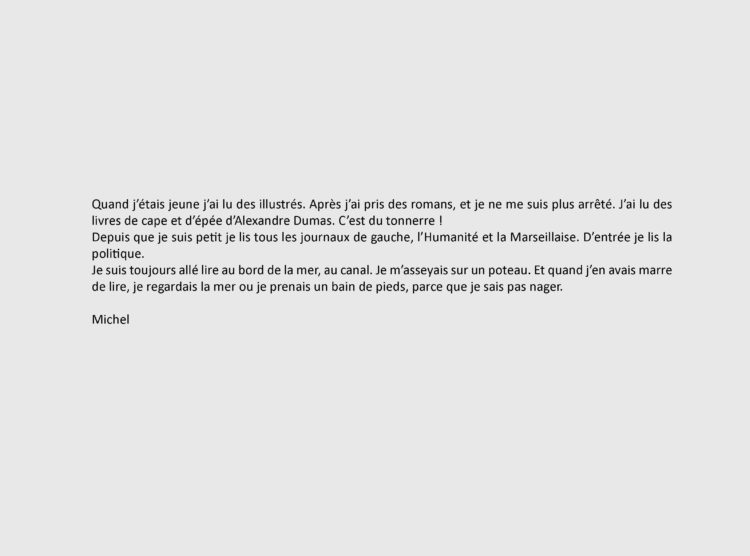

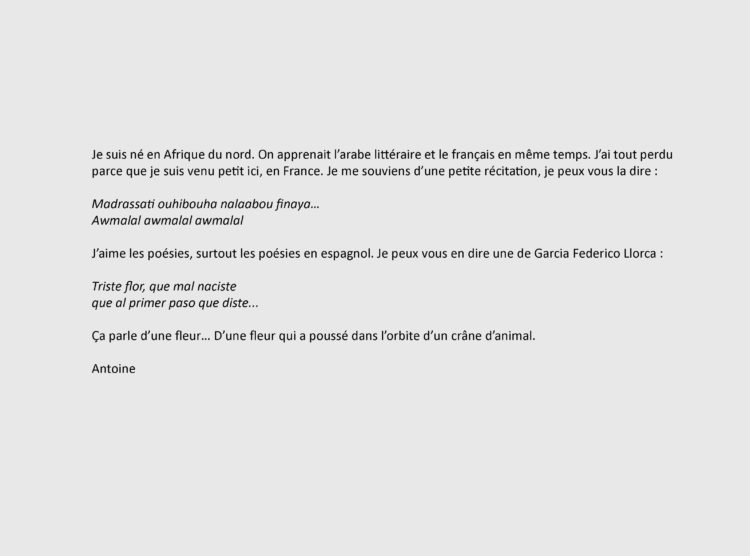


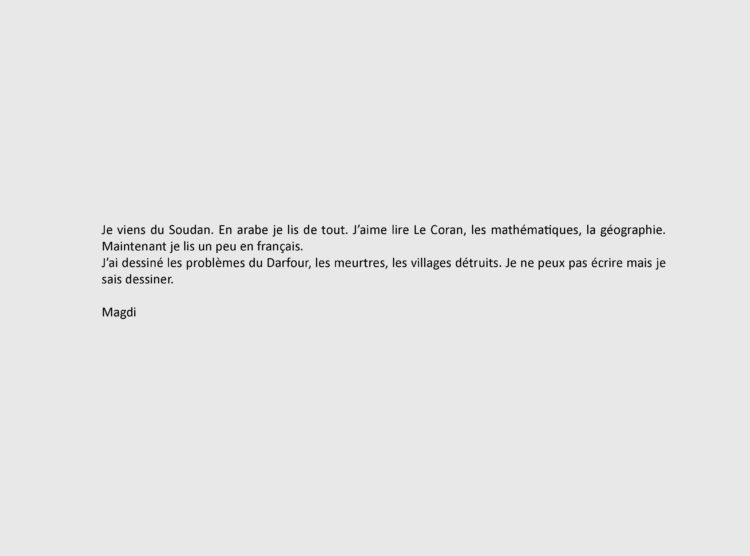


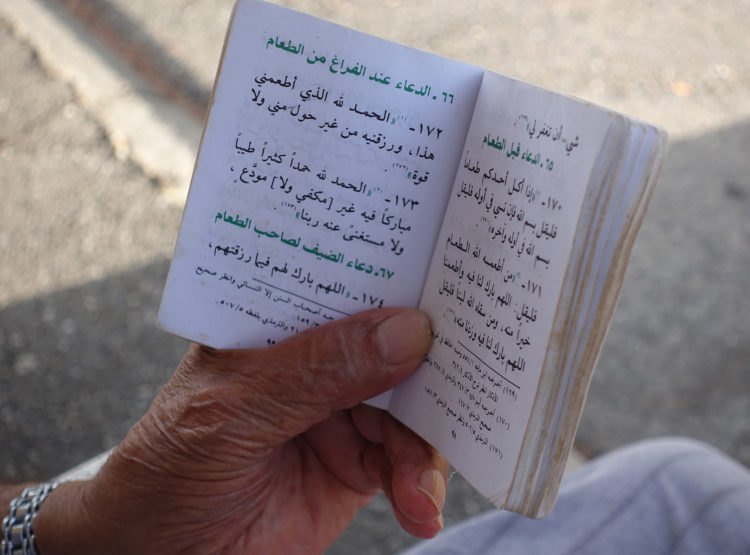
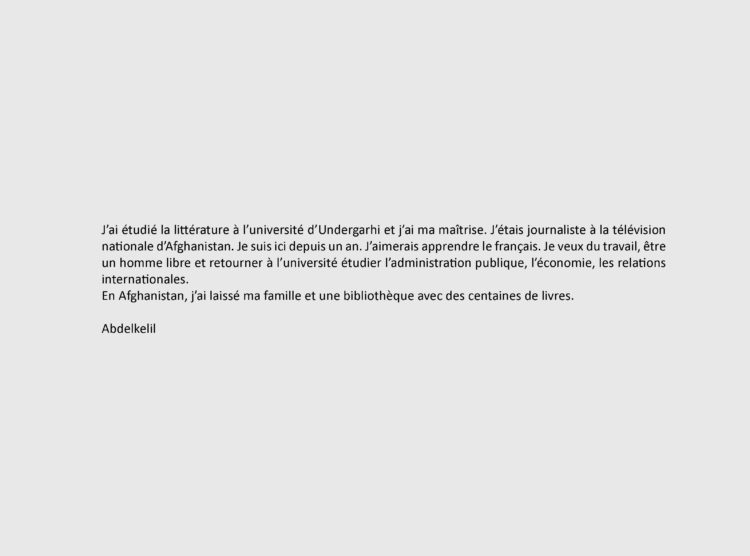



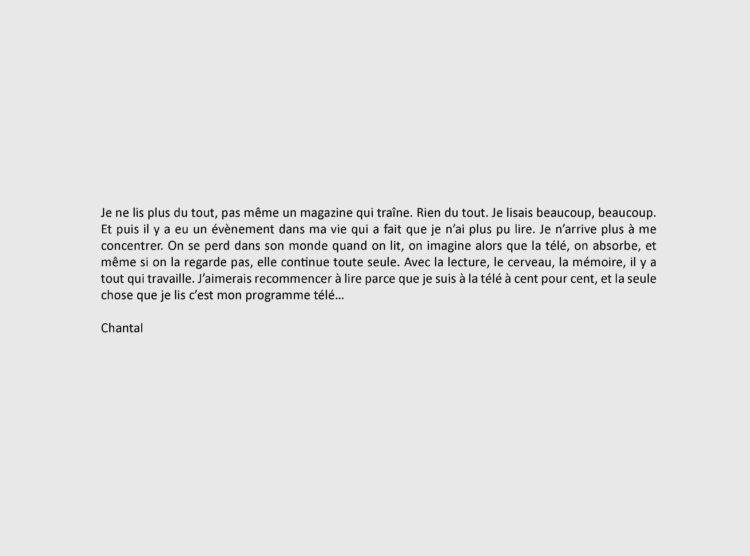



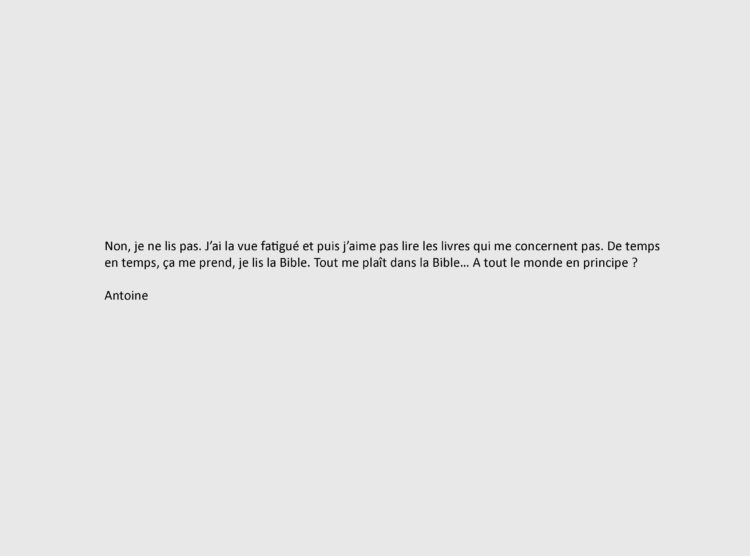

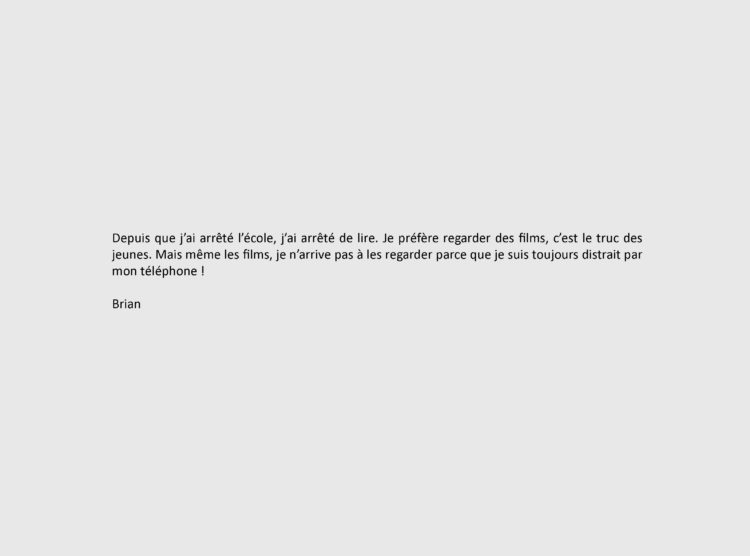

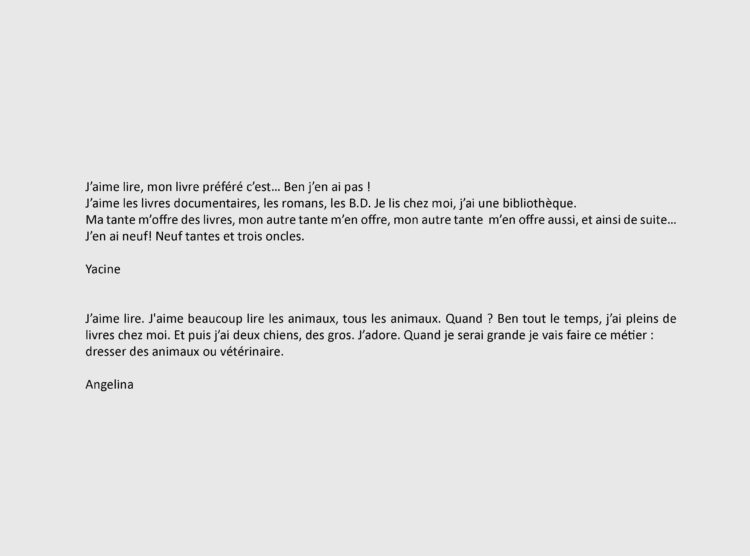

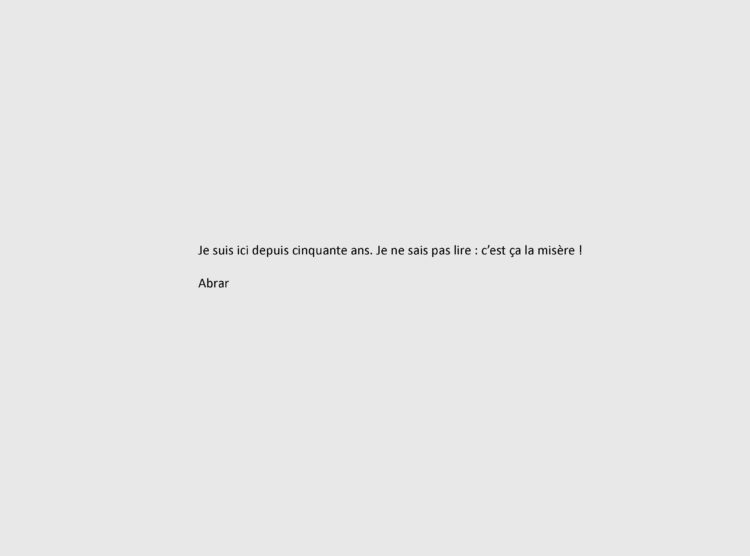

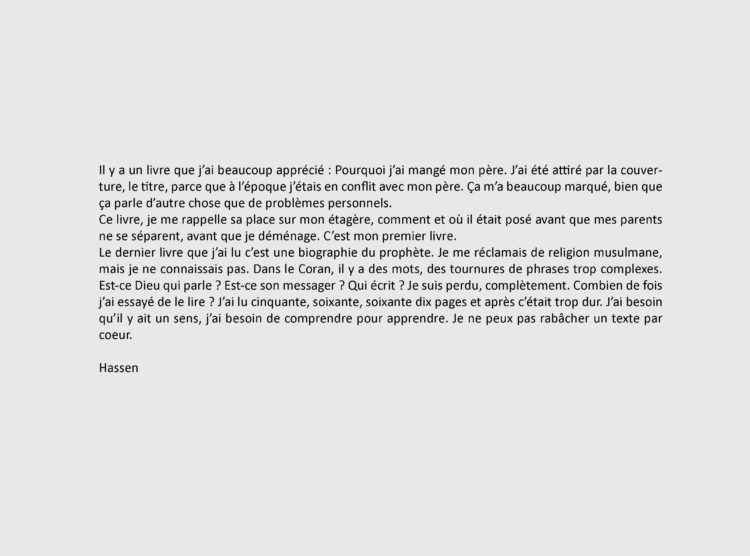




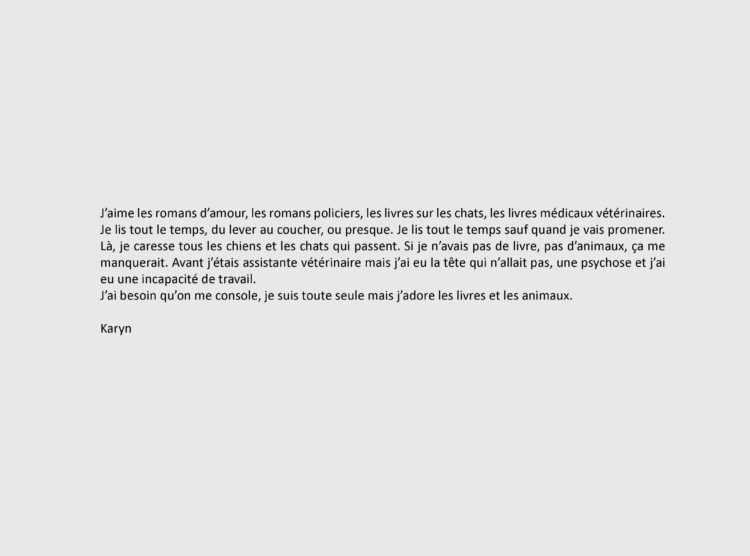


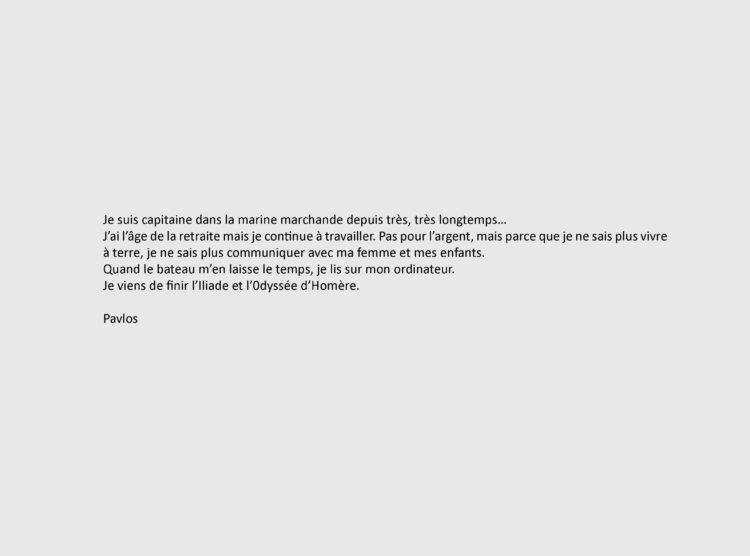


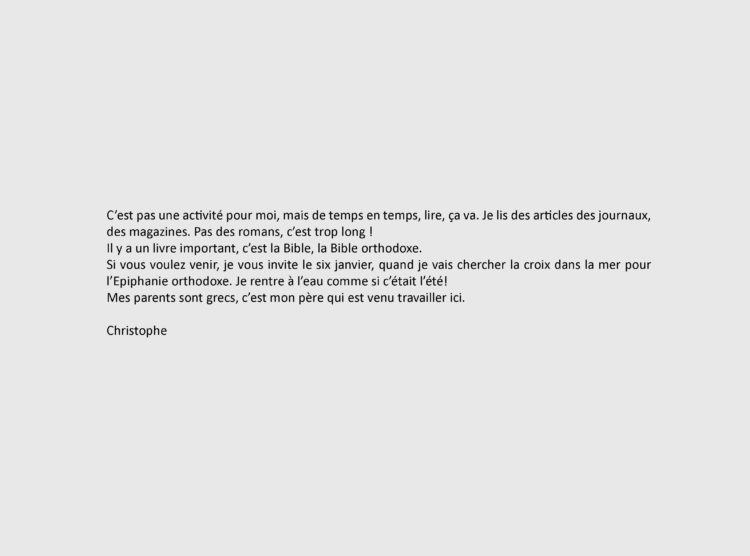








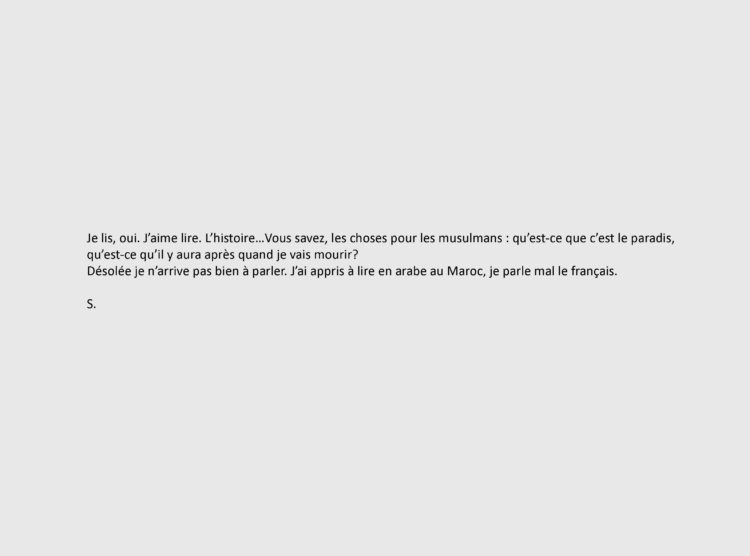
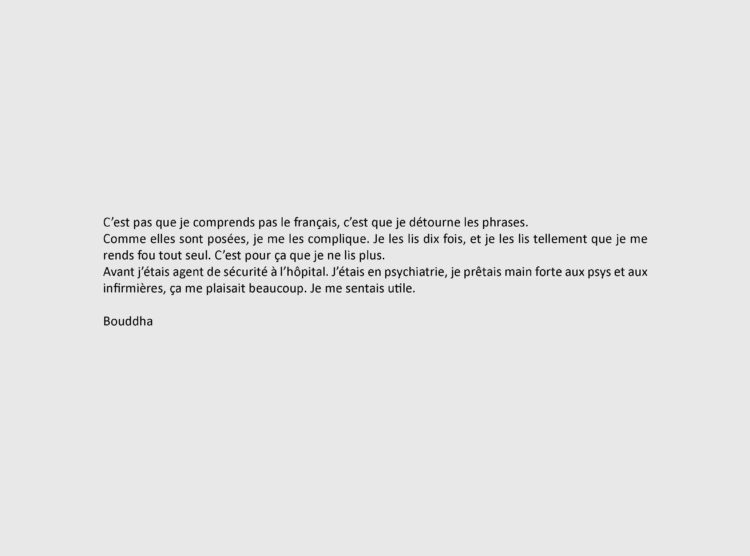

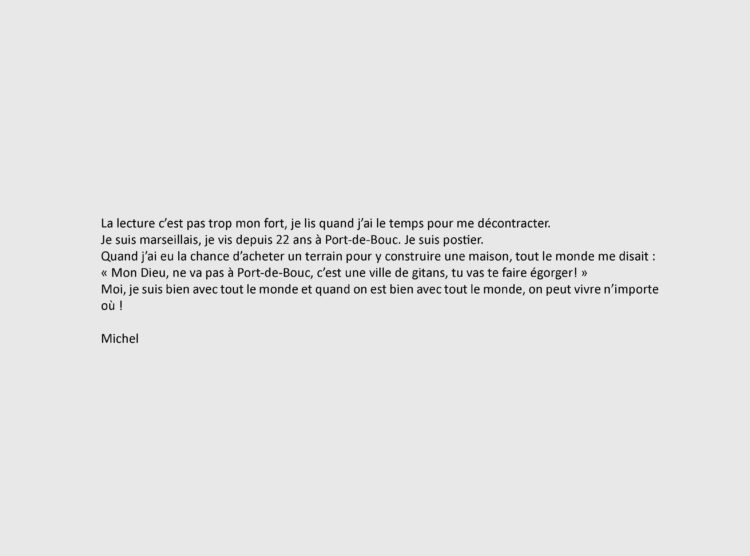

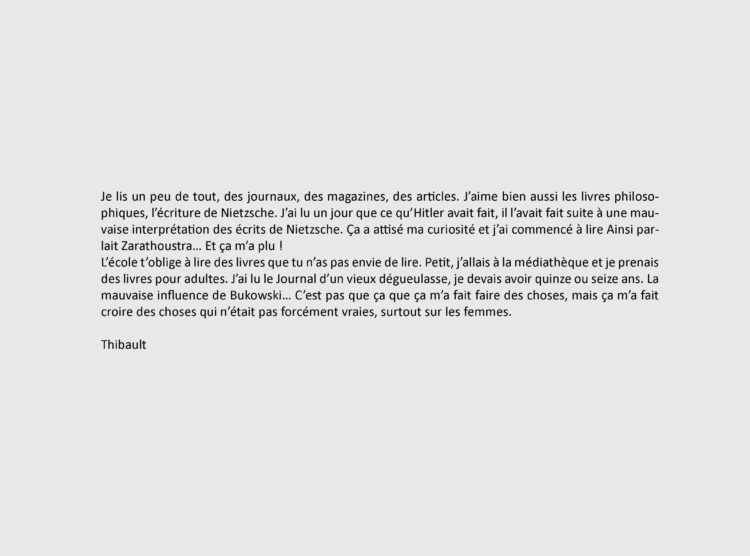

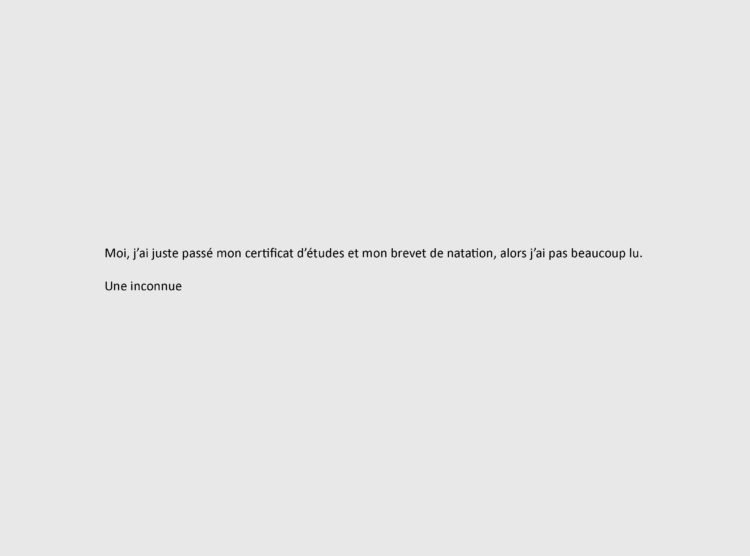


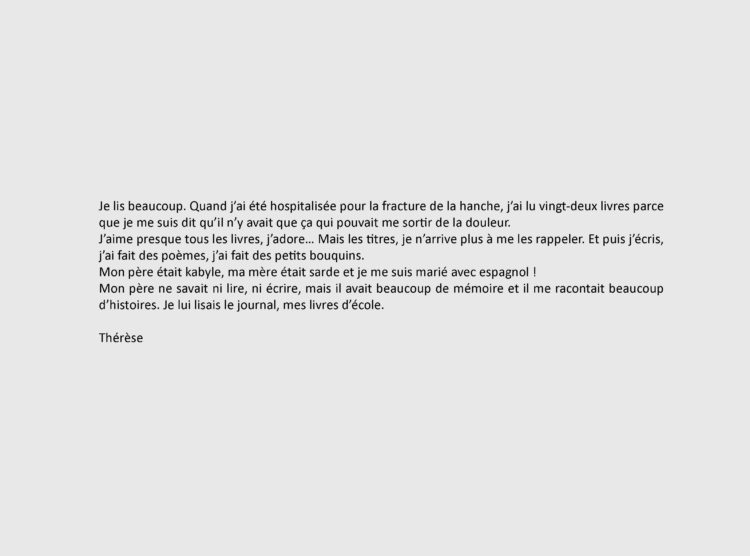

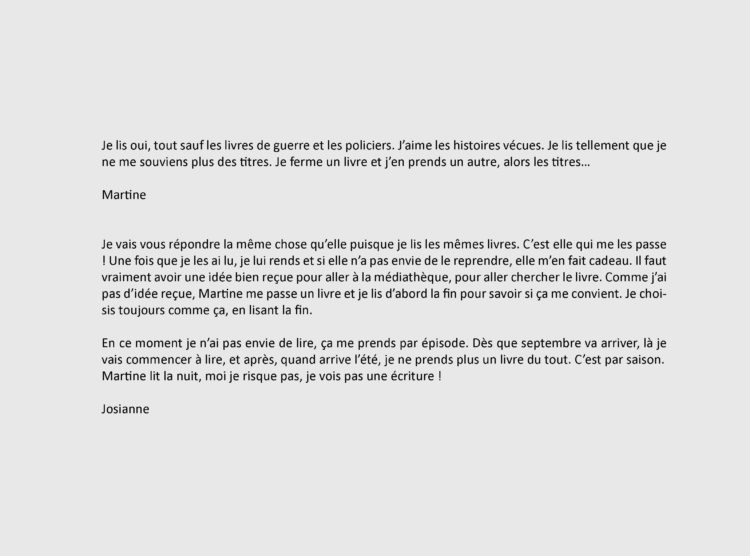
























































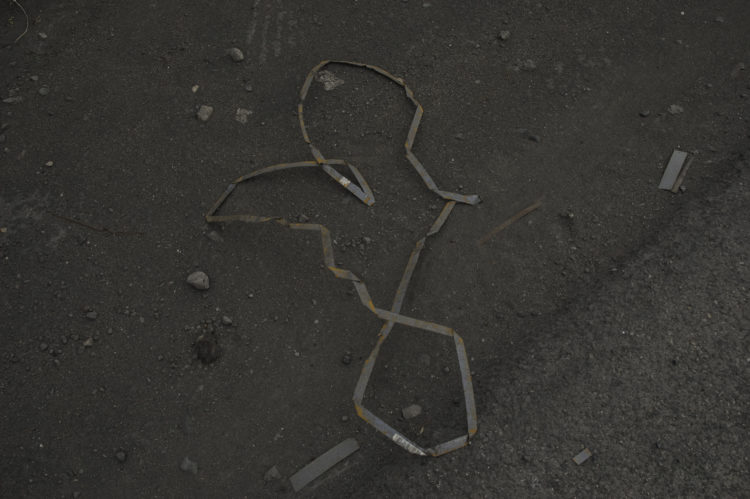


















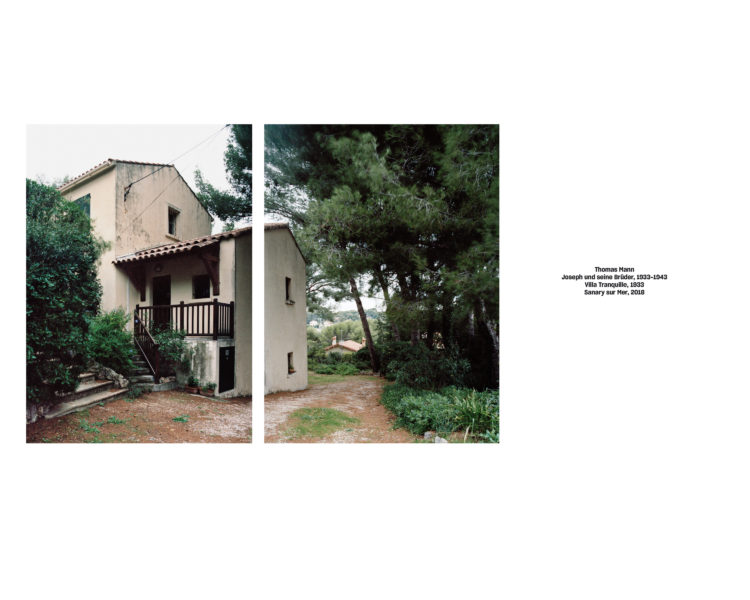
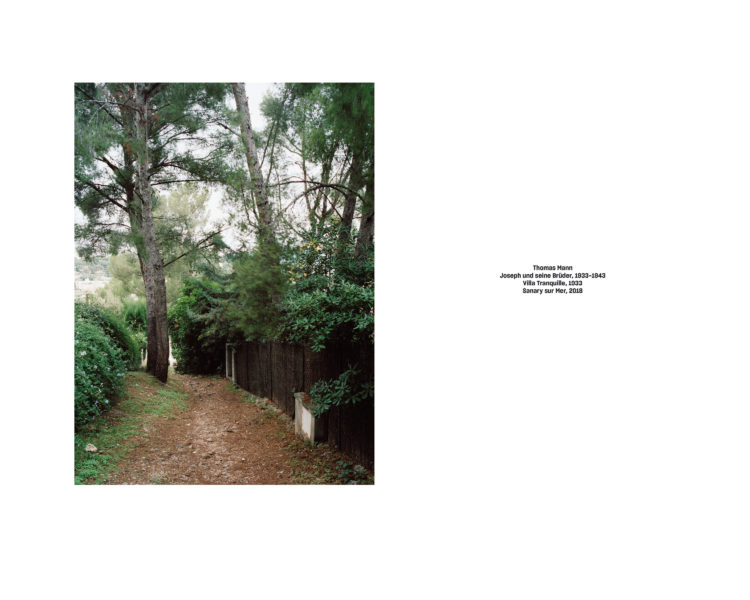
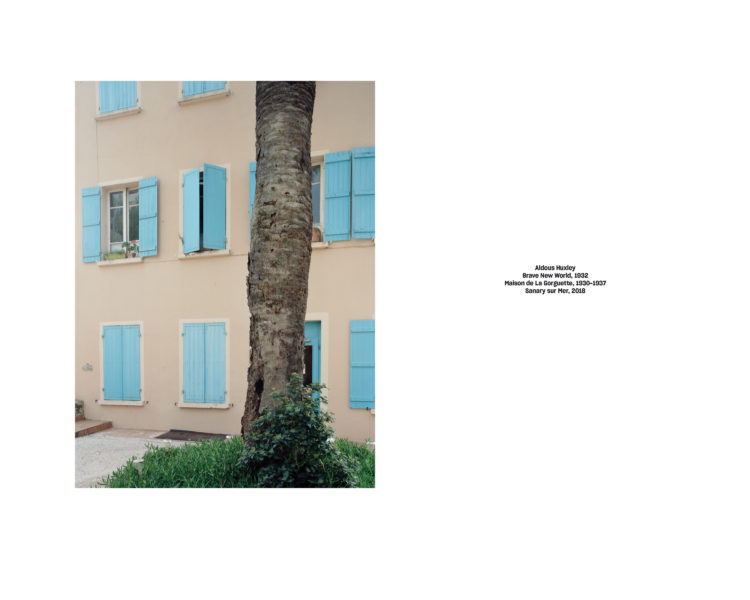
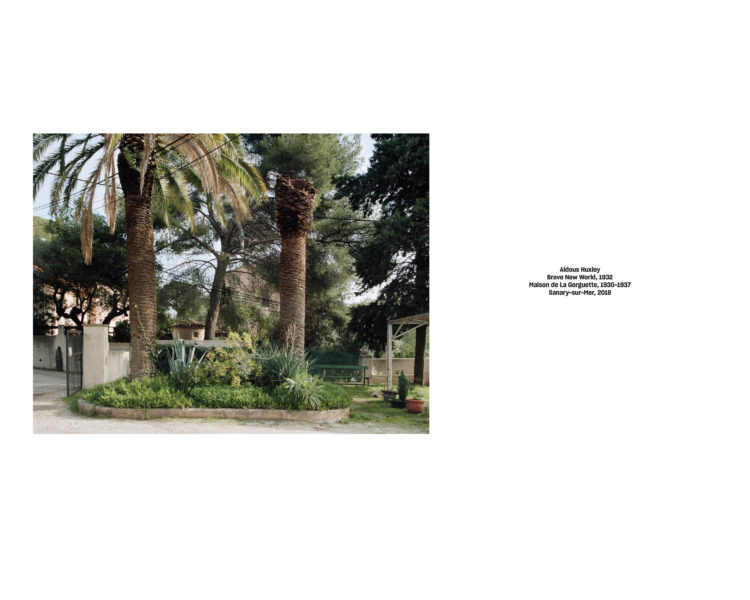
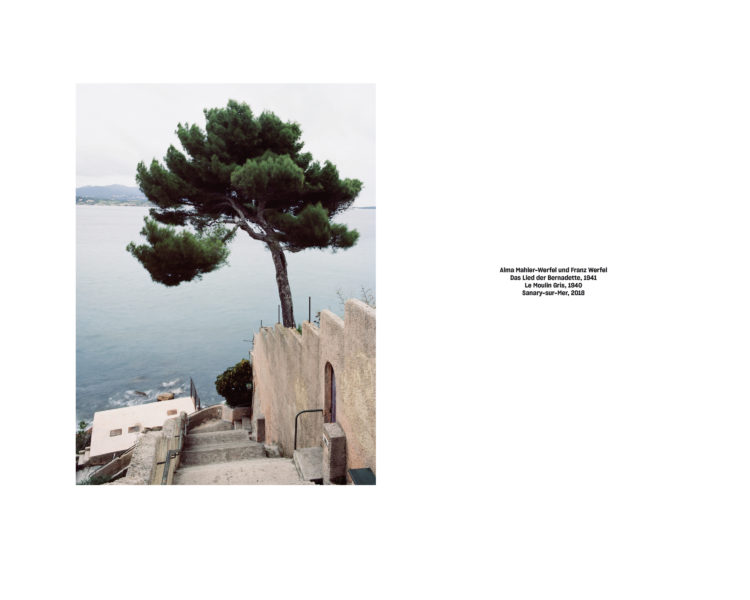
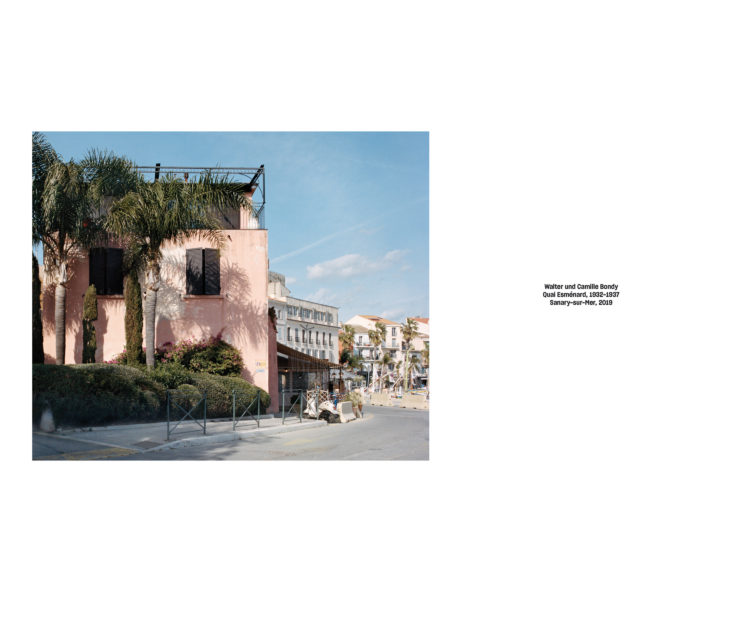
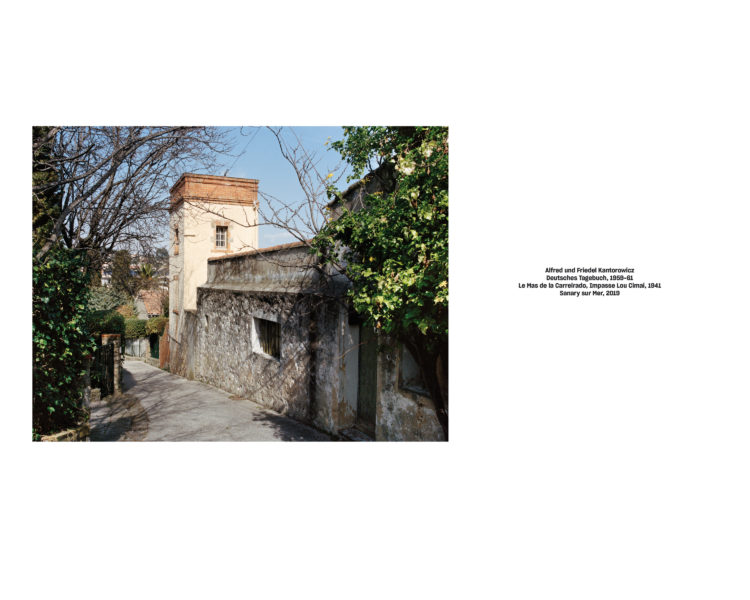
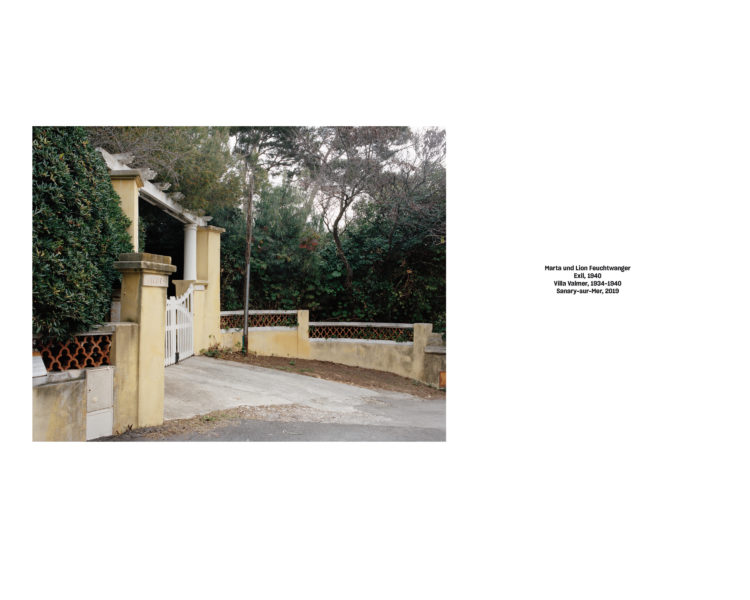

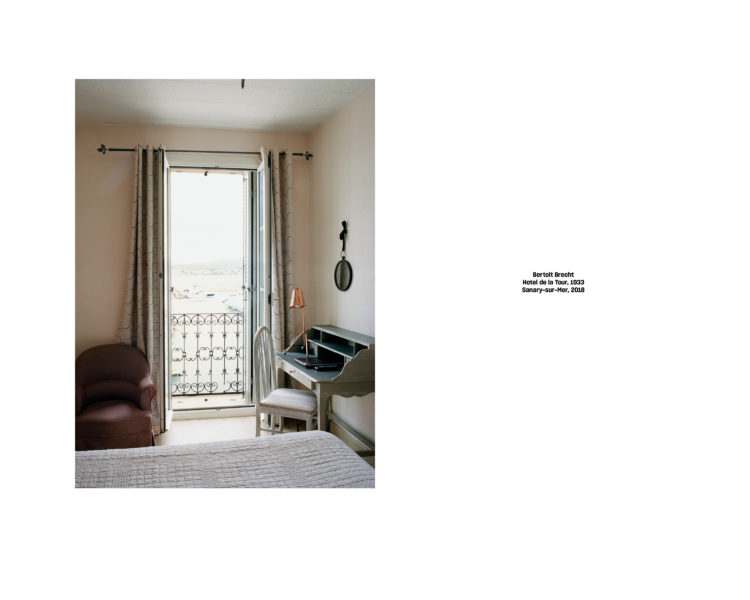
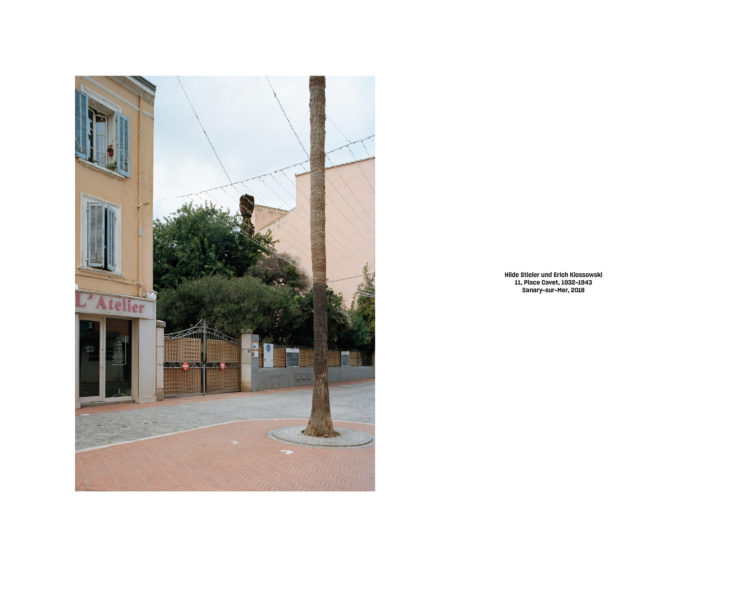
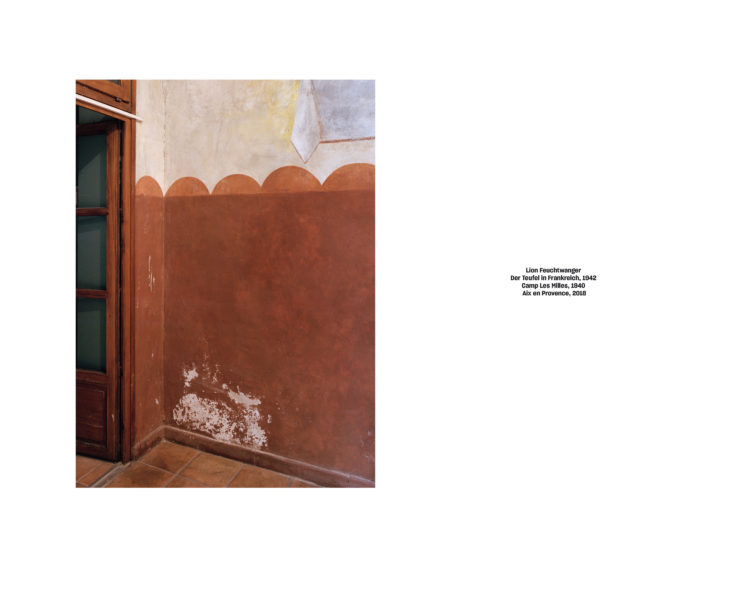
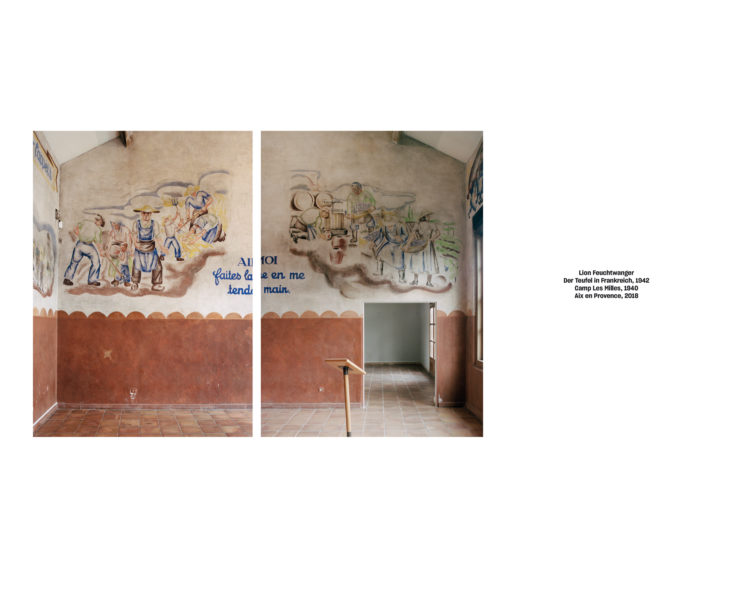
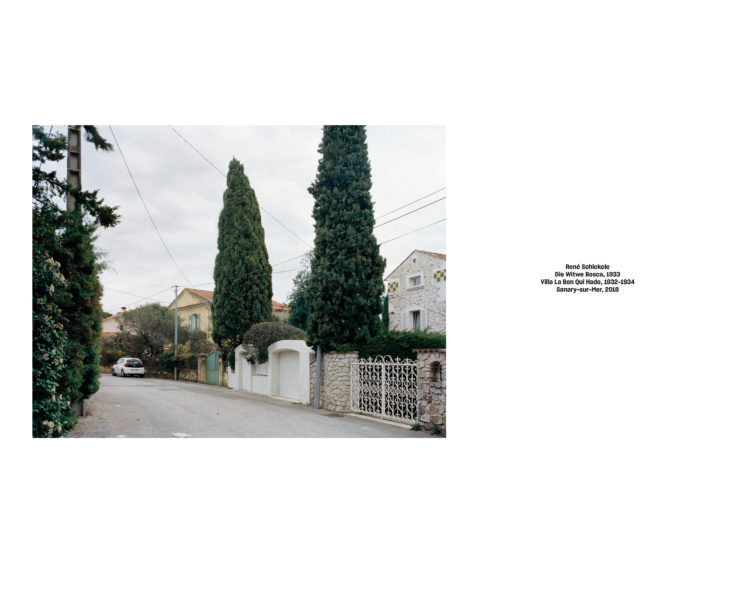
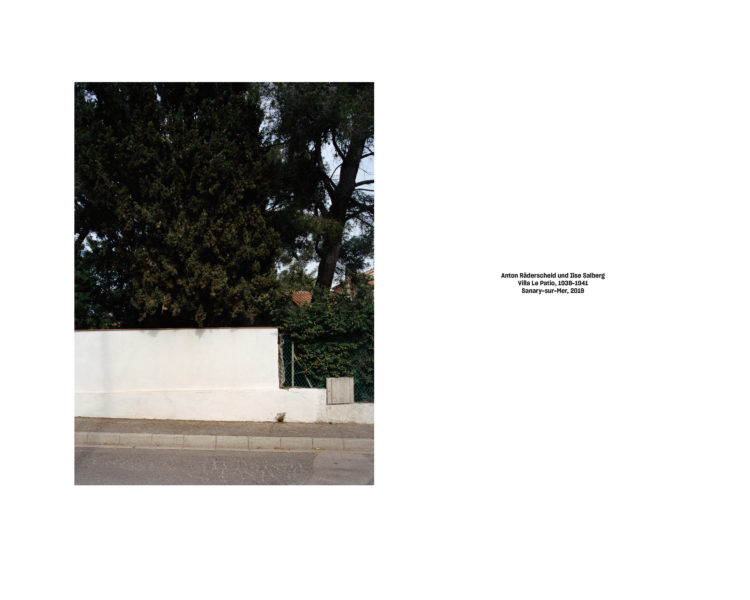
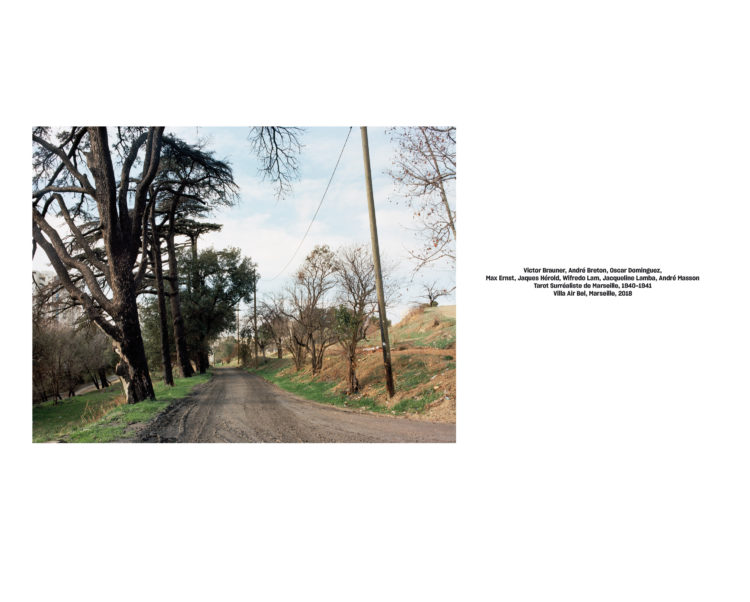
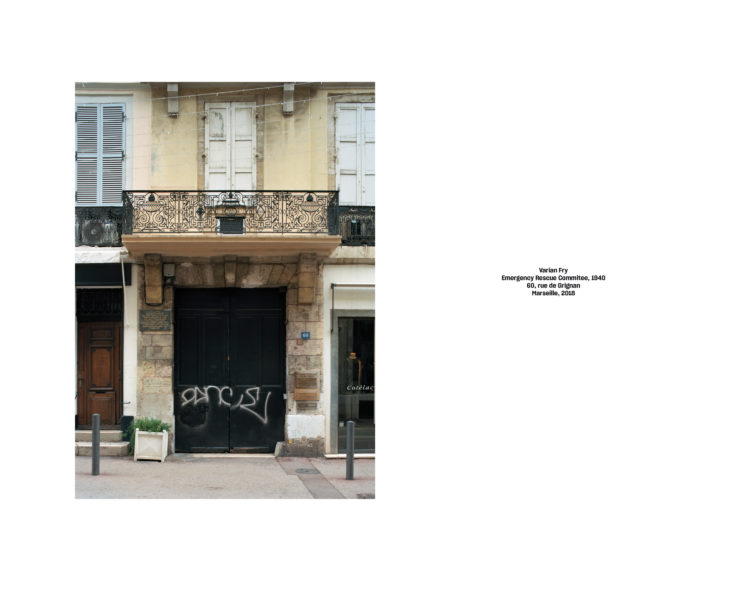
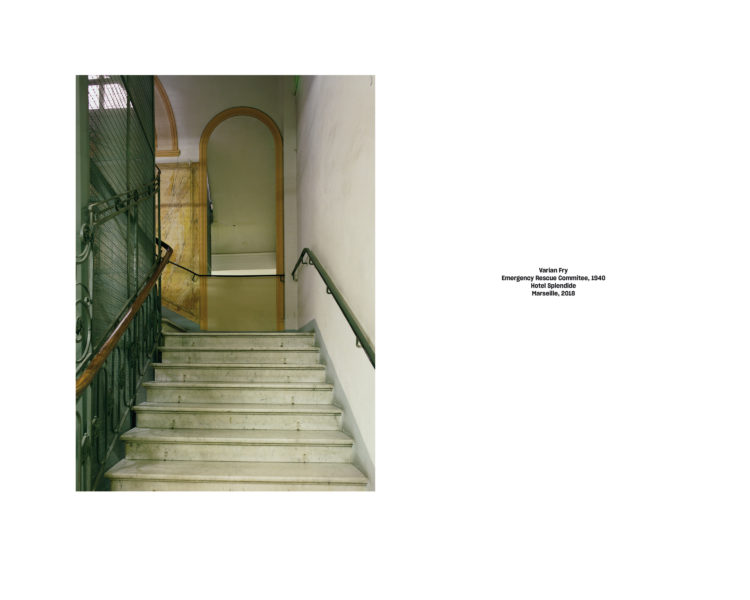
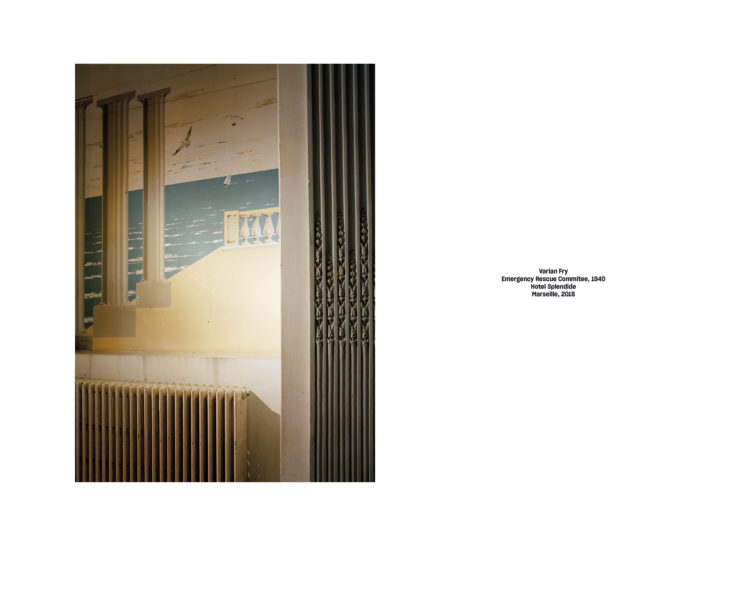






























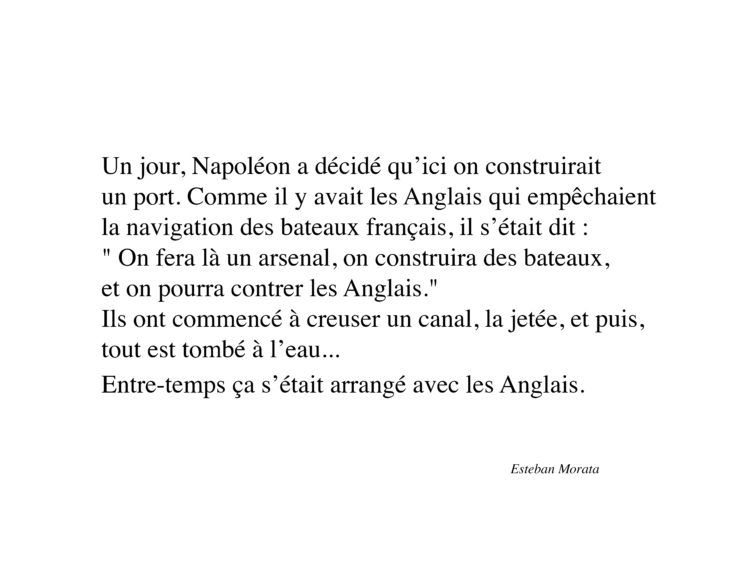

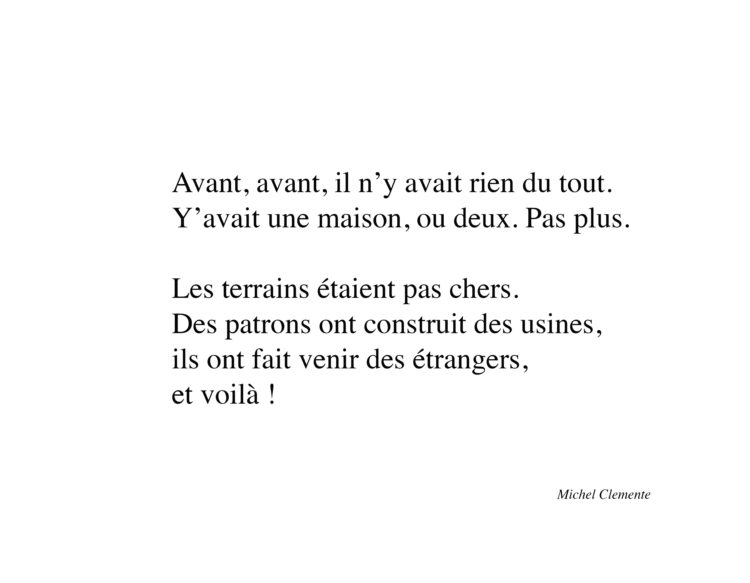

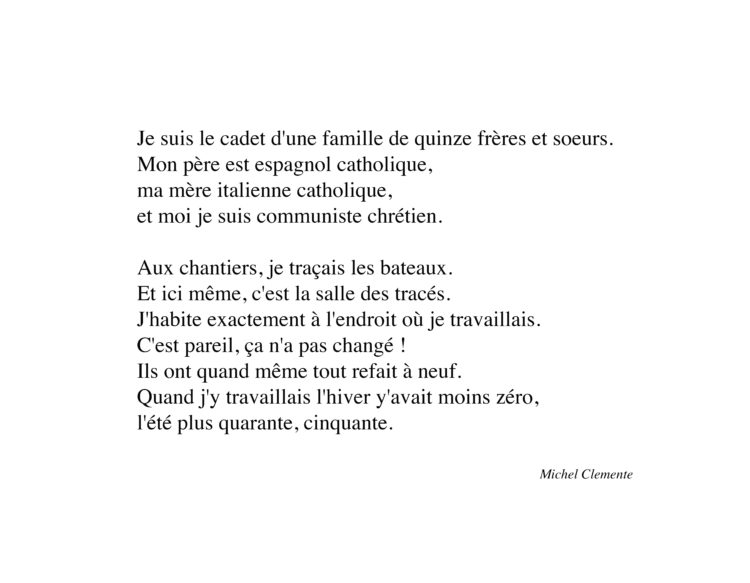

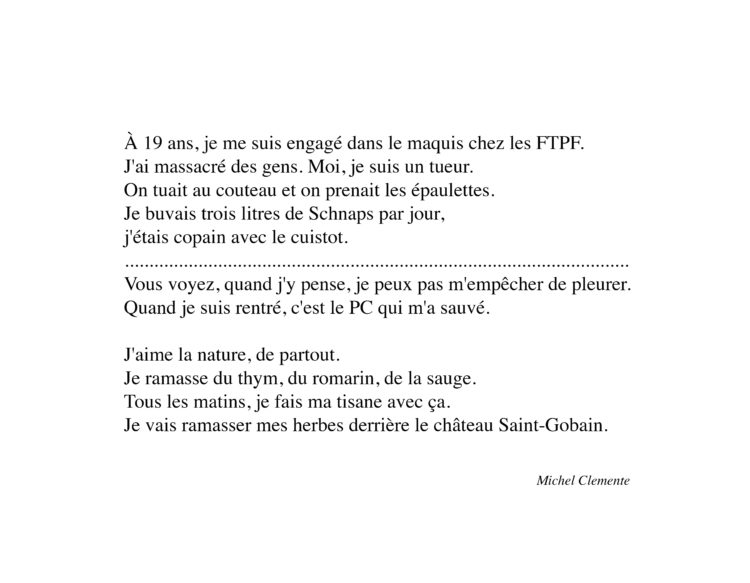
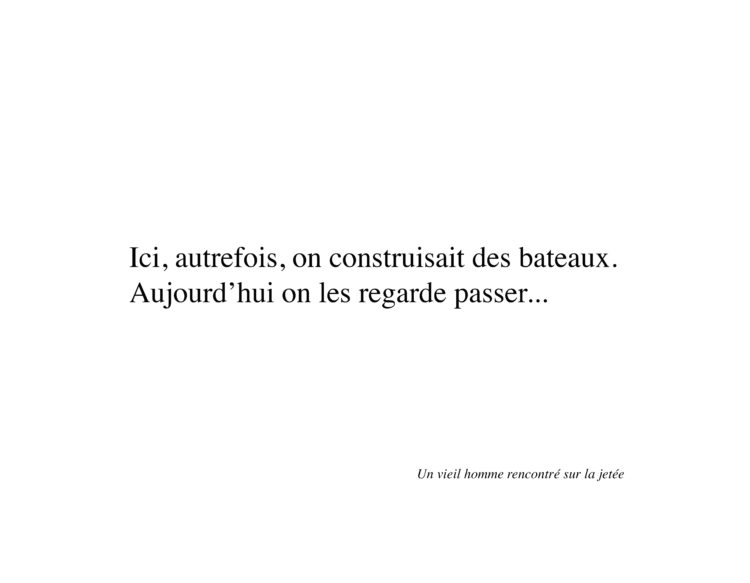

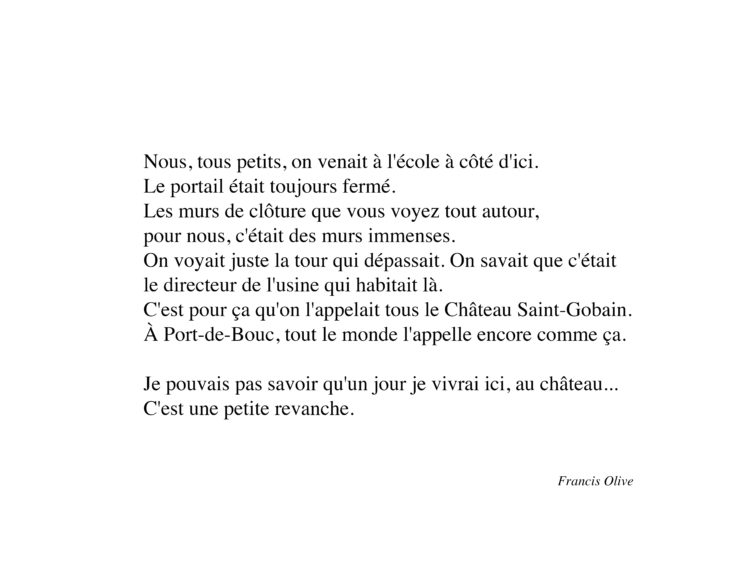
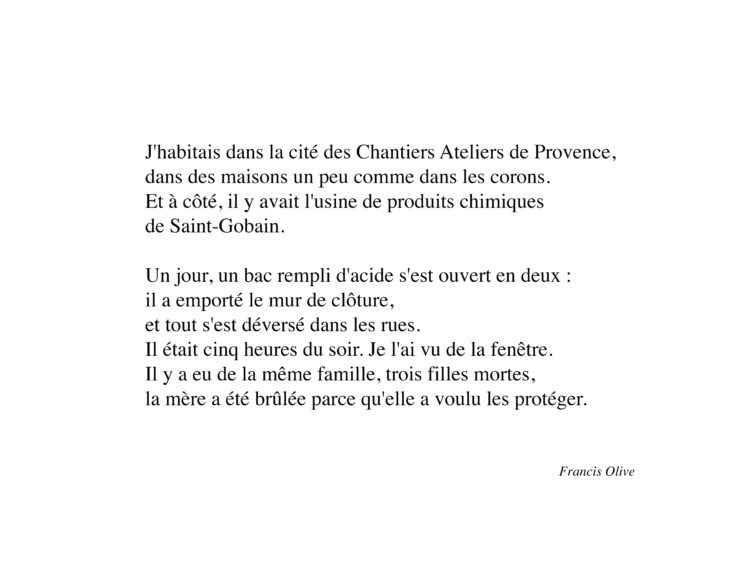


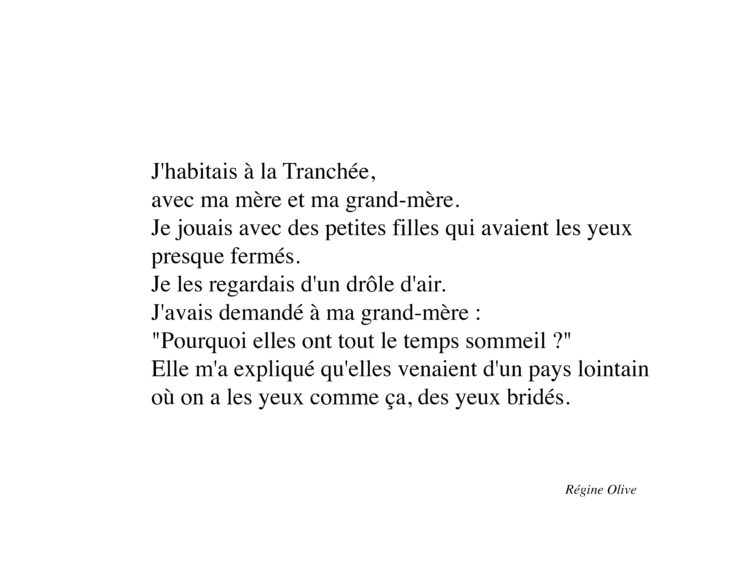

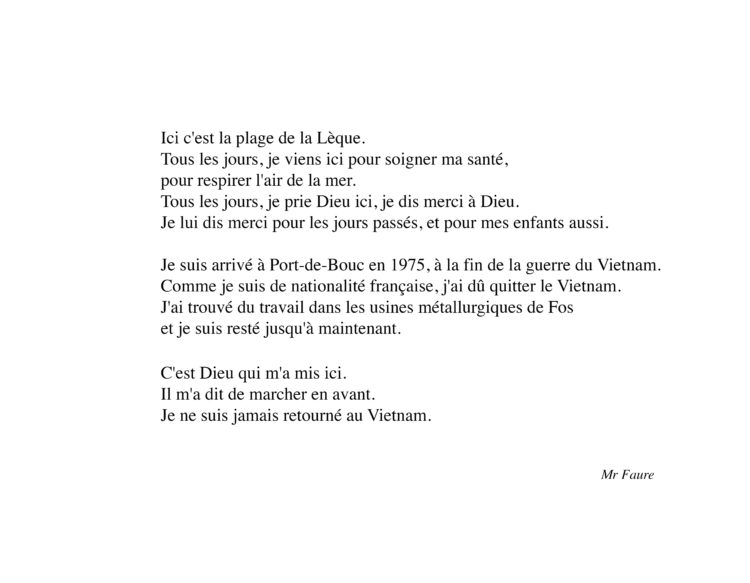


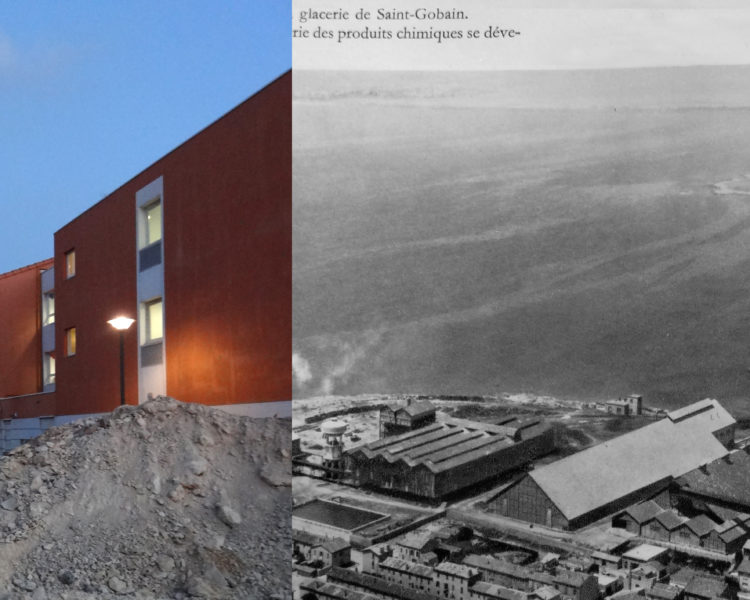


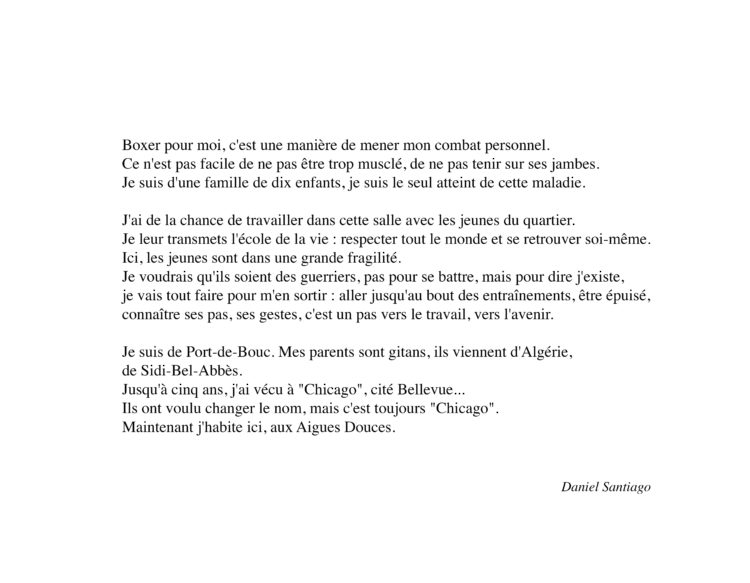



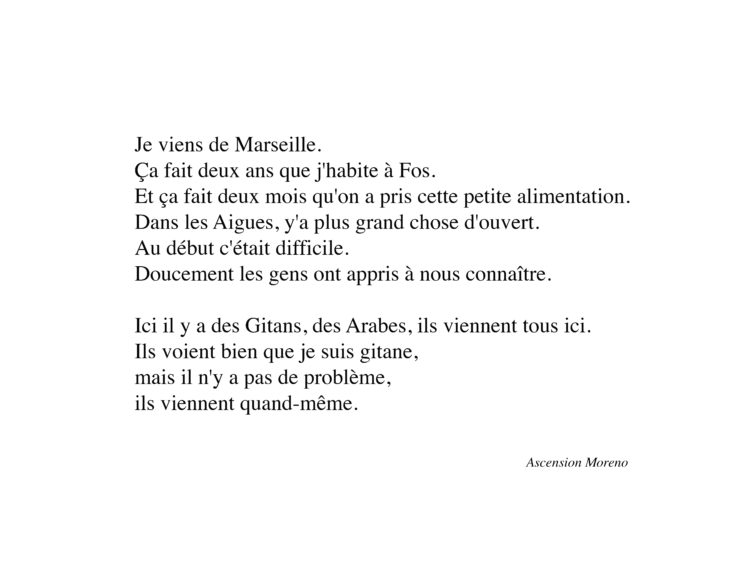

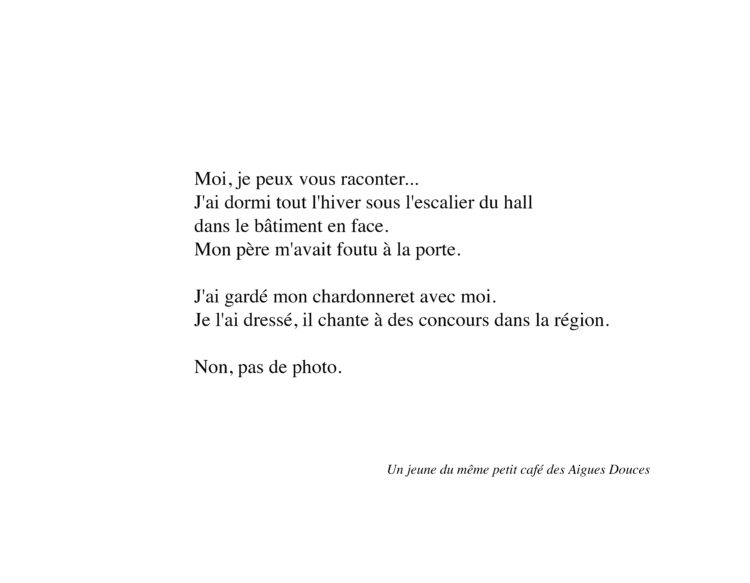
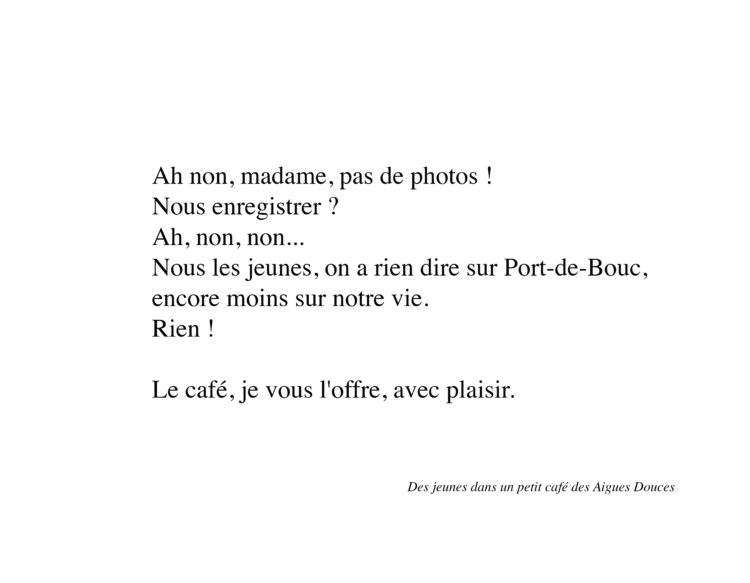




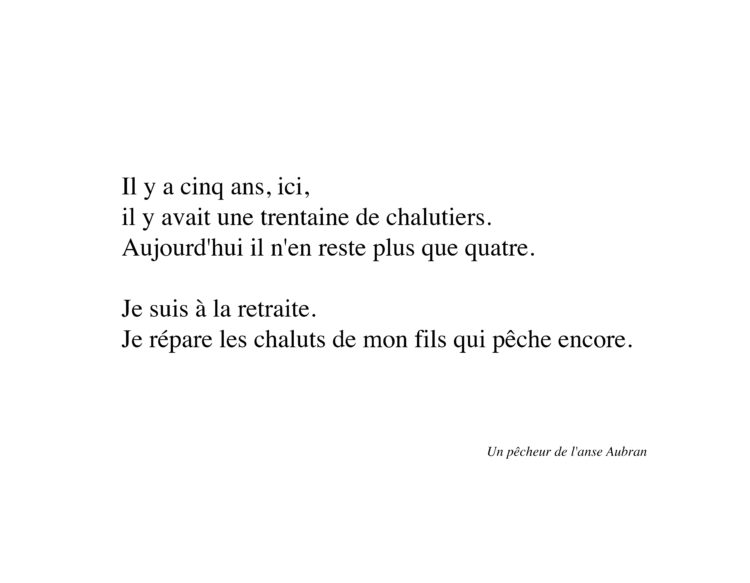



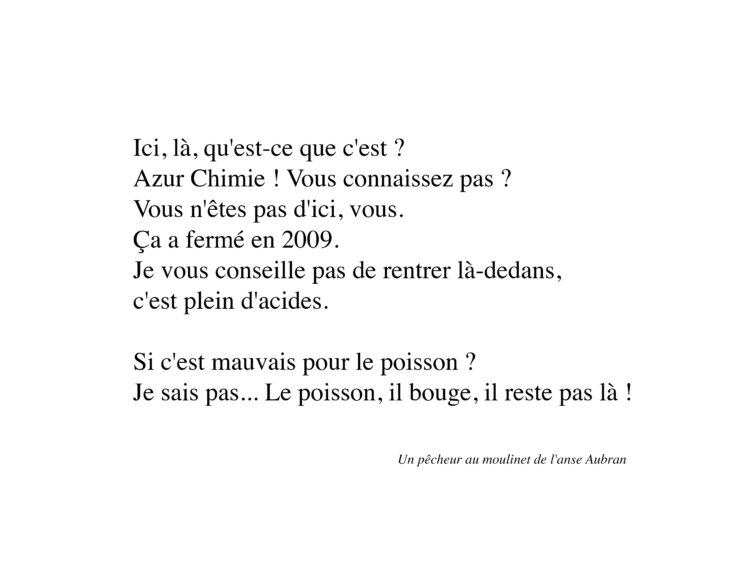


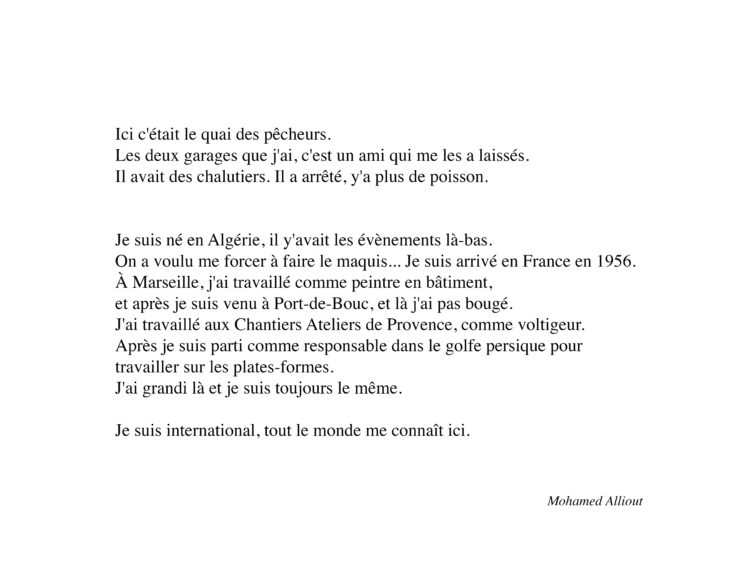

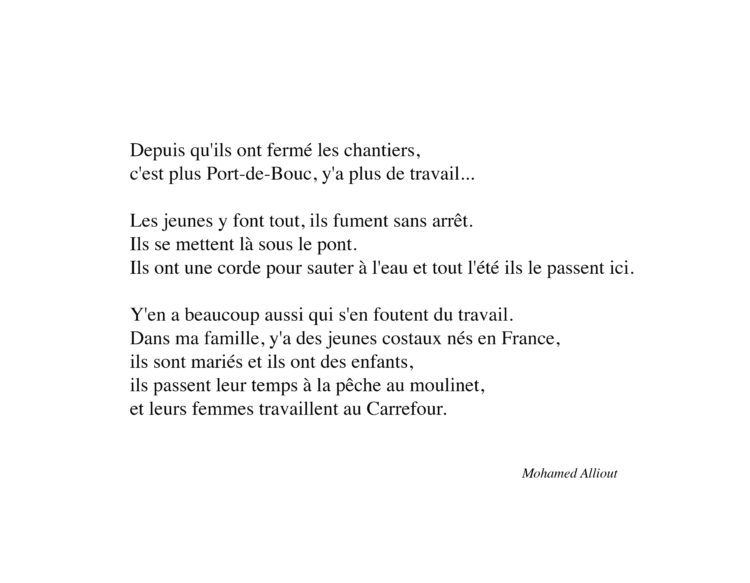

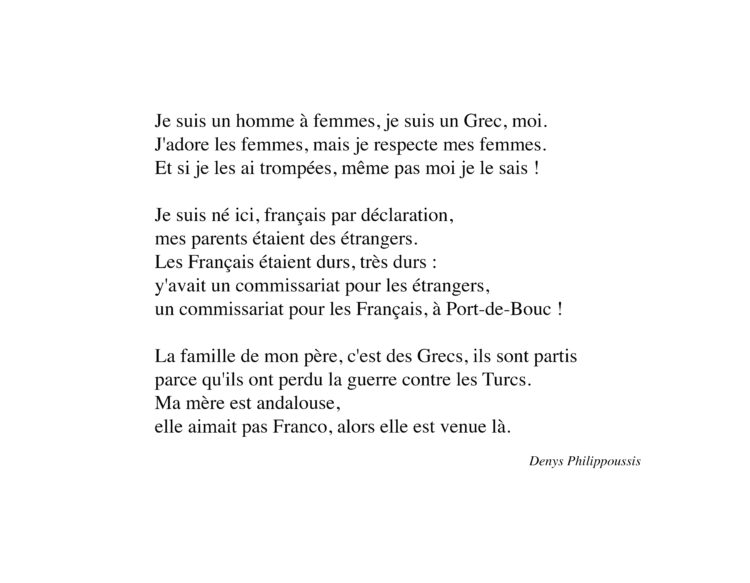


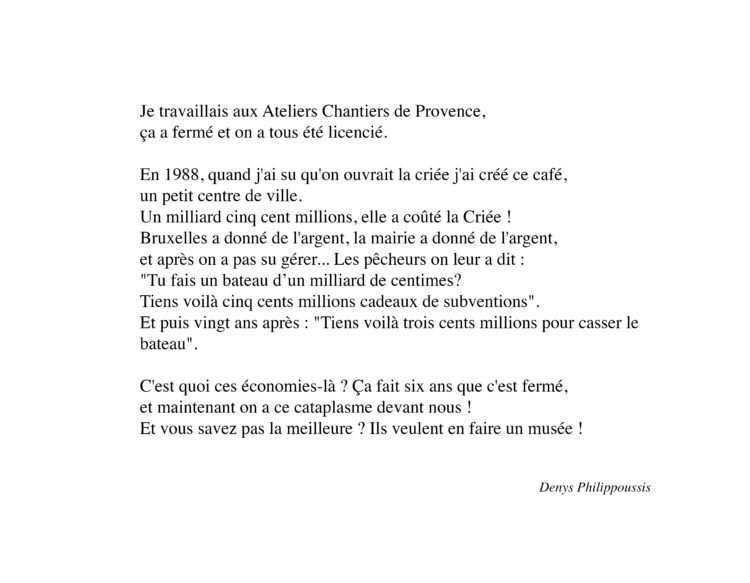































































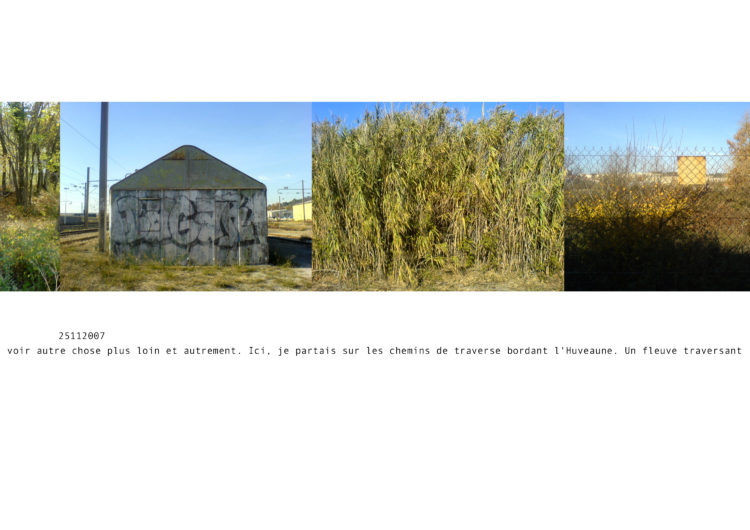

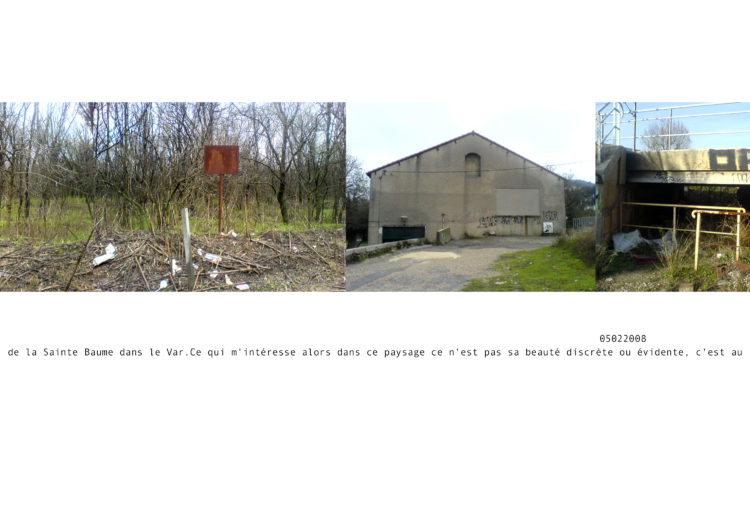
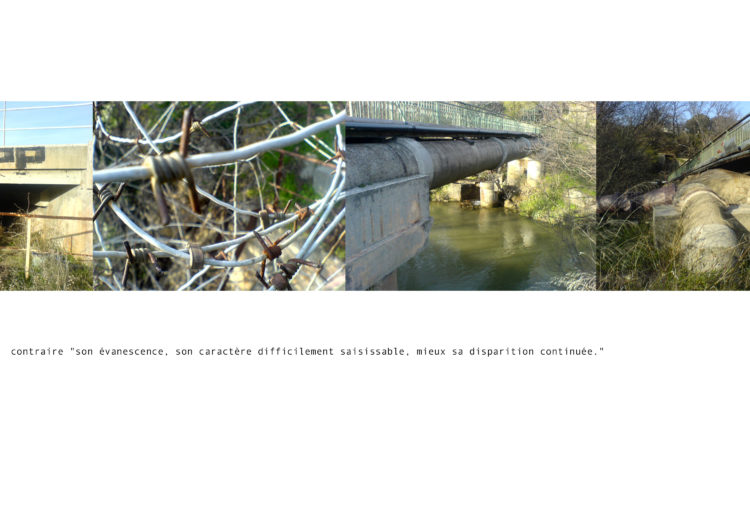



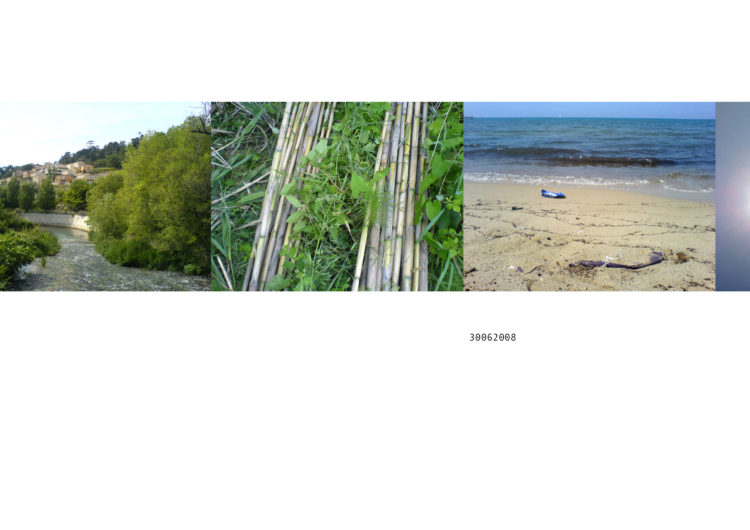




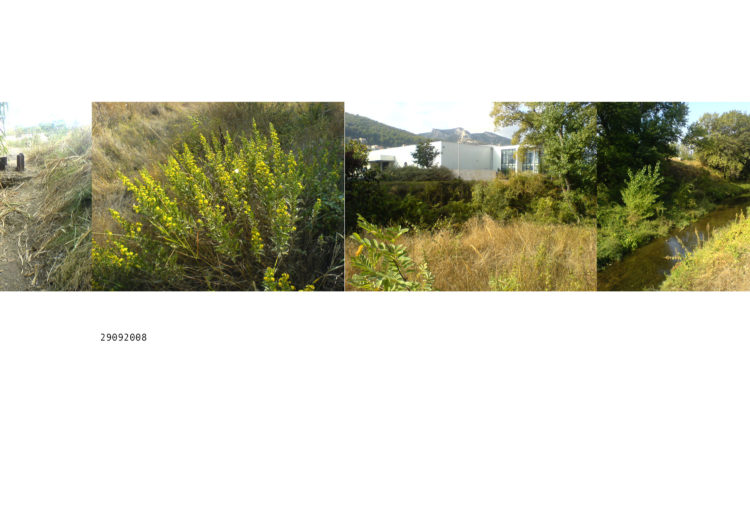
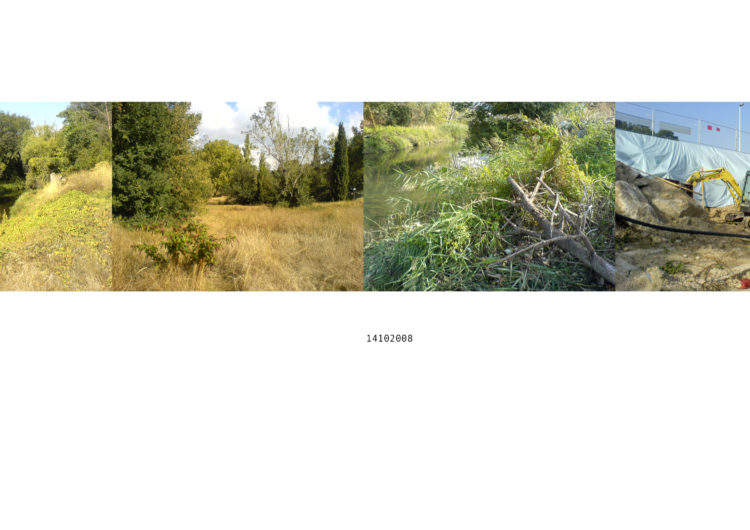
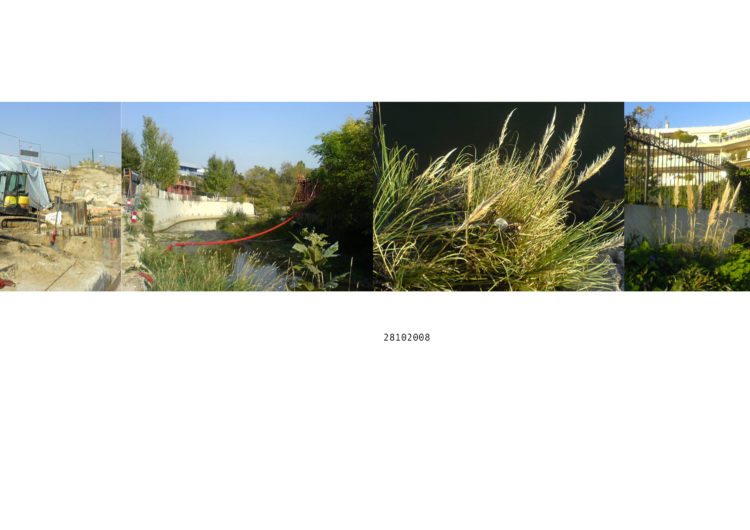












































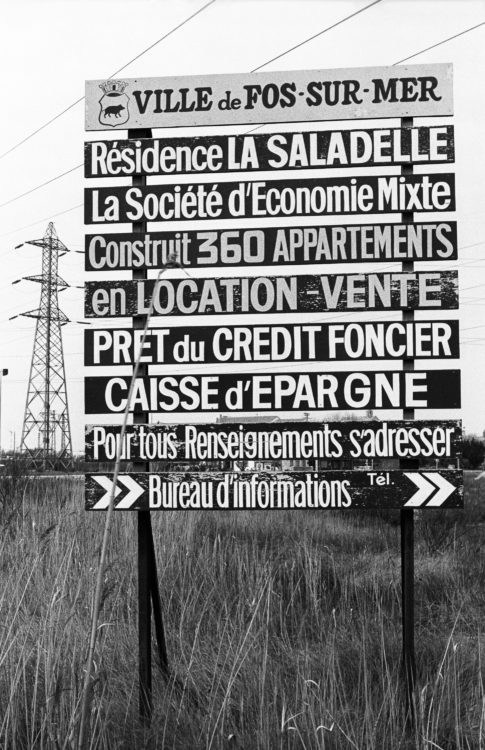
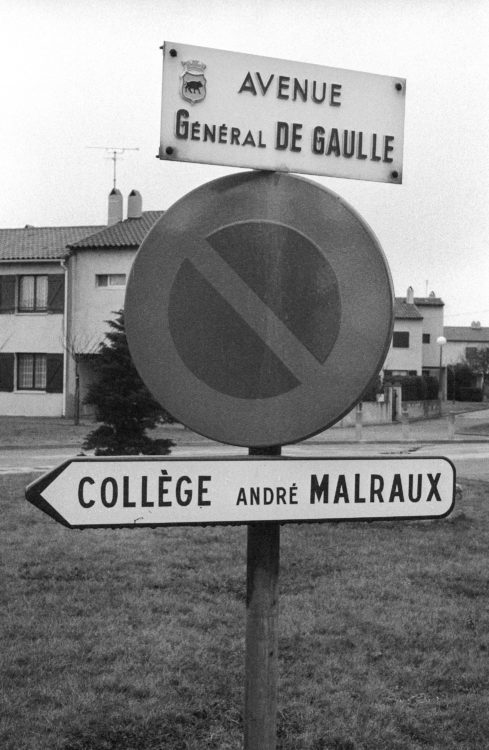
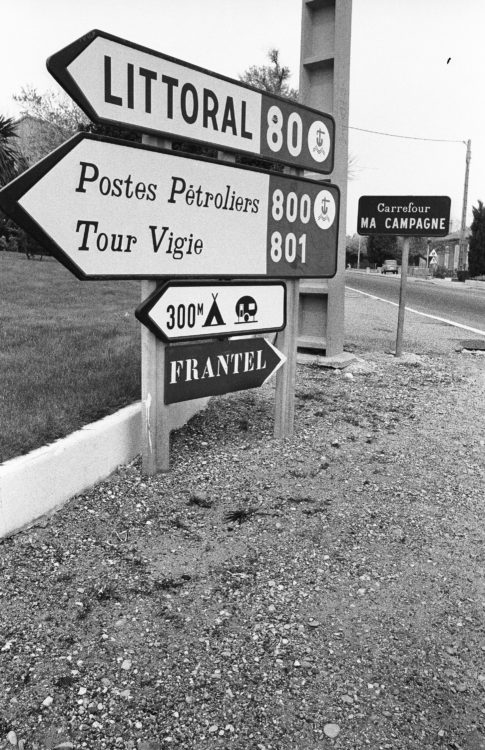
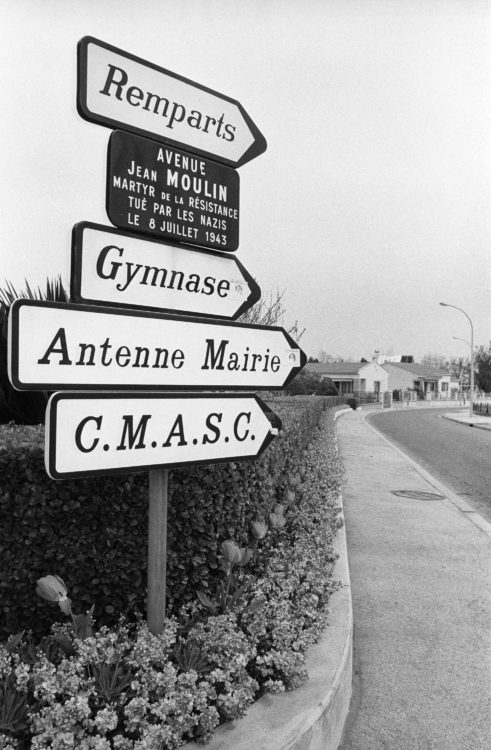


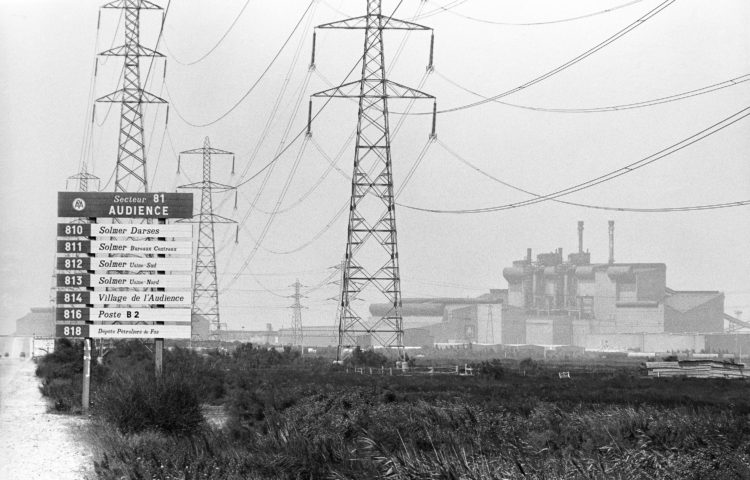














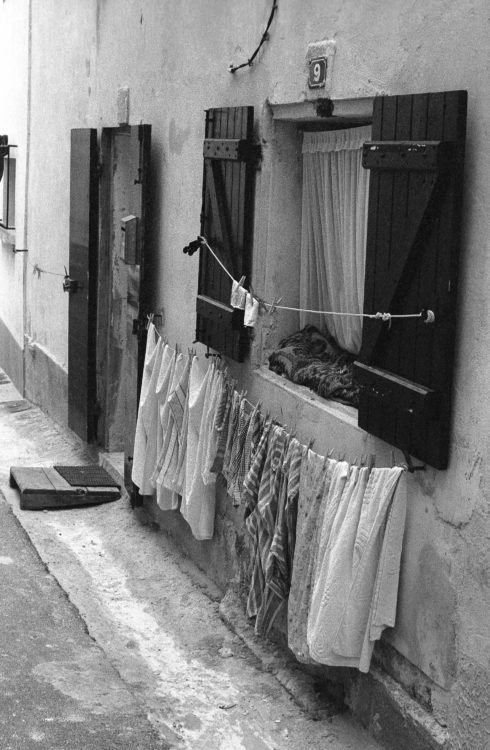
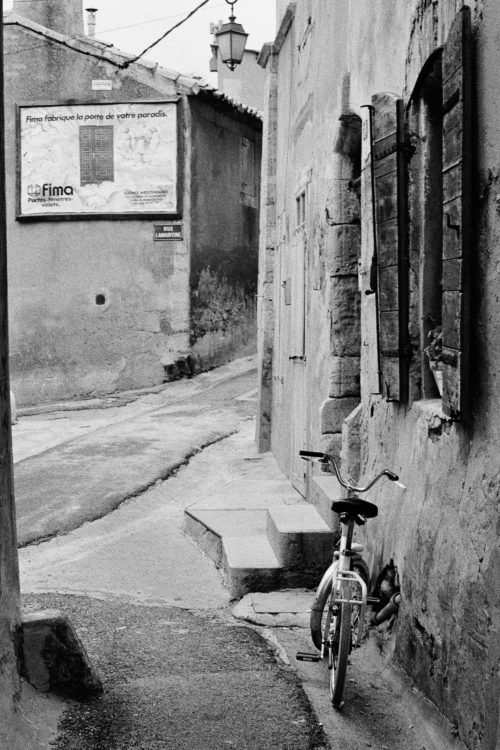
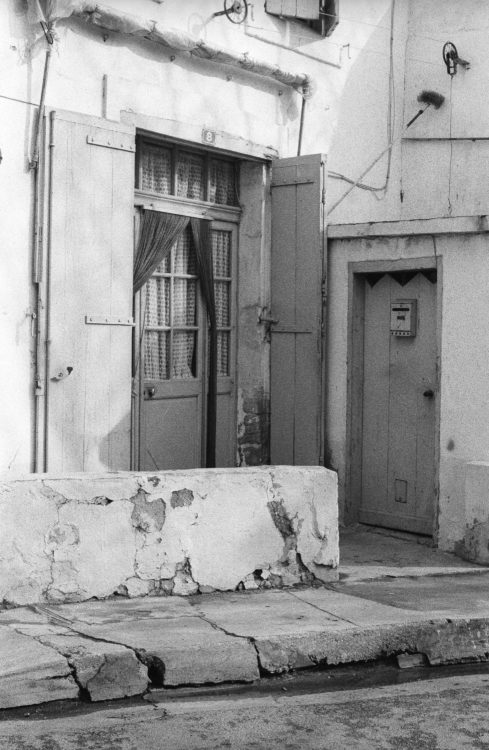








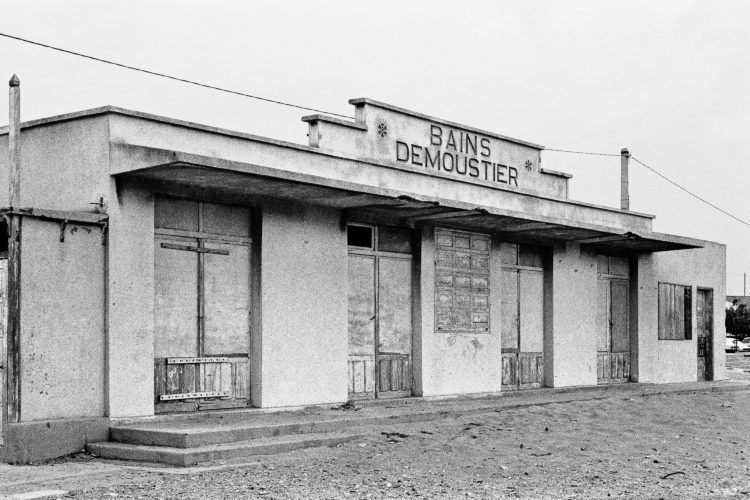

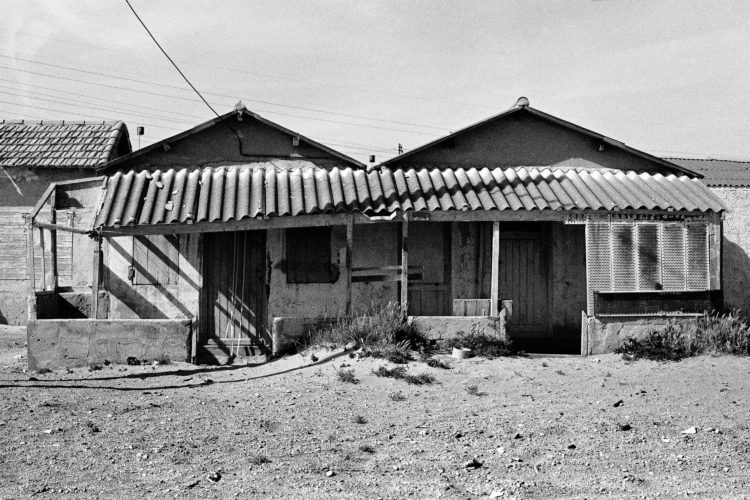




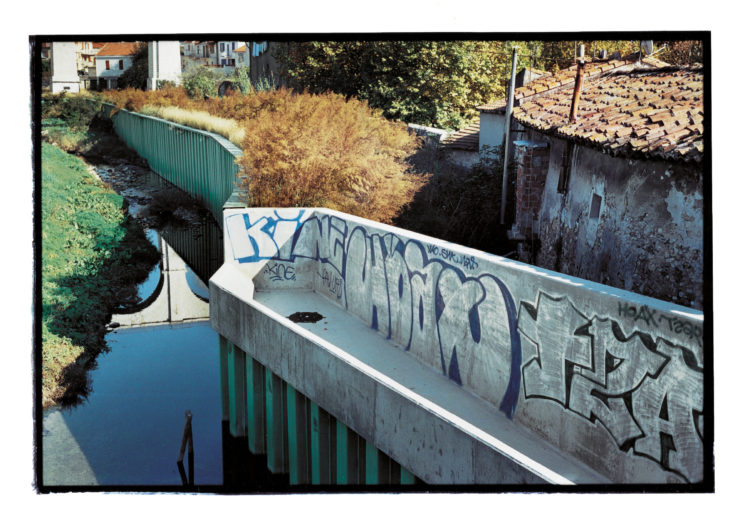

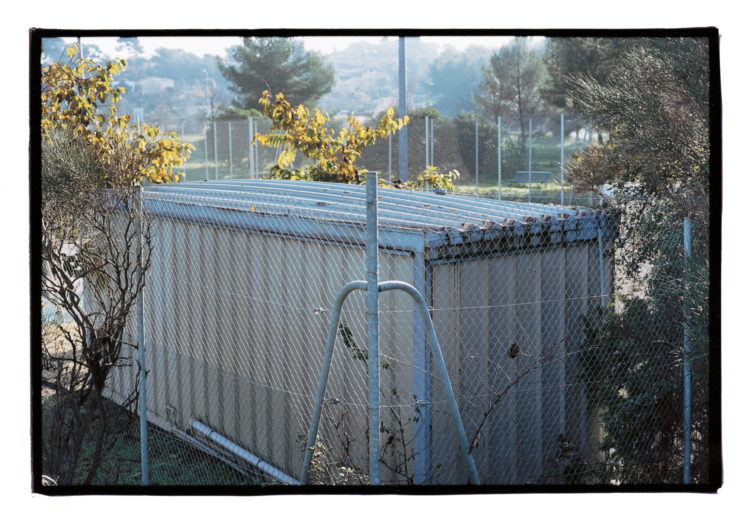

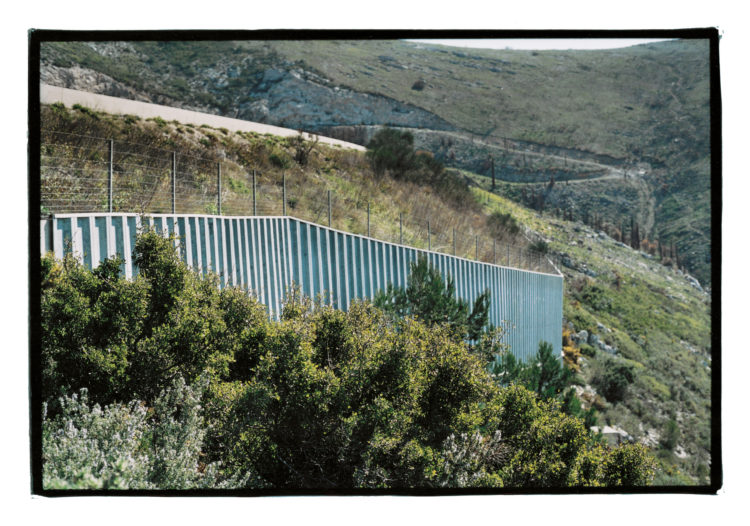

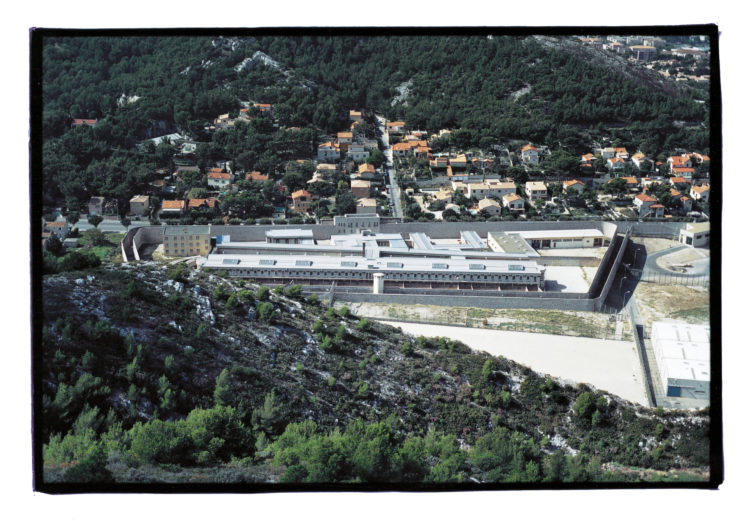
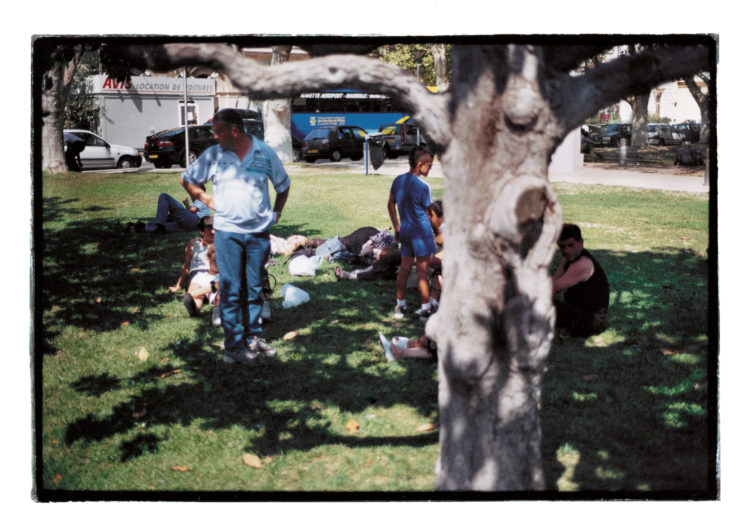


















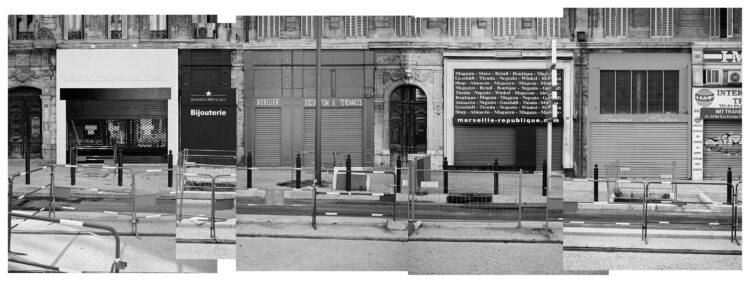










































































































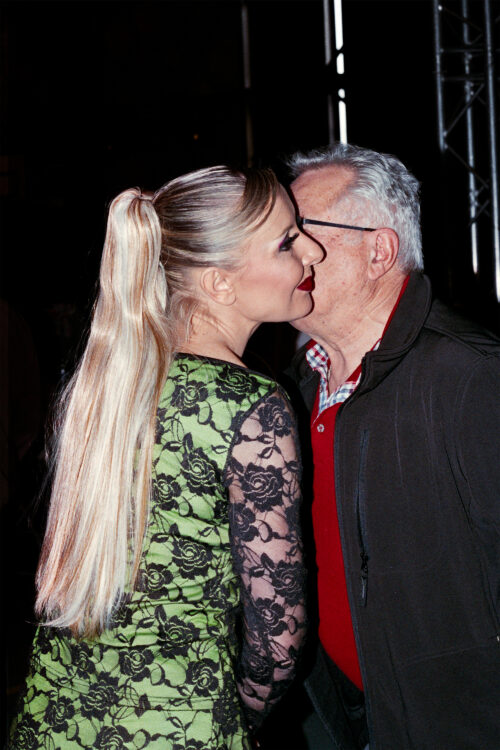








































































![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.628789, longitude -5.28535](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_01-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.628758, longitude - 5.286295](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_02-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.635741, longitude - 5.281666](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_03-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.615173, longitude - 5.333688](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_04-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.604793, longitude - 5.349727](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_05-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43608784, longitude - 5.336691](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_06-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.631108, longitude - 5.314948](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_07-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.634478, longitude - 5.314712](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_08-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.634478, longitude - 5.314712](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_09-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.633824, longitude - 5.311586](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_10-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.634437, longitude - 5.314484](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_11-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.596419, longitude - 5.321931](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_12-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.6000447, longitude - 5.350705](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_13-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.6000447, longitude - 5.350705](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_14-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.621912, longitude - 5.284765](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_15-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.622084, longitude - 5.284744](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_16-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.636658, longitude - 5.279534](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_17-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.62844, longitude - 5.33228](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_18-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.628803, longitude - 5.33404](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_19-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.621906, longitude - 5.286636](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_20-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.59699, longitude - 5.29432](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_21-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.59699, longitude - 5.29432](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_22-563x750.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.595448, longitude - 5.294233](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_23-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.634082, longitude - 5.313852](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_24-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.60329, longitude - 5.282272](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_25-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.595999, longitude - 5.329615](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_26-750x563.jpg)
![Vincent Beaume | Chemins[perdus?] | 2020 | Saint-Cannat | Latitude - 43.600222, longitude - 5.298007](https://www.inventaire.net/wp-content/uploads/2024/09/Beaume_CHE_27-750x563.jpg)